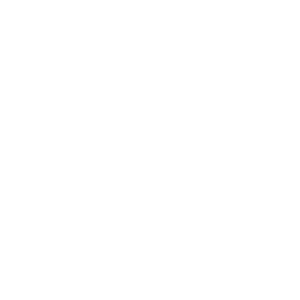JOHANN ZARCA « EN DIRECT DE PANAME UNDERGROUND »
Enregistrement : 11/03/2019
Mise en ligne : 11/03/2019

Pour celui qui était entré dans la littérature en écrivant un blog appelé « Le mec de l'underground », une rencontre avec La Spirale était presque inévitable. Nous connaissant depuis des années et ayant déjà passé quelques soirées ensemble, l'interview se fait chez moi, devant une bière. Dans le quartier de La Chapelle à Paris, à quelques centaines de mètres du Mc Do et du LCL de Marx Dormoy, bien connus des lecteurs de son Paname Underground, de ses « talonneuses » et autres « foncedés au crack ».
Propos recueillis par Éric Ouzounian. Portraits de Johann Zarca par Christophe Cussat-Blanc et Yannick Stephant.

C’est une question qu’on m’avait posé lors de ma première interview TV. Je n’ai pas envie de me définir par des étiquettes, comme celle de romancier par exemple. J’ai 34 piges, mon daron est toubib, ma mère ne taffe plus depuis un moment déjà. J’ai grandi en banlieue dans le 94 et ça fait maintenant six ans que je suis à Paname. J’ai publié mon premier bouquin en 2014 et ça fait environ un an et demi que je vis de ma plume, depuis le prix du Flore.
Quel est ton premier rapport à la littérature ?
Très jeune. J’ai commencé à raconter des histoires avant d’écrire. Aussi loin que je puisse plonger dans mes souvenirs, je racontais des histoires à des enfants plus jeunes que moi. À six ans, je jouais beaucoup avec des jouets, seul. Ma première expérience d’écriture, je m’en souviens très bien, j’étais en CE1. Je me rappelle même du titre de ce que j’appelais « mon livre », mais qui tenait sur une page, ça s’appelait Les voyages de Robert et ça racontait l’histoire d’un mec qui allait dans plein de mondes ; le monde des fantômes, le monde des dinosaures. C’était une histoire que je racontais à mon frère, qu’il écrivait sur l’ordi, parce que moi, j’étais trop branleur pour le faire. Mon frère, qui avait deux ans de plus que moi, l’avait imprimé en plusieurs exemplaires, pour que je puisse le distribuer à des camarades de classe. J’avais donc le plaisir de raconter des histoires, de les mettre en forme et de les transmettre. Partager des histoires qui viennent de ma tête, ça commence dès l’enfance.
Et tu as continué...
Après avoir écrit ce truc, Les voyages de Robert, j’en ai écrit plein. Un Livre dont vous êtes le héros qui tenait sur vingt pages. Je me souviens d’une rédaction en CM2 où je me suis vraiment fait plaisir : on devait inventer une histoire à partir d’une classe qui part en classe de neige, mon truc faisait dix pages et l’instit’ avait écrit sur mon texte que c’était bien, mais beaucoup trop long.
J’ai continué à écrire à l’adolescence, j’ai continué à écrire toute ma vie.
Tu choisis ensuite une école de journalisme, où tu n’aimes pas raconter ce qu'il se passe.
Exactement. J’aime bien choper le réel, et avec ce feeling, le réinventer. C’est ce que j’ai fait avec Paname Underground, c’est ce que j’ai fait dans presque tous mes romans. J’ai utilisé des personnages qui existaient vraiment, mais j’ai imaginé ce qui se passerait avec eux dans une histoire qui, elle, est fictive. La différence entre un journaliste et un romancier, c’est comme la différence entre un peintre qui reproduit ce qu’il voit et celui qui invente. Moi, je préfère inventer en me basant sur le réel. Je ne m’embarrasse pas trop avec la réalité. Elle m’intéresse, mais il y a toujours un moment où je m’en affranchis.
Qu’est-ce que tu lis avant ton premier roman ?
Je lis beaucoup d’auteurs qui parlent de la rue, un peu bouillants, Maurice Dantec, Guillaume Dustan... Je découvre William S. Burroughs, Hubert Selby, Jr. qui m’ont bien secoué, des auteurs américains, des écrivains un peu provocateurs.
Pas de classiques ?
Très peu. Mais je n’en suis pas fier. C’est une erreur que je rattrape maintenant, je suis autodidacte, donc je manque de bases. Je n’étais pas un grand lecteur, je vois où sont mes défauts dans l’écriture, ils sont liés à un manque de culture, si le le compense, je pourrai progresser.
Et tu commences ton blog...
Non. Avant, j’écris Le boss de Boulogne. Je l’écris pendant mon école de journalisme, en deuxième année. Je ne m’étais pas spécialisé en presse écrite, parce que je voulais progresser techniquement sur l’image, en TV, mais ça ne me passionne pas. C’était une erreur. Aujourd’hui, j’ai des propositions pour travailler avec l’audiovisuel, des scénarii par exemple, mais ça ne me fait pas bander. Plus j’ai de propositions, plus je m’aperçois que mon truc, c’est la littérature. Il y a une liberté complète, même si l’histoire est moyenne et j’estime que les miennes ne sont pas terribles, j’arrive à tenir et à avoir des lecteurs sur un style, une narration, un rythme, des personnages.
J’écris donc Le boss de Boulogne. Je l’envoie à un premier éditeur, Aurélien Masson (Série Noire), qui me répond par la négative, mais qui ne m’envoie pas la lettre type de refus. Il m’écrit deux pages, manuscrites, très encourageantes. Je l’envoie donc chez un autre, qui me dit que c’est génial et qu’on va signer. Les semaines passent et je ne vois rien venir. Une autre tentative plus tard, je me dis que ça va être galère et je laisse tomber.
C’est le moment ou tu crées ton blog, « Le mec de l’underground » ?
Oui. Un choix étrange, vu que je ne suis pas geek du tout. Je venais de rentrer d’un an et demi en Asie, je faisais des boulots alimentaires, j’étais pion... Je me suis dit que ça pourrait me faire une base de lecteurs, qui appuieraient un livre au cas où un éditeur s’y intéresserait. Il faut se souvenir qu’à cette époque les réseaux sociaux n’existent pas, on est aux balbutiements de Facebook. Les blogs sont maintenant dépassés, mais à l’époque, ça marchait bien.
Un pote me fait un blog, j’écris, je m’y tiens. Quand tu écris, c’est pour être lu, le blog permet d’avoir un retour des lecteurs. Il y a beaucoup de blogs littéraires, beaucoup de blogs d’auteurs. Moi, je suis resté dans le même univers cohérent, ça devenait des saynètes, il y avait de l’humour et ça marche à tous les coups. « Le mec de l’underground », c’était parfois n’importe quoi, une clique de pieds nickelés qui marchent sur des peaux de bananes et qui sont défoncés en permanence, avec une surenchère dans la grossièreté. Je me suis bien marré en l’écrivant. Ce blog est un peu parti du journalisme, je suivais des graffeurs dans le métro, mais ça n’intéressait personne. Le journalisme street, tout le monde s’en fout, ça prend du temps et c’est chiant à écrire.
Je finis par inventer une scène avec mon personnage, le mec de l’underground et sa frangine, qui lui offre une bouche en plastique de sex shop. Il est tout content, mais elle a mis de la glu dedans et le mec se retrouve collé avec son truc et doit aller aux urgences avec la queue dans une bouche en plastique. Je publie cette histoire sur mon blog et un mec qui a une petite notoriété dans le milieu des blogs littéraires se tape une barre, le retweete et ça tourne un peu. Je me rends compte que je me suis bien amusé à l’écrire, j’ai eu un retour tout de suite et ça m’a pris une demi-heure. Je suis resté dans cet univers, avec des personnages hystériques, des bastons à deux balles. Et pas mal de gens le lisent.
Le calcul s’avère juste parce qu’un an après, je suis contacté par les Éditions Don Quichotte. Le blog a bien marché et quand Les Inrocks en parlent, une maison d’édition me demande si je n’ai pas un livre sous le coude. Et j’ai Le Boss de Boulogne. Trois ans séparent l’écriture de ce bouquin du début du blog.
Le Boss sort chez Don Quichotte, comment ça se passe ?
Bien. Les médias en parlent, le livre marche bien, la maison d’édition travaille bien. Pour le deuxième, j’ai davantage de pression. Je ne veux pas faire la même chose, mais je reste dans un univers dit « underground », un univers noir, urbain. Je n’utilise pas la même argot. Ce n’est pas l’argot ultra contemporain et je change de décor, je vais en Thaïlande, que je connais très bien.
Tu y as vécu ?
J’y suis resté un an et demi. Mon oncle avait un journal qui s’appelait L’Écho du Cambodge, un journal d’expatriés, il travaillait tout seul et commençait à vieillir. Je connaissais le taf et il n’y avait pas trop de pression, pas d’exigence d’information. De toutes façons dans ce pays, tu ne peux pas parler de politique, de rien. Le canard était gratuit et tenait sur la pub, je faisais donc beaucoup de publi-rédactionnels. C’est en général le truc qui ne fait bander personne, sauf que moi, je trouvais que c’était cool, je kiffe écrire, même si c’est de la pub. Le résultat, ça faisait fanzine à l’arrache.
C’est la toile de fond de Phi Prob, ton deuxième roman ?
Oui, celui-ci aussi marche pas mal, mais moins que le premier. Il est moins original sur le plan de la langue, ça ne se passe pas au même endroit, mais il y a une bonne promo quand même, c’est pas un bouquin qui se fait flinguer, en même temps on ne m’attendait pas plus que ça. C’est un livre plus sombre que le premier, peut-être que tous ceux que j’ai écrit. Ensuite, il y a Ptit Monstre, chez un autre éditeur qui ne fait pas son job, celui qui m’avait proposé un contrat que je n’avais jamais vu. Mais bon, un éditeur, c’est comme ton patron, t’es pas là pour l’aimer. La réalité, c’est qu’avec les deux premiers, je m’étais fait un petit nom, mais Don Quichotte me refusait mes bouquins, ils voulaient faire autre chose, c’était le moment de se quitter.
Donc je change d’éditeur, celui-ci ne fait pas son boulot sur un bouquin qui n’est déjà pas facile à défendre. Les gens n’ont pas forcement envie de se plonger dans la tête d’un enfant taré, dans une histoire basée sur les biographies d’une centaine d’enfants tueurs en série. Le livre est super dur, noir, aborde un sujet tabou et l’éditeur ne sait pas faire ça. Donc c’est un flop. Pourtant j’en suis content.
C’est après ce livre que tu crées une maison d’édition ?
Oui. On a peu de pèze. Mon associé est journaliste, il a sorti un bouquin chez Flammarion, une enquête sur Luc Besson. Pour la première année, on décide de prendre un auteur extérieur. Lui fait une enquête, ce sera notre première publication. C'est Steak Machine, ça se vend bien, à 7000 ou 8000 exemplaires. De mon côté, j'écris Paname Underground qui est le premier roman. Nous avons deux lignes éditoriales, enquêtes et romans.
Au début, on est tous des potes qui ont un lien avec le livre. C'est à l'époque de mon premier roman, on discute de l'objet livre. Clara, la fille du trio, est une boulimique de lecture et elle corrige les papiers pour Courrier International. Le délire, c'est que Geoffrey (Le Guilcher ) et Clara (Tellier Savary) habitent dans un immeuble à la Goutte-d'Or, dans lequel un appart se libère J'y déménage. Donc on se voit souvent et un soir en picolant, l'idée vient. Chez moi, c'était une volonté d'auteur. Deux jours après, on se dit que ce serait marrant de le faire et on y va. Geoffrey part deux mois dans un abattoir breton pour raconter son immersion, ça va donner Steak Machine.
Après, on édite Gabrielle Deydier, On ne naît pas grosse, un livre sur l'obésité qui cartonne, dont on parle dans le New York Times, Vice Chine, CNN, elle fait la couve du Guardian, avec un travail qui casse l'image de la femme française. Ensuite, c'est le mien, le premier roman. Il est sélectionné pour le prix de Flore, avant même d'être sorti, et quinze jours après, j'ai le prix ex aequo avec Pierre Ducrozet, qui sort un bouquin ultra fort, très littéraire. La maison se met bien en place. On est trois, on arrive à en vivre, d'autant qu'on a revendu les droits audiovisuels, fiction et documentaire, pour trois livres.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir le prix de Flore ?
Deux trucs contradictoires : un truc super cool et un autre super badant. Ce qui est cool, c'est que ça représente une consécration énorme. Je ne suis pas très sûr de moi en général et là, tout de suite, je rentre dans le game des auteurs qui pèsent. C'est ce à quoi j'ai toujours bossé. J'accède à la reconnaissance. La première, c'est le premier bouquin. Et là, c'est un grand prix littéraire. Cela donne confiance en soi puissance dix, c'est ce qui m'est arrivé. D'autant que j'avais pas mal galéré à écrire ce livre et que je m'étais dit : si je me sors de cette histoire, je peux tout écrire.
De l'autre côté, on rentre dans le culte de la performance, de la surproduction. C'est assez malsain. C'est pour ça que j'ai écrit le dernier, Success Story, pour sortir quelque chose d'ultra léger, un « feel-good », qui permet de casser mon image, tout de suite. Pour s'habituer à avoir des hauts et des bas, avoir des cycles au lieu de chercher à tout le temps monter, comme un politicien.
Faire de l'art et pas du commerce ?
Exactement. Tout ça n'a pas de sens, surtout ce qu'il y a autour, la coke, les meufs … C'est tout ce qu'il y a de plus cliché. Il y a eu plein de livres et de films sur tous ces gens qui réussissent et qui rentrent dans un truc débile qui sert strictement à que t'chi. Cet aspect, je l'ai dépassé aujourd'hui. Je suis revenu dans une spirale saine, j'écris pour me faire plaisir. Mais si j'avais été un peu plus fragile, ça m'aurait fait faire de la merde.
Qu'est-ce que tu as dans les cartons ?
Je sors un livre chez Fleuve, le 20 Septembre prochain. C'est l'univers de mon blog « Le mec de l'underground », avec des personnages, des vannes et des spots récurrents. Le roman, que j'avais auto édité en 2015, après Le Boss de Boulogne va sortir. C'est censé être une série littéraire, l'éditeur veut refaire un genre de San Antonio, écrit sur le langage mais avec des personnages que l'on retrouve. Gros défi ! C'est pas parce que ça marchait avant que c'est toujours le cas. Le premier est écrit, donc je vais faire le deuxième.
Ce n'est pas comme Le Poulpe, écrit par des auteurs différents ?
Non, dans ce genre là, c'est trop compliqué. Le langage, le style, le rythme, l'univers, sont trop personnels.
Un autre sort en 2020, chez Grasset, sur le sujet du chemsex. C'est comme Requiem For a Dream. C'est la descente aux enfers d'un de ces mecs qui, avant de faire des orgies, gobent ou s'injectent des psychostimulants. C'est un hétéro, initié par un gay, qui essaie de cacher ça à sa famille et qui s’enferme dans la consommation de drogues qui le font devenir dépendant sexuel, donc deux dépendances à la fois. Après j'aimerais bien me lancer dans une dystopie, pour tenter encore autre chose.
Tu n'as pas envie de travailler sur un film par exemple, quelque chose en rapport avec l'image ?
Pas trop. Pourtant je suis de la génération de l'image. Tous mes livres sont d'abord pensés comme des films, j'imagine même parfois des acteurs précis. J'ai des propositions, mais je ne suis vraiment pas un auteur qui veut tout gérer ; je préfère que quelqu'un s'empare de ce que j'ai écrit. Évidemment, je peux être déçu après, mais si le film est foiré, c'est pas moi qui l'ai fait. Je préfère que quelqu'un se réapproprie mes histoires, ça m'intéresse davantage que de refaire un truc que j'avais déjà imaginé en l'écrivant. J'avais tenté une BD pour « Le mec de l'underground », mais ce n'est jamais sorti. Et puis c'est du taf et moi je suis plus à l'aise tout seul, avec un ordinateur, qu'avec une team. Gamin, j'avais déjà des petites caméras, mais je n'ai jamais fait de films.
Est-ce que tu essaierais d'autres genre : SF, romans d'époque ?
Bien sûr. Quand je parle de dystopie, c'est un sous-genre de la SF. J'aime bien le cyberpunk aussi, je ne m'interdis rien, j'ai même écrit trois nouvelles de politique fiction qui étaient des commandes mais je me suis amusé à les écrire. Même des livres pour enfants, ça pourrait me faire kiffer. Pour les romans d'époque, j'y ai déjà pensé, mais j'aimerais remodeler l'époque, comme dans Inglorious Bastards. J'ai envie de parler de cette période historique telle que je l'imagine, ce qui est finalement transgressif, parce que que c'est du révisionnisme, mais je m'en fous. C'est un roman après tout.
Un écrivain travaille toujours dans un environnement ; comment sens-tu l'époque ?
Je suis d'une nature assez optimiste, mais l'évolution de la société est assez angoissante. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un effet de la médiatisation, des réseaux sociaux, je ne sais pas, c'était sûrement pas plus cool au Moyen Âge.
Paul Virilio, qui est mort récemment et dont on a beaucoup parlé dans La Spirale, disait que nous étions entré dans une société de vitesse, et que ça n'a pour seule conséquence que de nous rapprocher plus vite de notre mort, qu'en penses-tu ?
L'accélération, c'est flippant. En l'espace d'un an, tu ne comprends plus rien au monde dans lequel tu vis, tu peux être dépassé par ton époque. Tout se précipite. C'est ce que j'ai vécu après le prix du Flore, ce désir de performance, c'est lié à l'accélération. Il faut bouffer, consommer, produire, même quand tu es romancier, éditeur. C'est pesant. D'autant que ça amène à être toujours concentré sur son avenir, sur le futur. Cela ne veut pas dire que j'envie les gens qui vivent dans le passé, mais vivre tout le temps dans le futur, ce n'est pas enviable non plus. Je préfère kiffer le moment présent, si je peux.
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.