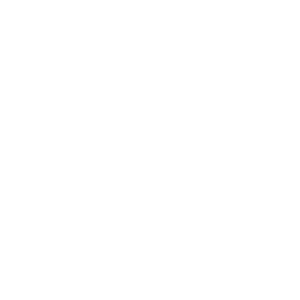JEAN-YVES MILLET « PAYSAGES INDUSTRIELS, DÉTOURNEMENTS SONORES ET VISUELS »
Enregistrement : 18/10/2020
Mise en ligne : 18/10/2020

Les références au constructivisme, ainsi qu’au monde post-industriel et contemporain viennent enrichir l’esthétique de Cent Ans de Solitude, composé notamment d’images de films de réalisateurs réputés comme Sergueï Eisenstein ou Dziga Vertov, ou bien oubliés comme Carl Ludwig Achaz-Duisberg, mais aussi de documentaires, de photographies, de rushes de reportages ou de prises personnelles.
De l’émergence d’une scène expérimentale en France au début des années 1980, en passant par le développement d’une presse alternative et de son label indépendant, Jean-Yves Millet aborde dans cet entretien son rapport à la création, à la scène et à la valorisation d’un mouvement industriel en marge.
Propos recueillis par Nicolas Ballet. Cet entretien provient initialement d’une recherche menée pour la thèse de doctorat de Nicolas Ballet en histoire de l’art (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), intitulée « Force de Frappe », Culture visuelle des musiques industrielles (1969-1995), qui est en cours de publication.

Nicolas Ballet (N.B.) : Vous avez collaboré avec l’artiste français Tiburce durant plusieurs années, notamment pour certains concerts du groupe industriel La NomenKlaTur. Quel est votre rapport à la scène ?
Jean-Yves Millet (J.-Y.M.) : Effectivement c’est une collaboration qui a débuté avec le projet Minamata et le label Les Nouvelles Propagandes, et qui a continué ensuite avec La NomenKlaTur. Nous nous sommes connus au tout début des années 1980 à Tours. Nous animions chacun à l’époque une émission sur une radio libre et le hasard a fait que nous travaillions dans le même établissement scolaire. Cette collaboration a d’abord pris la forme d’un soutien lors des premiers concerts de Minamata et ce jusqu’à fin 2010, en tenant la table de mixage et en assurant ce que l’on peut appeler le son live et la « technique de scène ». Et puis il y eu une première expérience de la scène avec La NomenKlaTur en novembre 1996 lors du festival « Deadly Actions ». C’est donc assez naturellement que cette collaboration s’est de nouveau mise en place en 2012 à la suite de la sortie du CD World at War (2011) et des performances qui suivirent. Quelque chose avait cependant évolué, puisqu’au début de l’année 2010 j’avais saisi l’opportunité de porter sur scène mon projet personnel Cent Ans de Solitude. Aussi, la performance sur scène pour World at War a été pensée suivant la même approche que mes propres sets. Pour chaque morceau, j’ai proposé un atelier souvent constitué d’objets en métal, seuls ou assemblés qui étaient frappés, frottés ou grattés et équipés de micro-capteurs. Le signal sonore généré était ensuite traité suivant ses caractéristiques spécifiques au travers de chaines d’effets. Ce fut un travail long mais créatif et passionnant qui demanda d’abord de s’approprier chaque atelier et ensuite d’en maîtriser les nuances et les enchainements. Ce travail de conception continua durant tout le « World at War Tour » suivant les morceaux qui étaient ajoutés comme par exemple la pièce « Phase IV » qui clôtura la performance du « Wrocław Industrial Festival » en 2012, ou encore celle du Petit Bain à Paris en 2013. Chaque atelier participe à la performance de scène et à l’ambiance « industrielle oldschool » que nous voulions donner au spectacle. C’est visuellement très « vieille école » mais avec les technologies actuelles. Sans cet apport, ce n’aurait pas été envisageable, ou alors avec beaucoup de moyens et de contraintes sur scène.
L’un de nos objectifs était de proposer un spectacle physique avec de l’énergie, de la sueur, du bruit et de la fureur. Être acteur sur scène en générant en live des sons à travers chaque atelier. Nous m’envisagions pas La NomenKlaTur derrière un ordinateur et des surfaces de contrôle. C’est en tout cas ma conception et mon rapport à la scène : une implication physique, une émotion intacte et la volonté de ne pas tricher et de surprendre le public en produisant des sonorités qu’il n’imaginait pas à partir d’objets improbables. En effet, que peut-on attendre d’une plaque de carrelage, d’un bloc de polystyrène, d’une tige filetée ou d’un radiateur ?
La NomenKlaTur, « World at War Tour » (2012)
« Wrocław Industrial Festival », Wrocław.
N.B. : Vous entretenez aussi un rapport assez radical au corps durant vos concerts…
J.-Y.M. : Un concert est une performance. Tout d’abord, se produire sur scène implique de la concentration car même s’il existe des espaces de liberté, pour ce qui me concerne tout est organisé et structuré suivant un fil directeur rigoureux qu’il ne faut pas perdre. Ensuite, c’est vrai que j’apprécie la performance physique pour donner le maximum d’énergie sur scène. Le rapport au corps est aussi très visuel durant les concerts. Que ce soit avec Cent Ans de Solitude, lorsque j’utilise le corps comme une caisse de résonance en me frappant avec les paumes sur la poitrine et l’abdomen, ou encore avec La NomenKlaTur avec cet énorme bidon métallique de deux cents litres, porté en bandoulière. Mais c’est aussi tenir des rythmiques avec des barres de métal jusqu’à avoir les mains écorchées ou encore descendre dans le public avec une grande tôle en guise de bouclier et se faire littéralement bousculer par une audience surchauffée. Ce côté physique est une forme d’authenticité et sans doute un héritage des performances qui m’ont marqué, comme celles des groupes Test Dept., SPK et Einstürzende Neubauten dans les années 1980.
Ciné-concert de Cent Ans de Solitude & Flint Glass sur le film Sprengbagger 1010 (1929), le 16 septembre 2016, Institut national d’histoire de l’art, Paris. Photographie de Stéphane Burlot.
N.B : Test Dept. et Einstürzende Neubauten évoluent également dans des sociétés postindustrielles, en détournant le déclin de l’industrie lourde et ses décors postapocalyptiques dans leurs productions et performances. Comment considérez-vous l’esthétique de l’industrie lourde durant ces années ?
J.-Y.M. : Ce rapport au déclin industriel est bien entendu très présent chez Test Dept. Pour Einstürzende Neubauten, c’est plus la notion de « chantier » et la démolition propre à Berlin, car le contexte économique de l’industrie allemande n’a rien à voir avec celui des années Thatcher en Grande Bretagne. L’industrie possède sa propre esthétique, qui a été très tôt mise en scène par Eisenstein par exemple et dans le cinéma soviétique, mais aussi dans le cinéma allemand d’entre-deux-guerres avec notamment le très beau film Sprengbagger 1010 (1929) de Carl Ludwig Achaz-Duisberg, dans lequel la machine, véritable monstre d’acier, est magnifiée et devient un personnage à part entière. Le travail iconographique considérable de Bernd et Hilla Becher sur le « paysage industriel » participe aussi à cette esthétique. La fascination « industrielle » est d’abord dans l’architecture et le gigantisme de ces structures. C’est toute cette démesure par rapport à l’échelle humaine qui retient l’attention. J’ai toujours trouvé de la beauté à ces grands complexes et bien entendu surtout la nuit. Mais derrière il y a aussi les conditions de travail difficiles des hommes ; le travail à la chaîne, les cadences imposées d’un monstre qui ne s’arrête presque jamais, et la déchéance de l’homme.
Bernd & Hilla Becher, Knutange, Lorraine (1971),
photographie noir et blanc, tirage argentique, 50 x 60 cm.
Au départ, cette fascination est fantasmée, intellectualisée, et loin de nous la volonté de s’installer dans une critique du monde industriel comme pourra le faire Test Dept. Cependant, je suis natif d’une ville de petites industries et ce paysage a fait partie de mon quotidien, que ce soit la locomotive crachant sa fumée qui rentre au hangar, les forges, les pointeries, les sorties d’usine, ou encore les grèves… Et puis l’usine, j’y suis passé : une usine de transformation de charbon de noix de coco. Le travail était physique, dur, sale. Mais à quatre heures du matin sous la lumière blafarde du quai de déchargement, il y avait une atmosphère unique. Tout comme ce gigantesque four rotatif en métal situé en hauteur et que l’on regardait tourner lentement, allongé par terre durant les pauses. Le milieu industriel c’est aussi des bruits, des sons, des odeurs. Et des hommes et des femmes. Et puis la culture et les valeurs de la classe ouvrière. Mais tout ceci appartient au passé maintenant. Pour être parfaitement honnête, cette fascination ne serait sans doute pas la même si j’y avais travaillé des années durant. La critique du monde capitalisme, de cette aliénation par le travail et de sa tendance la plus forte avec la domination de l’homme par l’homme est venue plus tard. Cette fascination est en fait un hommage au monde et aux hommes qui firent cette époque, car aujourd’hui l’industrie a disparu et l’aliénation et l’abrutissement sont assurés au quotidien par les médias.
N.B. : On pourrait aussi penser à l’esthétique du film Le Bunker de la dernière rafale (1981) ?
J.-Y.M. : C’est un film industriel culte par son surréalisme et son côté brut, épuré. Un film qui a marqué toute une génération. Mais je pense aussi au Dernier Combat (1983) de Luc Besson. Un film qui nous marqua également beaucoup, tout comme Delicatessen (1991) quelques années après. On n’est plus dans l’esthétique de l’usine mais dans l’insondable de l’âme humaine, sa folie, sa noirceur et ses obsessions. C’est vrai qu’à cette époque on a beaucoup « pioché » dans les images, les visuels et les séquences des films d’Eisenstein qui nous passionnaient comme La Grève (1925), La Ligne générale (1929) et Octobre (1927), ou encore Lettres d’un homme mort (1986) de Konstantin Lopouchanski. Il y avait aussi Stalker (1979) de Tarkovski qui fut un vrai choc cinématographique pour moi, au point de me demander si le cinéma pouvait encore proposer quelque chose de nouveau. Bien entendu, je me trompais ! Stalker, c’est une esthétique singulière avec ses bâtiments glauques et décrépis, ses lieux particuliers, vides, et ses longs monologues. Une réflexion sur le sens premier de l’existence, le renoncement, la mutation…
N.B. : Ce rapport à la mutation se retrouve d’ailleurs dans Minamata, parmi d’autres formations de musique industrielle…
J.-Y.M. : Oui comme SPK notamment. Je vais parler du groupe Minamata simplement au titre du label Les Nouvelles Propagandes qui a assuré l’ensemble de ses productions, label dont j’assure la pérennité seul depuis de début des année 1990. Mimanata aborde les questions de la pollution (l’empoisonnement), la maladie, le mensonge. Mais aussi la lutte. Visuellement, c’est vrai, on a procédé à de la récupération avec les clichés célèbres d’Eugène Smith. Mais ils étaient incontournables. Je me souviens aussi du film Le Diable probablement (1977) de Robert Bresson qui, à un moment donné, parlait de Minamata. Minamata c’est aussi tout le poison que tu as en toi, que tu as généré et qui te transforme peu à peu. Dans son concept, Minamata fait le lien entre cette « industrie lourde » et ses conséquences irréversibles sur l’être humain et son environnement. La catastrophe de Minamata s’est accompagnée d’un mensonge d’état savamment organisé et orchestré par des tactiques de désinformation. Avec Fukushima plus de cinquante ans plus tard, on voit que peu de choses ont changé. Avec ce phénomène, on arrivait à traiter de nombreuses thématiques présentes dans la scène industrielle, comme les mutations, les malformations, la souffrance et tout ce côté macabre : cette réalité refoulée, cette négation complète de ce qui a pu se passer et de ses conséquences.
Minamata, performance (1985), Festival « PsyKosonotoK », Tours.
Sur scène, Minamata voulait exposer ce concept. Le décor était constitué de gros bidons métalliques servant de percussions, de fils de fer barbelés qui séparaient le groupe du public et sur lesquels étaient accrochés des poissons. Un performer allongé sur un tréteau au milieu de la scène, enveloppé de bandelettes tuméfiées, symbolisait par spasmes cette agonie durant toute la performance. L’entrée en scène s’effectuait en lançant des poissons sur le public, car le poison est le vecteur par lequel l’intoxication au mercure a déclenché la maladie de Minamata et représente donc de fait un symbole important. Le visuel était assuré par des projections de diapositives conçues pour le spectacle. Inutile de dire qu’après l’introduction, une partie du public avait quitté les lieux. J’ai le souvenir d’une performance assez unique pour cette première prestation. Elle fut suivie quelques semaines plus tard d’une seconde performance à Nantes pour un festival. Cette fois dans un style différent et avec une violence sur scène plus marquée, notamment en martelant avec acharnement quelques bidons métalliques. Avec le recul, je m’aperçois que le public assez « arty » fut choqué et certains à la fin entonnèrent l’hymne allemand, en reprochant une image « totalitaire » laissée par la performance. Ce qui nous a choqué à notre tour car ce n’était pas prémédité et surtout hors sujet. Minamata, par sa musique et ses mises en scène extrêmes était alors associé par raccourci au totalitarisme. C’est l’une des contradictions de cette scène durant cette période. Sans doute un manque de sémantique et on se rend alors compte à quel point l’individu peut être conditionné. Ce fut la seconde et dernière expérience de scène de Minamata, en tout cas dans sa formation d’origine.
N.B. : De nombreuses formations industrielles emploient d’ailleurs une imagerie totalitaire dans leurs productions et ce pour plusieurs raisons. Que pensez-vous de cet aspect qui traverse l’ensemble du mouvement ?
J.-Y.M. : Je dirais qu’il y a plusieurs « écoles » et que chaque projet suit sa propre stratégie. Lorsque des artistes s’expriment avec une telle violence, un tel engagement et un tel jusqu’au-boutisme, il y a forcément des éléments personnels très forts. La musique et la scène deviennent comme une sorte de thérapie. L’imagerie totalitaire, celle de la Seconde Guerre mondiale et les symboles du Troisième Reich sont récupérés à cette période pour choquer et faire réagir. À l’image des croix gammées arborées par le mouvement punk en 1977. Bien entendu, l’esthétique nazie a influencé cette scène avec son décorum, ses uniformes, l’art de la mise en scène, sa propagande savamment calculée, la manipulation de la pensée et des masses. Cependant il ne faut pas se tromper. Toute cette violence qui s’exprime dans cette musique et sur scène est aussi le reflet de la violence qui s’exerce sur les individus, mais aussi au sein de notre société. On peut considérer que c’est un acte salvateur d’extérioriser cette rage en relation avec son propre vécu. Ensuite, tout est dans l’ambiguïté de la démarche et il n’est pas facile de faire le tri en étant juste. Il faut prendre du recul et le temps de l’analyse. Certains sont dans la provocation. D’autres relèvent d’une certaine naïveté et enfin quelques-uns sont beaucoup plus complexes et impliqués en laissant libre court à l’interprétation. Par exemple avec Test Dept., on comprend très vite le parti pris et le sens du message et de la lutte. Les membres de Test Dept. sont issus de cette classe populaire qui subit de front la politique des conservateurs anglais. Pour d’autres, le libre arbitre me laisse comme un sentiment de malaise et à défaut m’amène à prendre de la distance. C’est en tout cas la démarche qui m’a guidé pour piloter le label Les Nouvelles Propagandes. Ne pas rentrer dans ce jeu de l’ambiguïté. Ainsi, la première production outre celles des membres du label fut le live avec un entretien de Test Dept. : Europe (1987).
Ce qui t’influence et te construit, ce sont les rencontres. Et pourtant, dans les années 1980, elles sont plutôt rares. Je me souviens très bien de nos rencontres avec les membres de Test Dept. C’est vraiment la force collective qui nous a impressionné, avec cet engagement militant. Quelques années plus tard, j’avais comme projet la sortie d’une double cassette de Death in June. J’adorais cette cold wave minimale des premières années avec cette basse très en avant et c’était l’opportunité d’une autre orientation pour le label avec un groupe reconnu. Cependant, toutes les références bien cachées sur chaque disque me laissaient perplexes, tout comme les prestations sur scène. On s’est rencontré deux soirs de suite avec Douglas Pearce, à l’issue des concerts parisiens au Café de la Danse et le courant n’est pas passé. Je n’arrivais pas à trouver une cohérence avec les autres productions du label. Death in June, à l’exception d’une fascination pour la Seconde Guerre Mondiale, n’avait rien d’un groupe impliqué dans les musiques industrielles. Certes, j’ai sans doute raté une bonne occasion de faire « connaître » le label, mais avec le recul et tout ce qui entoura Death in June par la suite, je n’ai aucun regret.
J’ai plus récemment croisé Boyd Rice lors d’un festival en Pologne. Je dois avouer que je le connaissais juste de nom et je n’ai jamais écouté le moindre morceau de NON et de ses autres projets. Ignorance coupable ? Il était la tête d’affiche et sa performance avait été très approximative, improvisée, pour ne pas dire décevante en se moquant du public. Cependant, c’est un personnage qui dégage vraiment quelque chose de particulier, avec une allure naturelle marquée et un sens poussé de la séduction dont il joue avec son auditoire. Mais j’ai été surpris par son isolement, volontaire ou pas, en backstage et en aftershow. Le lendemain, il était seul au petit déjeuner, les autres musiciens visiblement ne souhaitant pas partager sa table. Je lui ai demandé si je pouvais m’installer. On a discuté de tout et de rien, de son voyage en Europe, de ses prochains concerts, etc. Pour terminer, je lui ai demandé si hier soir il n’avait pas oublié ses instruments. C’était un brin provocateur et il m’a répondu par un sourire malicieux en me disant que ses bagages étaient restés à l’aéroport…
Souvent on me demande quelle est l’influence de Throbbing Gristle et de Genesis P-Orridge sur cette scène et dans mon approche musicale. Je suis mal placé pour en parler car je n’arrive pas à écouter Throbbing Gristle, ni à rentrer dans cet univers. J’imagine que cette influence sur cette scène est réelle, Genesis P-Orridge n’ayant pas atteint sans raison cette légitimité au cours de toutes ces années avec toute l’excentricité, le délire et la folie qui le caractérisent. Mais vraiment, lorsque nous avons débuté au début des années 1980, Throbbing Gristle ne représentait pas un incontournable contrairement à Cabaret Voltaire par exemple.
La Nomenklatur, Asile De Nuit, Les Nouvelles Propagandes (1988), cassette audio.
N.B. : Le rapport à la folie est d’ailleurs très important dans le parcours de certaines formations, comme SPK ou bien même La NomenKlaTur avec l’album Asile de Nuit (1988).
J.-Y.M. : La cassette Asile de Nuit est spécifique à son auteur et le titre n’est pas dû au hasard. Comme je le disais plus tôt, la musique constitue souvent une thérapie et s’inscrit dans son histoire personnelle. Pour SPK, c’est certain que le vécu de ses membres dans l’univers psychiatrique orienta les premières années du groupe. La majorité des morceaux restent marquant et ce dans des styles différents. J’ai une préférence pour Zamia Lehmanni: Songs of Byzantine Flowers (1986), qui prend pourtant une orientation différente par rapport aux origines, même si j’adore Leichenschrei (1982) ou encore Auto-Da-Fé (1983). J’ai trouvé impressionnante également la vidéo Despair (1982) qui était un travail unique à l’époque et qui a eu une grande influence pour beaucoup de groupes. Un morceau comme « Germanik » (1979) par exemple est caractéristique d’un parti pris autoritaire et totalitaire avec ses slogans scandés. L’ambiance est concentrationnaire. Quand on étudie comment furent structurés les camps de concentration et d’extermination, on réalise comment tout ceci a pu se produite sur la base de la désinformation, de la manipulation et du rapport de force. Ce rapport de force entre deux-mille Allemands et des dizaines de milliers de prisonniers est pourtant disproportionné. Cependant, la manipulation mise en place fonctionne et c’est là où toute la « puissance » d’un régime totalitaire prend forme. La pression physique et psychologique est extrême et brise la grande majorité des individus en peu de temps. La faim, le froid, la peur, la privation de sommeil, l’humiliation et la privation d’identité en sont les principaux ressorts. C’est une construction qui dépasse l’entendement. Et beaucoup de ces principes sont repris et reproduits par les musiques industrielles pour exposer tout ce qui nous dépasse et tout ce qu’on ne veut pas voir, ni entendre. C’est au-delà de notre compréhension, de notre éducation et pourtant cela a existé et continuera d’exister. C’est le propre de l’espèce humaine, qui a la capacité à générer ses propres monstres et sa propre destruction. Les musiques industrielles ont montré ce que chacun veut ignorer et ne pas percevoir de son être propre, lorsque celui-ci est mis dans des conditions extrêmes.
N.B. : Est-ce que certaines de ces formations ne se sont pas faites piéger par cette iconographie totalitaire, dès lors qu’ils diffusent leurs visuels au sein d’un public qui est aussi constitué d’auditeurs et de spectateurs très jeunes dans les années 1970 et 1980 ?
J.-Y.M. : C’est évident. Certains, comme les membres de SPK étaient provocateurs en live autour de thématiques singulières : le corps malmené et l’horreur des visuels qu’ils projetaient. Ils voulaient montrer l’insoutenable et créer le malaise. Ensuite, quelle est la part du message politique ou idéologique et de l’esthétique ? C’est plus compliqué. Les musiques industrielles ne sont pas en général des musiques à textes et accentuent l’aspect visuel à travers des projections, clips, couvertures et designs. Ce qui rend le décryptage plus complexe. D’un point de vue personnel, ce qui a fait du tort aux musiques industrielles, ce sont tous les groupes qui ont eu leur heure de gloire durant les années 1990 et au début des années 2000 en jouant sur l’ambiguïté et en recyclant les concepts des premiers groupes sans pour autant y apporter quelque chose de nouveau. Ce sont les suiveurs des précurseurs. On pense faire du neuf avec de l’ancien. Certes commercialement ce fut plutôt rentable. Ils ont leurs inconditionnels, mais j’ai vu des attitudes très sectaires. J’ai eu l’impression que les musiques industrielles ne parlaient plus que d’une seule voix, alors qu’aujourd’hui elles sont multiples. Cette période marque également un retrait de quelques années des activités du label Les Nouvelles Propagandes, puisque je ne me retrouve plus dans les fondamentaux de cette scène. Aussi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler avec pertinence.
N.B. : Il y a une différence du point de vue de l’héritage historique de chaque pays aussi…
J.-Y.M. : C’est certain que chaque pays doit prendre en compte son héritage culturel et historique. En Angleterre et aux États-Unis, il y a une culture de la performance et de la provocation qui fait partie du paysage. L’Allemagne, avec son passé, reste prudente. En France, on est très conservateur côté musique et spectacles : les lives sont rares. Il y avait bien à Paris un lieu de contre-culture avec Les Établissements Phonographiques de l’Est (EPE), qui permettra à un nombre important de formations de se produire. À noter les belles initiatives à Bordeaux avec le festival « Divergences/Divisions » également, orchestré par André Lombardo, ainsi que les « Rencontres trans musicales » de Rennes. Einstürzende Neubauten va choquer à Paris au Forum des Halles en 1983 en « jouant » du marteau piqueur, de la disqueuse et de la bétonnière, tout en martyrisant quelque peu l’espace scénique.
De mémoire, c’est sans doute SPK qui est allé le plus loin sur scène lors de ses performances. Sinon, comme terrains d’expressions variées, il restait les fanzines, nombreux à l’époque, les couvertures des productions et les radios libres. Dans les années 1980, nous étions quelques-uns à avoir un créneau de radio. Je me souviens de l’émission de Tiburce, « Hauts Fournaux », sur une grande radio à Tours qui était un véritable espace d’expérimentation.
Minamata, Niigata (1984), clip vidéo, couleur, sonore, 4’40’’.
N.B. : Les performances de La NomenKlaTur étaient aussi l’occasion de montrer des clips montés par le groupe. Pourriez-vous revenir sur le contexte de production de ces clips et sur votre rapport à l’image en mouvement ?
J.-Y.M. : La technique était la plupart du temps du collage d’archives en sortant les images de leur contexte d’origine afin de donner un autre sens en rapport avec le thème du morceau. C’est donc beaucoup de récupération sur la technique du montage et du collage. De plus, comme on avait peu de moyens, la technique utilisée pour l’image est la même que pour le son, à savoir beaucoup de re-recording à partir d’une caméra et d’un écran de télévision. On rajoute alors avec la dégradation un grain particulier, et en déréglant le téléviseur qui est filmé on obtient des effets particuliers comme des saturations de couleurs, de contrastes, de balayages. Il arrive qu’au final on ne reconnaisse plus l’image initiale, ce qui en soit est aussi un objectif. Les premiers clips de Minamata et de La NomenKlaTur furent construits sur ce modèle. C’est vraiment de l’artisanat et de l’expérimentation. Cependant, le procédé n’est pas nouveau, il faut bien l’admettre. En fait peu d’images viennent de séquences filmées, ou alors elles sont très courtes pour ensuite être montées en boucle et traitées avec des effets différents comme pour le clip de Minamata (Niigata).
La NomenKlaTur, La Légende Des Voix (1986),
Les Nouvelles Propagandes, cassette audio.
Cent Ans De Solitude, Les Enfants De L’Oubli (1987),
Les Nouvelles Propagandes, cassette audio.
Sønntag, Le Tambour (1987),
Les Nouvelles Propagandes, cassette audio.
La technique du collage est aussi utilisée pour les pochettes des productions K7 comme Minamata avec Niigata (1986), La NomenKlaTur avec La Légende des Voix (1986), Sønntag avec Le Tambour (1987), ou bien Cent Ans de Solitude avec Les enfants de l’oubli (1987). La projection de diapositives accompagne aussi les quelques spectacles entre 1985 et 1992 avec un procédé de conception identique. Soit une photo prise à partir d’un téléviseur, soit à partir d’un écran de projection. L’utilisation de plusieurs projecteurs réglés différemment permettait des superpositions suivant le principe des claques. Une technique empirique et artisanale bien avant que l’informatique ne transforme toute ces étapes de création visuelle. Le tirage des négatifs subissait également quelques contraintes et pouvaient s’assimiler à des filtres comme l’utilisation de bas, de colle, de pochoirs, etc. Tout comme pour la musique, il fallait pouvoir créer avec peu de chose.
N.B. : Il me semble que l’on voit des images d’archives dans le clip Meosta (1989) de La NomenKlaTur ?
J.-Y.M. : De mémoire, Meosta se base sur de l’image de synthèse que Tiburce utilisa plus tard vers le milieu des années 1990. Il s’agit de la répétition d’un plan animé qui représente le buste de l’un de nos amis musiciens, qui avait produit le split LP Brume/La NomenKlaTur en 1989. L’emploi d’images d’archives se retrouve aussi dans les clips Extrem.O et Leni Riefenstahl. Pour le premier, il s’agit de plans de guerre en particulier des tirs de canons montés à la vitesse de la boite à rythmes. Pour le second, c’est un montage de séquences extraites des films de la cinéaste ou de documentaires.
La NomenKlaTur, Meosta (1989), clip vidéo, couleur, sonore, 7’02’’.
N.B. : Avez-vous gardé une trace des photos que vous avez réalisé durant cette période pour ces projets ?
J.-Y.M. : Tout à fait. Ces photos constituent pour la plupart nos archives et celles du label. C’était une période de liberté où tout était possible avec une absence de codes établis. On se disait qu’il fallait aller le plus loin avec ce que l’on avait sous la main. Bien entendu, le hasard, comme dans toute expérimentation, jouait un rôle important, même s’il fallait aussi savoir le provoquer.
N.B. : La technique du cut-up est aussi liée au hasard. Est-ce que les écrits de William S. Burroughs ont eu une influence dans votre parcours ?
J.-Y.M. : Pas du tout. Pour la simple raison que je ne connais pas William S. Burroughs. J’en ai appris un peu plus récemment, en visionnant le film de David Cronenberg, Le Festin Nu (1991). Ce que j’aime chez Burroughs c’est le son de sa voix. Dernièrement, j’ai repris « The Last Words of Hassan Sabbah » sur l’un de mes titres pour lequel je cherchais des voix : j’ai déstructuré le contenu du morceau afin de prendre uniquement les bouts de phrases qui m’intéressaient, changeant ainsi le sens du texte d’origine. Pour tout te dire, je ne suis pas sensible à l’univers de Burroughs. À cette époque, Tiburce était très influencé par Artaud, Sartre et Céline, d’autres par Huysmans, Rémy de Gourmont, Lautréamont, Bataille, Joyce, Mishima… Pour ma part, mes affinités étaient beaucoup plus classiques avec la littérature française, européenne et les écrivains de l’est ainsi que du Japon. J’ai une formation scientifique et j’ai besoin que les choses s’installent par briques logiques sans brûler les étapes. Selon moi, c’est ce qui permet de construire l’esprit critique afin de ne pas se laisser illusionner par les prestidigitateurs. Je vais sans doute te surprendre, mais j’ai un passé de musicien classique. Après une bonne douzaine d’années d’études, j’ai considéré que j’étais un bien piètre interprète. Aussi, j’ai tout arrêté : j’ai vendu les instruments et j’ai décidé de faire de la musique comme si je ne l’avais jamais apprise. Malgré tout, je reste un passionné de Jean-Sébastien Bach par exemple et des compositeurs baroques qui ont vécu à une période formidable où il y avait presque tout à inventer. J’ai essayé de retranscrire mon propre ressenti musical dans un domaine où je n’avais pas de repères, en essayant d’être créatif à travers une sorte de théâtre de l’imaginaire et ce avec cette distanciation vis-à-vis de l’auditeur ou du spectateur.
Cent Ans de Solitude, 6 novembre 2015, « Wrocław Industrial Festival », Wrocław.
Photographie de Virginie Vancayezeele.
N.B. : À quoi ressemblait la scène industrielle en France dans les années 1980 ?
J.-Y.M. : Ma perception est qu’il était bien difficile d’identifier une scène industrielle en France. À cette époque, c’était vraiment des musiques de traverse très marginales. Cette scène française n’était pas ou peu structurée et subissait l’influence des musiques anglo-saxonnes. J’ai le sentiment que chacun était assez isolé. On se connaissait peu et il n’y avait pas beaucoup de connexions. C’est peut-être la raison pour laquelle chacun arrivait à créer sa propre identité. Il y avait ceux qui pouvaient sortir des disques comme Pacific 231, Die Form, The Grief ou Prima Linea. Quelques rares labels comme Sordide Sentimental qui réalisa de magnifiques productions, mais avec un tirage trop confidentiel. Ceux qui se lançaient dans l’autoproduction ou les collectifs. Et enfin, les compilations et les fanzines. C’est sans doute ces derniers qui amenèrent le plus de cohésion à cette scène : ils véhiculent à la fois l’information et tissent les liens entre plusieurs mouvement musicaux (rock alternatif, musique expérimentale et industrielle), permettant aux groupes de se connaître. À l’époque, tout s’effectuait par courrier. Il fallait prendre le temps d’écrire, de poster son pli et d’attendre la réponse. Et pourtant, c’était un processus qui fonctionnait vraiment bien. Il y avait une vraie curiosité et une excitation à ouvrir sa boîte aux lettres. La pratique de l’échange, qui est un acte de confiance, est aussi un vecteur qui participe à la connaissance au sein même de cette scène. Il existait une scène parisienne alternative, mais la majorité était éparpillée à travers toute la France. On s’en rend compte en lisant les contacts qui figurent sur les nombreuses compilations. Chacun organisait donc son autopromotion avec sa propre distribution et son réseau. Le catalogue de distribution Front de l’Est situé à Amiens et dirigé par Gilbert et Marie-José Deffais a été un trait d’union très important de mon point de vue pour développer cette scène. Gilbert était un membre du groupe de cold wave minimale Guerre Froide qui influença toute une génération avec son titre le plus connu « Demain Berlin ». Son catalogue était énorme : il intégrait toutes les autoproductions new-wave, rock minimaliste, expérimentales et toutes les composantes de la scène industrielle naissante. Il couvrait les productions de l’Europe entière mais aussi celles des États-Unis et du Japon. Il permettait à tous les petits labels de trouver une porte de diffusion. Front de l’Est fut vraiment un précurseur et un vecteur d’initiatives. On ne le dira jamais assez.
Front de l’Est, catalogue n° 5, 15 octobre 1985.
Front de l’Est, catalogue n° 6, 23 janvier 1987.
Les Nouvelles Propagandes ont débuté en 1985 avec le support de Front de L’Est et du magasin New Rose à Paris. Sans eux, rien n’aurait été possible. Il faut dire que New Rose n’avait pas vocation à s’intéresser à la scène industrielle. On y trouvait toute l’actualité du rock anglais principalement et les autoproductions des groupes de rock français. Mais c’était une structure très ouverte, à l’initiative de Philippe Marie, et un petit espace de vente (une vitrine proche du comptoir et des bacs avec des 45 tours) était réservé aux productions indus’. C’est ainsi que tout est parti pour le label, pour ensuite s’étendre aux Allemands d’Artware, aux Néerlandais de Staalplaat, aux Suédois de Cold Meat Industry et à RRRecords aux États-Unis pour ne parler que des plus important dans le milieu. Pour l’anecdote, quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un jour une lettre du distributeur japonais Neds Planning qui voulait des cassettes de Minamata. Il y eu aussi d’autres acteurs comme ODD Size (Paris), Danceteria (Lille et Paris) et les Disques du Soleil et de l’Acier (Nancy). Et enfin Nuit & Brouillard, qui fut incontournable et reconnu durant de longues années, et aujourd’hui encore.
Parler de la scène industrielle à cette époque est sans doute une extrapolation. Tout comme ensuite on parla de la scène de Tours. Certes il y avait la volonté de quelques-uns de faire bouger les lignes et de permettre une écoute musicale différente de celle imposée par les majors. Mais vraiment, c’était marginal. Les magasins Vinylium et Jazz Rock and Pop à Tours nous ont soutenu nous donnant ainsi l’impression d’exister, mais ces démarches restaient très limitées.
Si une véritable scène industrielle avait existé, il y aurait eu plus d’évènements, de performances, de festivals… Sauf omission de ma part, ce fut très rare. Parfois, un groupe classé « indus » complétait une affiche, mais rien de plus. Comme par exemple pour Minamata lors du festival « PsyKoSonotok » à Tours en 1985, ou encore NOX aux Nuits de la Saint-Vitus à Paris à l’automne 1984 – à noter que cette performance, trop courte, avait été remarquable. Et les groupes étrangers connus ne venaient que rarement en concert à Paris, qui ne comptait à l’époque qu’une majorité de grandes salles et peu de petits clubs plus adaptés à cette scène.
N.B. : C’est aussi une scène composée d’artistes informés, qui se documentent sur les différents mouvements artistiques et littéraires…
J.-Y.M. : On a tous entre dix-huit et vingt-cinq ans et une certaine révolte contre l’establishment, contre la culture de nos parents. On ne veut pas ressembler à cette petite bourgeoisie des années 1970. Des artistes informés ? Je n’en sais rien. En tout cas des personnes qui n’acceptent pas les standards que l’on nous infuse depuis des années. Une jeunesse qui veut se prendre en main et ne plus être guidée dans ce qu’elle doit faire. Attention, tous ne sont pas pour autant des rebelles : ceux de mai 68 sont déjà tous embourgeoisés. Juste aspirer à un mode de vie différent, hors de la dictature des censeurs. Si informé signifie une curiosité, une ouverture d’esprit, une envie créative sans barrières ni tabous, alors effectivement je dirais que cette scène était informée. Maintenant, il faut aussi se remettre dans le contexte de l’époque. L’information ne circule pas à la vitesse de la lumière et tout ce qui est novateur met du temps à arriver. D’autant plus lorsqu’on n’habite pas dans les grandes capitales. Mais en tout cas on partage tous une soif de découverte pour l’art, la littérature, le cinéma et bien entendu la musique et ses expressions diverses. Cependant, en lisant certains entretiens, je suis parfois surpris des références culturelles ou artistiques sur lesquelles s’appuient certains pour justifier de leur musique vingt ou trente ans plus tard. Ils laissent penser que le mouvement des musiques industrielles est un mouvement pensé, réfléchi, intellectualisé… Je ne vais pas me faire que des amis, mais je trouve alors que ceux-ci réécrivent l’histoire. J’ai perçu de cette période, en France en tout cas, un élan très spontané, une envie vitale irrépressible de créer sans pour autant se soucier d’appartenir à un mouvement, une tendance, de s’inscrire dans l’histoire. Il fallait faire quelque chose, s’exprimer, crier, créer, casser, détruire, jouer, inventer, expérimenter… Chacun l’a fait à sa manière. Et c’est bien là l’essentiel. Alors laissons à ceux qui sont autorisés le soin de trouver des connexions avec les futuristes, les surréalistes, les dadaïstes, les constructivistes, les suprématistes et j’en passe… Comme l’écrivait un étudiant de l’Ecole Populaire de Vitebsk en réponse au manifeste d’Ivan Pouni glorifiant le futurisme : « …tous ces "ismes" dans l’art s’effondreront et disparaitront de l’horizon ».
N.B. : Peut-on parler de culture industrielle ou de contre-culture industrielle ?
J.-Y.M. : C’est compliqué car de nombreux faisceaux partent dans toutes les directions que personne ne rassemble. Pour constituer une culture, il faut une unité. Effectivement, certains artistes, souvent issus des écoles des Beaux-arts par exemple, apportent des concepts artistiques aussi bien par des réalisations graphiques qui illustrent leurs productions qu’au travers des livrets et des textes qui les accompagnent. D’autres s’intègrent au mouvement « Industrial Music for Industrial People » et perpétuent la démarche des pionniers suivant leurs aspirations et leurs moyens. Mais beaucoup ont cette envie viscérale d’expérimenter, de créer et d’ouvrir de nouveaux horizons musicaux et artistiques : un synthétiseur analogique n’est désormais plus réservé qu’au petit groupe de l’IRCAM à cette époque. Je dirais que cette culture industrielle ou contre-culture industrielle s’est exprimée principalement par l’intermédiaire des fanzines, des compilations cassettes et de l’autoproduction.
N.B. : Comment avez-vous découvert cette scène expérimentale ?
J.-Y.M. : Il faut rappeler un point important avec l’élection de François Mitterrand en 1981, qui libère les ondes radiophoniques et amorce le phénomène des radios libres. C’est un vent d’espoir pour toute la jeunesse. Comme je l’ai dit précédemment, c’est un nouvel espace de liberté. Dans le courant de l’année 1982, j’ai la chance d’avoir une émission de radio d’une heure et demie. C’est l’opportunité de passer la musique que j’aime : en général des groupes anglais issus du punk, de la new-wave et ses différentes tendances. On a alors l’impression modestement d’être le relais local de Bernard Lenoir, pendant français de John Peel. Il nous a tous inspiré par son éclectisme, tout comme Antoine de Caunes avec l’émission « Chorus », puis « Les Enfants du Rock ». J’ai toujours en tête l’ouverture d’une émission en mai 1980, vers 22h, où il débutait par cette phase : « Triste nouvelle, les gars, Ian Curtis est mort. » Chaque semaine, il fallait se tenir au courant. Alors rien de tel que de lire New Musical Express et Sounds. Avoir une émission permet aussi de recevoir pas mal de singles en promotion. Pour compléter l’ensemble, il reste les fanzines comme par exemple le fanzine parisien New Wave. On a ainsi de quoi occuper son temps d’antenne et tout se met en place par petites touches. Trouver les groupes ou le morceau que les autres ne passent pas devient un défi, ou tout du moins un enjeu. C’est ce qui assure également la fidélité des auditeurs. Chercher et encore chercher permet de s’ouvrir à de nouvelles sonorités, de nouvelles tendances. Il faut dire qu’à l’époque, à Tours, on était pas mal challengé sur la place locale par notre ami Jean-Daniel Beauvallet, qui par la suite deviendra rédacteur en chef du magazine Les Inrockuptibles.
L'artiste Cosey Fanni Tutti en couverture du fanzine New Wave.
Être dans une radio libre permet d’avoir accès à des équipements comme des consoles de mixage, des micros, des chambres d’écho, des enregistreurs… En fait, des éléments qui rentrent dans le cycle de la production musicale. Ensuite, une certaine routine s’installe et l’envie vient de créer des émissions d’un genre différent en arrêtant de coller à l’actualité musicale. Ce sont les émissions que j’appelle à thèmes et dans lesquelles il faut mettre beaucoup plus de soi-même car il faut les écrire. On doit alors s’intéresser à des musiques moins rock, réaliser des interviews, récupérer des extraits d’actualité, procéder à des collages, rechercher des fonds sonores d’ambiance, etc. Alors le pli est pris et c’est l’opportunité de s’ouvrir à d’autres horizons musicaux. On fait aussi des petits jingles de quelques secondes, un peu plus longs à chaque fois. J’avais la chance de pouvoir bénéficier d’un studio d’enregistrement pour préparer mon émission et les choses se sont mises en place de cette manière par petites phases successives. Aussi, je ne peux pas dire que je suis tombé dans les musiques industrielles d’un seul coup. Ce fut un apprentissage dans la durée, par l’expérimentation. Mais s’il y a un fait déclencheur qui me revient en mémoire c’est celui-ci : le groupe Minamata m’avait demandé de faire sa technique de scène pour son premier concert. J’avais bien écouté les premières cassettes mais je me trouvais encore au milieu du gué entre le rock et l’indus’. J’arrive pour faire le sound check et là, je suis resté scotché par ce que j’ai alors entendu dans cette salle vide derrière la console. Notamment les cris de Marie, qui était alors la « hurleuse » de Minamata avant de s’impliquer plus tard dans Sønntag, son projet personnel. L’engagement du groupe était total et je me suis dit qu’il se passait alors quelque chose. En tout cas me concernant.
N.B. : À quel moment commencez-vous à enregistrer des sons en usine ?
J.-Y.M. : À l’époque où je travaillais en usine en 1981. Il y avait tout un tas de sonorités qui m’intéressaient.
Cependant, les enregistreurs ne sont pas vraiment compacts à l’époque et c’est compliqué. Aussi, il ne me reste rien de qualité. J’ai repris des années après. Un peu partout : sur des chantiers, des gares, des garages, des entrepôts, dans la rue, le métro, les parkings souterrains, les aéroports, etc. Lorsque vous faites du béton avec une bétonnière par exemple, c’est une succession de bruits différents qui vous arrivent aux oreilles. C’est juste une question de vigilance et une manière d’écouter le « bruit ».
N.B. : Ce rapport aux radios libres interroge également le caractère indépendant de la scène industrielle. Pourriez-vous revenir sur la nécessité de créer votre propre label avec Tiburce durant ces années ? Cet aspect accompagne d’ailleurs la façon dont vous vous libérez de votre formation de musique classique en un sens…
J.-Y.M. : Je dirais que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. La radio libre donne des initiatives et montre les domaines du possible. Ensuite, ce sont les événements qui font que tout se fait, ou ne se fait pas. À la suite de sa première session d’enregistrement, Minamata disposait grossièrement du contenu d’une cassette. Celle-ci est envoyée au fanzine New Wave qui éditait également des groupes. À la surprise des auteurs, le retour est enthousiaste et le label New Wave sort la cassette Mit Lautem Geschrei (1984). Cependant, le contrat de redistribution des droits n’est pas respecté. New Wave rencontre des difficultés financières et ne peut tenir ses engagements. C’est le premier déclencheur d’où tout va partir. Cette expérience encourage le groupe qui enchaîne avec une seconde cassette : Methylmercure (1985). Le nouveau fanzine Europa – un excellent fanzine de grande qualité qui, malheureusement, durera peu de temps – séduit par la première cassette, propose de sortir Methylmercure au début de l’année 1985. Une fois encore, les engagements initiaux ne sont pas tenus. Dans la foulée, une troisième cassette est prête : Niigata (1986).
Minamata, Mit Lautem Geschrei, New Wave Records (1984), cassette audio.
Minamata, Methylmercure, Europa (1985), cassette audio.
Minamata, Niigata 1964-1965, Les Nouvelles Propagandes (1986), cassette audio.
Alors tout naturellement la solution de l’autoproduction se présente sous la forme d’une association de loi 1901. Tiburce, qui est juriste, en rédige les statuts et le label voit le jour en juillet 1985. C’est l’occasion de monter un collectif, de mettre en commun les moyens dont nous disposons, de se répartir les rôles… bref, d’exister. Monter un label de production sur cassette est assez courant à l’époque. La production n’est pas onéreuse et le risque reste mesuré. Ce qui n’est pas du tout la même chose avec la production de vinyles, puis plus tard de disques compacts. Ce sont aussi des années de grand enthousiasme, car comme j’en parlais précédemment, nos productions rencontrent un auditoire. Les projets se succèdent malgré les tensions qui existent au sein des membres de Minamata et à ce moment-là les expressions deviennent plurielles. Chacun participe au projet des autres et apporte sa contribution et son soutien. Je conserve un souvenir très fort et presque nostalgique de l’année 1987 avec la sortie de cinq productions majeures du label : La NomenKlaTur (Être et Durer), Sønntag (Le Tambour), Cent Ans de Solitude (Les Enfants de l’Oubli), Minamata (Résiduel) et Test Dept. (Europe). Le label prenait un véritable essor. C’était quelque chose d’incroyable de préparer les commandes vers plein de destinations différentes car en plus, nous avons toujours été plus diffusé à l’étranger qu’en France. La suite fut plus compliquée, car les circonstances de la vie font que les enthousiasmes s’amenuisent petit à petit, que les aspirations évoluent et que le sens du label n’est plus le même pour tous. Un proche, Eric Lacasa accompagne le label quelques années avec notamment une compilation intitulée Cénotaphe (1991), mais au début des années 1990, je me retrouve donc seul avec la volonté de perpétuer cet idéal de jeunesse. Et le label trace toujours son chemin.
La NomenKlaTur, Être Et Durer,
Les Nouvelles Propagandes (1987), cassette audio.
Je ne dirais pas que la création du label m’a libéré de ma formation musicale initiale. C’est quelque part un héritage culturel, quelque chose qui est en moi et qui me sert inconsciemment. La libération est venue avec la réalisation de ma première cassette Les Enfants de l’Oubli, en quelque sorte. C’était une manière de dépasser les contraintes de cette formation et de trouver une liberté pour expérimenter et m’exprimer. Un moyen aussi de me prouver que c’était possible.
N.B. : L’élaboration d’un label indépendant dans les années 1980 diffère des modes de production et de diffusion actuels de la musique alternative. Pourriez-vous revenir sur ce contraste, à l’heure d’une dématérialisation sonore globalisée ?
J.-Y.M. : L’époque est différente. Les médias de diffusion également. Tout comme le nombre de groupes. On dupliquait alors nos cassettes nous-même, on découpait les jaquettes, on collait, on conditionnait, on packageait, on expédiait, etc. C’était de l’artisanat et c’est toujours le cas actuellement pour les productions des Nouvelles Propagandes qui sont encore reproduites suivant les masters de l’époque. Les auditeurs peuvent toujours se procurer des cassettes réalisées voici presque trente ans. Je suis de l’ancienne génération. Celle qui était persuadée que l’on existait effectivement au travers d’un support matériel. On mettait sa touche dans le conditionnement, la jaquette, la pochette. On avait plaisir à toucher l’objet, à le découvrir, le décortiquer, l’écouter et le réécouter, à chercher les détails cachés, etc. Aujourd’hui, tout doit aller plus vite, être disponible tout le temps, partout. Il faut donc s’adapter. Cependant, quand on ne cible pas un auditoire de masse, la production de supports matériels est toujours possible. Il faut que l’objet soit original, beau et sorte de l’ordinaire. Voici quelques temps, quelqu’un m’a acheté la cassette Les Enfants de l’Oubli car il voulait juste l’objet. Il n’avait pas de lecteur cassette. C’est un peu frustrant car on veut aussi faire connaître sa musique. Cependant, il savait qu’il trouverait les titres sur Internet. Maintenant, que penser de la dématérialisation ? Il faut s’adapter aux nouveaux usages numériques qui vont très vite. La dématérialisation accélère la diffusion, mais pour autant elle limite les contacts entre le label, le musicien et son auditoire. Ou en tous cas, ils sont différents. J’ai comme l’impression de perdre la maîtrise de mes activités. Le CD, pourtant d’excellente qualité, est en fin de cycle, mais on le produit toujours car son prix de revient est faible. Le vinyle a repris du poil de la bête après une longue éclipse, mais pour combien de temps ? Et la cassette revient doucement. Alors quelle stratégie adopter ? Celle qui correspond à votre identité et à votre savoir-faire. On ne gagne pas d’argent avec un label et la satisfaction est de laisser parler sa passion. En fait, la vérité est sans doute dans l’utilisation adaptée de tous ces moyens de diffusion.
N.B. : Vous vous intéressez très tôt à la thématique du terrorisme avec Cent Ans de Solitude par exemple. Pourriez-vous revenir sur cet aspect ?
J.-Y.M. : Effectivement c’est le propos de l’un de mes tous premiers titres en 1986 : « Éclats de verre, éclats de vie ». Sans doute du reste un peu avant que ce thème ne devienne celui de prédilection du projet Muslimgauze de Bryn Jones. Les années 1980 sont marquées par quelques attentats retentissants en France, même si le 11 septembre n’était pas encore passé par là et qu’on ne vivait pas encore avec cette éventualité permanente. Ces attentats ne pouvaient pas laisser indifférent à cette époque. Le mode opératoire, cette violence sans visage, ces victimes anonymes, le hasard qui, à quelques secondes près, fait de vous un cadavre ou un spectateur sont impossibles à intégrer pour le commun des mortels. Ce titre basé sur une technique du collage témoignait d’une époque. Bien malheureusement le quotidien fournit des thèmes d’inspiration inépuisable. Je pars souvent de faits divers qui me marquent et me révoltent afin de les intégrer à une histoire que je mêle ensuite à des ambiances sonores et à des collages d’actualités.
Jean-Yves Millet, 2014, Lille. Photographie de Nazaré Milheiro.
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.