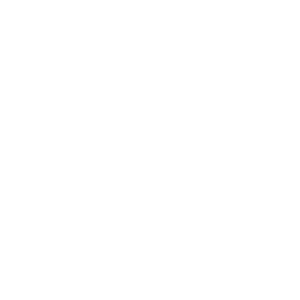RÉGIS CLINQUART « LE JOUR OU LES MÉTÈQUES ONT FINALEMENT BOTTÉ LE CUL DE L'AMÉRIQUE »
Enregistrement : Juin 2003
Mise en ligne : Archives de La Spirale (1996-2008)

Dans un peu plus d'une heure les flammes dévoreront en grognards jusque sur son bureau les portraits encadrés de sa femme et de ses deux garçons. C'est la photo d'Ellen qu'il tiendra à la main au moment de sauter par la fenêtre fermée, à choisir le feu ou le ciel tu vois, tu vois Simone comme tu fus injuste, tu vois je viens de faire un choix décisif, le vide plutôt que brûler vif, le néant plutôt que l'enfer ; c'est la photo d'Ellen qui se déchirera entre ses doigts quand il touchera terre ; c'est elle, elle mon gros porc mon bouc, qui plongera avec lui l'interminable chute reflétée dans les vitres, retransmise en mondovision et répétée, répétée sur tous les écrans de la planète plus que ne le fut jamais aucun exploit sportif, aucune balle battée à toute volée par quelque idole de stade qui aujourd'hui, comme tout le monde, assistera avec sidération à cet envol splendide, cette formidable défenestration.
Tôt le matin dans les grandes chiottes du hall 4, elle sème dans les urinoirs des boulettes de mie de pain, qu'elle récupère le soir gorgées de l'urine des voyageurs après un aller-retour Boston-L.A., L.A.-Boston, Boston-Seattle, Seattle-Boston que sais-je... et qu'elle mâche lentement, s'imprégnant de ces hommes anonymes au goût puissant, chargée alors de leurs destinations. Sonia (ce n'est pas son vrai prénom) est hôtesse de l'air.
Elle a repéré bien sûr le manège de cette femme très élégante, très maigre, plus âgée qu'elle et qui, une deuxième fois déjà se lève et quitte son siège en business class, fait provision de sandwichs à mi-parcours, puis va s'enfermer dans les toilettes du fond en classe éco. Serait-il possible que ce soit, elle aussi, une semeuse ?...
Dix minutes passent et la femme s'en revient très pâle, cadavérique ; Sonia (ce n'est pas son vrai prénom), Sonia pousse derrière elle la porte des toilettes. Nulle trace des sandwichs, le cabinet est propre, il sent le parfum cher.
En business, la dame mystérieuse se rassied les yeux rouges et Sonia, dont ce n'est pas le vrai prénom, l'observe comme un commerçant suspicieux un billet de banque.
Ce séminaire stupide ne lui apprendra rien, elle en a la certitude. Elle s'écoeure d'avance de la médiocrité crasse de ces comédiens loués par une agence d'événements, qui tâcheront certainement d'égayer une nouvelle posologie de coxibs, de faire sourire la visiteuse médicale exténuée qui a bien d'autres problèmes, trouver une crèche qui ferme tard, un nouveau mec qui ne la batte pas, faire réparer la bagnole ça va encore me coûter une fortune. Une deuxième fois elle quitte son siège, cette fois sans s'excuser, et comme précédemment ne s'arrête pas aux chiottes business, fait provision de sandwichs à mi-parcours, va s'enfermer dans celles du fond en classe éco. Puis elle revient les mains vides, regagne son siège à l'avant et on lui demande ça va, Anne ? Tu te sens pas bien ? T'es toute pâle...
Anne-Charlotte est directrice des ressources humaines d'une filiale française d'un grand laboratoire pharmaceutique. Elle s'est battue bec et ongles pour obtenir ce poste. L'attitude de sa société vis-à-vis des pays en voie de développement, eu égard au sida surtout, la révolte. Mais elle n'en dit rien. Deux mois par an, elle part en Inde où elle exerce l'activité de guide pour les touristes férus de trecking. Depuis quatre ans, elle s'investit dans un projet de commerce équitable permettant à un petit village, situé à 120 kilomètres de Delhi, de financer une école et une infrastructure d'irrigation. Entre deux entretiens d'embauche, et à n'importe quelle heure du jour, elle ferme à clé la porte de son bureau, entre dans le cabinet attenant, se met deux doigts dans la gorge et dégueule tout ce qu'elle peut. Après quoi elle enfourne à nouveau des quantités de bouffe astronomiques : fromages, glaces, charcuteries, pâtes froides, n'importe quoi et dans n'importe quel ordre. Puis elle se remaquille prestement et fait appeler le candidat suivant. La semaine dernière son médecin de famille l'a avertie de ce qu'elle pesait à peine quatre kilos de plus que le minimum vital pour une femme de sa taille, et qu'il faudrait peut-être envisager une hospitalisation. Elle s'inquiète et, chancelant presque de faiblesse lorsqu'elle redescend tard le soir l'escalier de la direction, continue cependant de se trouver trop grosse.
« Ca va, Anne ? », il répète comme si elle n'entendait pas. « J'ai peur en avion », ment-elle. L'autre la croit et cherche à la rassurer, se lance dans une longue explication : il y a beaucoup moins d'accidents d'avion que de train ou en voiture, etc., etc., elle le sait bien, elle ne l'écoute pas, elle pense qu'il faudra qu'elle y retourne.<.p>
Richard est sapeur-pompier. Il aurait préféré l'armée mais il appréhendait la condition qui y est faite aux noirs. Il n'aime pas qu'on parle d'eux, les noirs, comme de « coloured people ». Il y voit une sorte de capitulation du langage face au racisme, face à la connerie. Ses héros sont Charles Bronson, Clint Eastwood, Spike Lee. Il tient Martin Luther King pour une truffe. Eméché, il répète souvent qu'il « chie ce nègre ». Il pense que les femmes sont des putes mais que c'est la faute des hommes. Il envisage un jour d'écrire un livre sur le sujet, mais s'inquiète de ce que les écrivains sont tous des pistonnés et lui ne connaît personne dans l'édition, pas même un journaliste ou alors juste une pigiste du Wall Street Journal, qui l'a un jour interviewé parce qu'il était intervenu dans l'incendie d'une banque sur la Cinquième, dont on avait soupçonné d'abord qu'il était d'origine criminelle. Il l'avait revue, et lui avait fait part de son projet de bouquin. Evidemment elle ne l'avait jamais rappelé. C'était une femme, aussi, pourquoi lui aurait-elle filé ce coup de main à lui, et pour ce projet justement ?
Un jour il croisa dans un bar Leo di Caprio. Celui-ci refusa de lui signer un autographe. Il disait qu'il voulait « des vacances ». Richard pense que les stars sont méprisantes et qu'elles ne méritent pas ce qu'elles gagnent. Lui a risqué cent fois sa vie et même les femmes s'en foutent. Elles ne voient en lui que son gros nez de nègre et sentent sa sueur, une odeur âcre contre laquelle il ne peut rien. Richard n'en saura jamais rien mais dans quelques heures, quand on fera le décompte des survivants, il sera un héros, enfin.
Saloperie de climatisation. Combien de fois le leur a-t-il demandé ? Enculés de Philippins. Oui, oui, Monsieur, ce soir Monsieur. Vous êtes sûrs ? Oui oui Monsieur. Oui oui mon cul Monsieur, sûr qu'ils n'ont même pas compris ce que je leur demandais ces fils de pute, et ce matin c'est qui l'imbécile qui se retrouve à bidouiller cette saloperie de clim en carafe ? C'est bien la peine de faire partie du conseil d'administration. Et moi je ne supporte pas ça, ce bureau est climatisé, qu'on ne me dise pas qu'il est climatisé si ça ne marche pas. Je ne vais pas attendre deux semaines que ces putains de leur race de Philippins se décident à venir faire ce pour quoi ils sont payés. C'est ce que se dit Fabio en fourrageant rageusement entre les fentes de l'appareil récalcitrant du bout de son stylo plume, anticipant avec une anxiété perversement mêlée d'exaltation, le moment où le stylo à 259 dollars US se rompra, autorisant dès lors son imprudent propriétaire à laisser libre cours à sa colère, à son ressentiment.
C'est alors qu'il voit l'avion. D'ici, et par quelque bizarrerie de perspective, pense-t-il, on jurerait qu'il pique droit sur nous.
George fait devant la glace une grimace atroce. Non qu'il se plaise à faire l'idiot, mais il s'inspecte les gencives. George n'a pas bu une goutte d'alcool depuis près de quinze ans, mais il a gardé de sa longue descente éthylique, outre une haleine qui aujourd'hui encore fait détourner la tête des plus dévoués de ses collaborateurs, l'impression que ses dents pourrissent ; c'est pourquoi il se les brosse compulsivement, y déployant une folle énergie qui lui fait saigner les gencives. Costumé, cravaté, il se regarde et il se dit : « Tu es l'homme le plus puissant du monde, George. », pour ajouter presque aussitôt, mentalement toujours, mais rougissant de lui-même comme si quelqu'un l'avait surpris se livrant à quelque activité honteuse : « Le plus puissant après Dieu. » Il sait que c'est vrai, il aimerait que ce soit vrai. Il semble aussi un peu déçu : alors c'est seulement ça, être l'homme le plus puissant du monde ? semble l'interroger mine un peu dégoûtée l'homme gris dans le reflet. « J'ai la gueule de mon père. » Voilà ce qu'il pense, George. Il a la gueule de son père, George aussi. Même gueule, même prénom, même totale absence de charisme, il est devenu une initiale pour qu'on le distingue de l'autre, comme une maison surnuméraire coincée dans une rue qui ne l'attendait pas hérite d'un bis pour que les gens ne se trompent pas de porte. « C'est moi qu'ils ont élu à travers toi. », voilà ce que George le père a dit à George le fils le jour qui l'a vu devenir aux yeux de l'Histoire l'homme le plus puissant du monde ; après Dieu bien sûr, après Dieu.
L'homme le plus puissant du monde ce matin a la chiasse, il craint d'en lâcher une au tableau. Il craint le jugement de Dieu. C'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il s'est toujours dit quand on envoie à la potence, la chambre à gaz ou la chaise électrique, ou qu'on injecte la dose mortelle dans le bras crispé d'un condamné : ils devraient craindre le jugement de Dieu. C'est ce qu'il dira aux élèves, c'est un message qu'ils peuvent comprendre, qu'ils doivent comprendre, tout part en couille qu'est-ce qu'il fait là ?
Le téléphone sonne porteur d'une tragique nouvelle, un terrible accident vient de se produire, le premier avion vient de s'écraser sur Manhattan mais surtout un second ne répond plus rien quand on l'appelle, et il se pourrait bien que ce ne soit pas un accident ; le téléphone sonne porteur d'une excellente nouvelle, le téléphone sonne qu'Andy apparemment préoccupé tend à George qui n'en sait rien encore, porteur de l'excellente nouvelle, George va enfin pouvoir montrer au monde qu'il en est l'homme le plus puissant, et décimant le sarrasin enfin tuer cet encombrant papa, cet autre George trop timoré qui n'a pas su finir le travail.
Régis Clinquart
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.