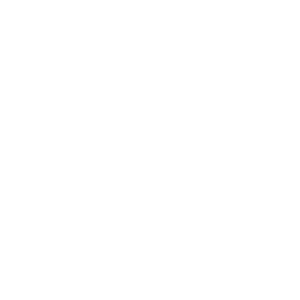RÉCIDIVE DE RÉGIS CLINQUART
Enregistrement : 29/07/2011
Mise en ligne : 29/07/2011

Habitué de la revue Bordel, Régis Clinquart a publié Moins qu'une pute suivi de Romance aux éditions Flammarion au printemps 2004, précédé d'Apologie de la viande en août 1999 aux éditions du Rocher. Nous attendons tous avec impatience la parution de son prochain roman, dont il y a fort à parier qu'il secouera le landernau de l'édition parisienne.

Un expresso. Un vrai expresso. Et un croissant. Et une tartine ? Oui. Fraise, abricot, les deux, confiture. Et un pain au chocolat. Et un chocolat chaud, aussi, avec le lait à part. Et un oeuf dur. Pas d'orange. Pas d'orange, non.
Ici mieux qu'en face, c'était le nom du bar situé jadis devant la prison de Fresnes, que notre époque plus sage en dépit de ses prétentions a rebaptisé d'une enseigne moins grinçante. Ce sont les premiers mots que lisaient en en sortant les condamnés ayant purgé leur peine, et l'histoire ne dit pas s'ils leur tiraient une larme ou un sourire. Peut-être bien les deux.
On pourrait croire qu'à peine sortis de l'enfer carcéral, les anciens détenus n'ont qu'une hâte : prendre leurs jambes à leur cou et mettre entre elle et eux le plus de distance possible. Les détenus, à l'intérieur, le croient aussi, prêtent foi à cette légende parée des atours du bon sens. En fait il n'en est rien. La liberté, ainsi recouvrée d'un coup, fait peur. Elle est énorme, intimidante, embarrassante, elle est une inconnue qui ne vous attend pas, bien au contraire. A plus d'un titre elle semble insaisissable. On croyait n'en être séparé que d'un mur et d'un écheveau de barbelés, mais quelques pas dehors suffisent à comprendre que l'extérieur n'est pas la liberté, qu'il va encore falloir l'y chercher, et que ça n'ira pas de soi, que cela va prendre du temps, demander des efforts, et que cette quête peut même échouer. Et c'est ainsi que la majorité des anciens taulards, qui ne sont anciens que de quelques minutes, comme un soldat en deux coups de tampon et quelques signatures augustes à l'armistice devient soudain un ancien combattant, se retrouvent à prendre leur premier café« libre » dans le bistrot d'en face, avec vue imprenable sur la prison qu'ils viennent juste de quitter.
Et moi, moi j'avais presque oublié le goût du vrai café. Cette royale amertume qui donnerait presque envie de tousser. L'arôme violent qui t'emplit la bouche et semble fouetter le sang, connecter des neurones. Le baiser moelleux de la crème. C'est bon. Je pourrais rester là des heures, à boire café après café. D'ailleurs je n'ai nulle part où aller. Personne n'est venu m'attendre. Un monstre, voilà comme ils me voient. Même ma mère. Ma mère surtout, en fait. Elle a dit que je lui faisais honte. Que si elle avait pu prévoir, elle se serait fait avorter.
Pourtant les coups, pourtant les longues heures passées enfermé dans le cagibi, les médecins l'ont dit à l'audience, cela n'a pas contribué à faire de moi un adulte très équilibré.
Je me souviens m'être dit, à l'énoncé du verdict :« Au fond, tout recommence comme avant. » Quinze ans. Douze effectifs. Les journaux ont dit que je ne ressentais rien, que je n'étais pas capable d'émotions. Ils se trompaient. Je m'étais déféqué dessus, et je ne voulais pas que ça se sache. Je me concentrais pour qu'ils ne devinent rien. Je m'étais chié dessus comme le petit Yoann ce jour-là.
« Mange ta merde. » C'est ce que m'ordonnait ma mère quand j'avais fait au lit.« Ce ne sont pas les enfants qui font caca partout. C'est les porcs, qui font caca partout ! Mange ta merde puisque tu n'es qu'un porc. » Et je mangeais. On me privait de nourriture tant que je n'avais pas mangé ma propre merde.
Le croissant imbibé pendouille, tout flasque dans le bol. Un bout s'est détaché, on dirait une vieille bite, ou plutôt une bite de zombie. Genre lèpre.
Deux heures que je suis là. Si j'avale encore une bouchée, j'explose. Je paye et je me lance comme on émerge d'un sas. Pour un peu je m'étonne de ne pas entendre le cliquetis du verrou qu'on tire derrière moi.
*
RER B je cherche en vain la fente dans la machine contrôlant l'ouverture du tourniquet. Une très jeune fille, peut-être une lycéenne, la fesse haute et l'air pimbèche, me passe devant en soupirant et effleure l'appareil avec son sac à main, déclenchant par magie un mécanisme qui lui libère l'accès. Je reste interloqué, mon ticket à la main, quand un rasta m'indique une machine voisine, pourvue celle-ci d'un composteur classique dans lequel j'introduis mon titre de transport.
Les panneaux indiquent Orly d'un côté et Roissy-Charles-de-Gaulle de l'autre. Et de m'imaginer braqueur déterrant mon butin pour m'envoler aux Bahamas ou aux Seychelles...
Mais non, bien sûr, quelle plaisanterie sinistre, je n'ai pour tout magot à déterrer qu'un noir opprobre, et encore quand je dis« déterrer »... il y aurait beau qu'on ne me le jette pas à la face. Ce n'était pourtant qu'un accident de parcours, une sortie de route, un dérapage incontrôlé. Ce n'était jamais arrivé avant, je n'aurais jamais pensé m'en prendre à un gamin, alors le désirer... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Littéralement. Je me vois le faire, précisément, mais c'est comme si ce n'était pas moi, comme s'il n'y avait là rien de réel, comme si c'était un rêve dans lequel je ne serais même pas engagé. Au fond même si je sais que c'est bien moi qui ai matériellement commis les faits, je reste persuadé que je n'étais pas moi-même, que cette part de moi qui a fait cela n'est pas moi. Les experts ont conclu que mon discernement n'avait pas été altéré pendant l'acte : qu'est-ce qu'ils en savent ?
*
Les voyageurs oscillent dans le secouement de la rame qui file vers Paris. Je réalise n'avoir pas vu depuis douze ans tant d'innocents d'un coup â du moins, supposés tels. En quoi se distinguent-ils de nous, les parias, les réprouvés ? Je me le demande. Combien là parmi eux, combien qui pourraient basculer tout à trac, passer à l'acte sans prévenir, en une poignée de secondes détruire leur avenir, et finir derrière les barreaux ? Combien et, plus important, lesquels ? Est-ce que c'est détectable ? Est-ce que j'étais prédestiné à ça, et est-ce qu'on aurait pu me prévenir, m'empêcher de faire ce que j'ai fait ? Tellement de questions sans réponses, qui semblent dans le wagon ne tarauder que moi.
Se« réinsérer »... Ma« réinsertion » programmée... Je me figure la petite dame de Pôle Emploi censée me dégotter un boulot, elle aura certainement cette gueule bien acariâtre qu'ont en centrale les juges d'application des peines. Alors voilà j'ai travaillé huit ans comme auxi préposé à la distribution des repas, je suis comme qui dirait diplômé de Fleury-Mérogis, puis j'ai suivi un troisième cycle à Fresnes, vous croyez que je pourrais bosser dans une cantine scolaire ? Vous verrez tout est dans le dossier, condamnation pour viol sur mineur, séquestration, torture et actes de barbarie, mais maintenant ça va mieux, je gère là, oui, vous imaginez bien, j'ai pris conscience de mes erreurs, j'ai fait un vrai putain de travail sur moi, je me sens grave affûté pour la réinsertion. Vous avez des enfants ? Quel âge ? Quatre et sept ans ? Ah oui, c'est jeune...
Ca va rouler, c'est sûr. Paraît que dans mon bled maintenant, les bac + 5 aussi pointent au chômage, alors avec mon diplôme de Fleury tu penses, ce sera du tout cuit...
Je vais pointer ouais ouais, pointer c'est bien ma came, tu parles, pour un pointeur : pointer à la cantine, pointer chez le JLD, pointer au chômdu, pointer pointer pointer, je suis un pointeur né, pointeur comme d'autres sont doués pour le calcul mental.
Une meuf me dévisage, je paranote à mort. Est-il possible qu'elle m'ait reconnu ? Non, ça ne paraît pas possible. Dix ans après le procès... Et lui ? Quel âge peut-il avoir, maintenant ? Cinq et douze : dix-sept ans. Dix-sept ans. C'est un jeune homme.
Est-il heureux ?
Pourquoi pas ? Pourquoi ne le serait-il pas ? Il est heureux parfois, malheureux à d'autres moments. Comme nous tous. Plus souvent malheureux que d'autres, peut-être. Rien à faire. Rien à faire pour réparer cela. Je le voudrais mais non, rien à faire. Il doit apprendre à vivre avec. Il doit comprendre qu'il n'y est pour rien. Ce n'est pas sa faute.
A-t-il une petite amie ? Oui, il doit avoir une petite amie. Je l'imagine douce, maternelle, compréhensive. Elle lui fait du bien. Ils font l'amour. Elle le trouve timide. Elle trouve que c'est touchant. Il ne lui a rien dit. Il essaye de ne plus y penser. Parfois elle dort, la nuit, tout près de lui, il sent la chaleur de son corps, il s'assure qu'elle dort vraiment, et alors il pleure, muet de douleur écrasée, il pleure en cachette. Il s'abandonne.
Les nuits pleurées jusqu'au lever du jour. Ces cataractes silencieuses, qui vous garrottent la gorge et vous drainent la poitrine, vous essorent encore et encore. Jusqu'à ce que l'épuisement vous délivre, enfin. Je connais cela.
Les années ont passé. Douze ans. Douze ans avec la préventive, et je ne pleure plus la nuit. Tout passe. Est-ce qu'il pleure encore, lui ? Ses années ont-elles été aussi terribles, aussi dures que les miennes ?
Que reste-t-il du petit garçon qu'il a été ? C'est un homme maintenant. Est-ce que je le reconnaîtrais dans la rue ?
*
Montesson n'est plus ce qu'elle était. Des maisons clones ont poussé là où s'étendaient quand j'y habitais des champs de salades à perte de vue. Les bourgeois à deux véhicules, marmots et jardinets ont remplacé les batavias. Cette vie qui a coulé dans mon dos me déprime soudain avec une stridence atroce. Pourtant dieu sait que je m'y étais emmerdé ferme, ado. Et voilà qu'y revenir me remue les tripes avec la tendresse insidieuse d'un paradis perdu. Les gens se plaignent de leur petite vie merdique, ils ne s'en plaignent pas comme ils le croient parce qu'elle est effectivement merdique, mais parce qu'ils sont, sans le savoir, des privilégiés. On devrait leur organiser à tous un petit séjour à l'ombre, quelques années, ça suffirait. En sortant de là ils regarderaient leur vie d'avant avec un peu plus d'indulgence.
*
Le type en uniforme en bas de l'immeuble de Marie me barre la route les bras croisés sur la poitrine, me demande ce que je fais là. C'est un gros, c'est un noir, c'est un suspicieux : qu'ils soient gardiens de prison, videurs de boîte de nuit ou concierge dans une HLM, les matons ont toujours, partout, le même profil. Et toujours cet air mélangé du molosse prêt à mordre et du roquet qui crève de trouille.
« Qu'est-ce que je fais là, Monsieur ? Je viens voir une amie. Une vieille amie... Son nom ? Marie. Marie comment ? Marie Sagone », je lui réponds, et disant cela, j'évite de justesse de dire que je viens voir Marie-Salope. Marie-Salope qui fut ma femme dans une autre vie, et qui est maintenant celle d'un autre. Marie qui fut mon grand amour, et l'est toujours, en quelque sorte, puisque je n'en ai pas connu d'autre.
Le type reste méfiant. Il me propose de l'appeler pour moi à l'interphone, alors je lui dis que ce n'est pas grave, que je repasserai plus tard, et il me regarde m'éloigner avec le sentiment bouffi du devoir accompli, le sentiment d'avoir purgé les lieux d'un parasite.
Je contourne le bâtiment à la recherche d'une seconde entrée, accablé par l'épisode, par cette gueule d'éternel coupable qui doit bien être la mienne pour qu'on la détecte si facilement.« Qu'est-ce qui me prouve que vous ne vous les êtes pas faites vous-même ? » Voilà ce que m'a demandé le directeur lorsque je lui ai montré, en présence de l'infirmier de service, les brûlures de cigarettes sur mes testicules, sur le pubis et, baveuses, noires et rouges violacées, en demi-lunes boursouflées, les trois marques purulentes sur mon gland. Et les traces de liens, à mes poignets, qui avaient gravé dans ma chair de profondes rigoles, au point qu'un os s'était cassé : est-ce que j'avais pu me les faire seul ?
Le directeur m'avait toisé avec cet air de mépris vertigineux qu'avait déjà, lors du procès, l'avocat général, et qui fait de vous une araignée, une blatte, une vomissure. Il avait dit, froid comme la glace :« Il fallait y penser avant, Vernard. Le gosse, Vernard, le gosse non plus il avait rien demandé. Et puis il a croisé votre chemin. »
Un lourd silence avait suivi, et le directeur avait conclu, sous l'oeil approbateur de l'infirmier :« Regagnez vite votre cellule, Vernard, et que je n'entende plus parler de vous. Si j'étais vous je me ferais tout petit. Tout petit. Et j'éviterais de provoquer les gars, vous comprenez ? »
*
Je me souviens très bien de la première fois que nous avons fait l'amour. C'était tellement étrange, tellement intimidant. J'avais honte de ce sexe incongru qui me poussait, s'élevait à angle droit comme un pont suspendu tandis que je me déshabillais, et me faisait ressembler, croyais-je, à un acteur de film porno ; et honte aussi de ma propre honte, me rendant compte qu'elle n'avait pas lieu d'être, ce qui d'ailleurs ne la soulageait en rien.
Je mis un bon quart d'heure, une demi-heure peut-être sous les draps, dans le noir absolu, avant d'oser seulement poser ma main entre ses cuisses, et fus surpris de l'abondance de sa mouille, de la substance glaireuse où pataugeaient soudain mes doigts. J'en fus décontenancé, comme s'il s'était agi là d'une souillure, d'une sorte d'injure ou de vulgarité qui me dégoûta infiniment. J'en perdis sur-le-champ mon érection, et lorsqu'au petit matin, le lendemain, je retrouvai enfin mes moyens, notre union ne dura qu'un instant, le temps de quelques va-et-vient le corps tendu comme un poing, et le sexe au contraire semi-flaccide. Je jouis en elle comme on avoue un crime, un forfait humiliant, à petits traits malingres, un peu comme on se mouche, râlant un« ah » très rauque dont je voulais qu'elle croie qu'il était l'expression de mon plaisir.
Nous décidâmes tacitement, sans réellement nous concerter, que notre couple ne reposerait pas sur le sexe. En fin de compte ça m'allait bien, je n'étais pas très à l'aise avec ça, je me sentais trop jeune pour avoir un enfant et le fait même de me masturber, dont on m'avait toujours appris que c'était un péché, pour un plaisir si bref au fond, m'avait les rares fois où je m'y étais adonné, plongé dans un abîme de culpabilité d'une profondeur telle que cela me semblait trop cher payé.
J'étais comme un de ces grands gosses boutonneux chargés dans les gares importantes du plan Vigipirate, lestés comme moi de ma bite d'une arme de guerre totalement inutile, qui ne leur servirait jamais à rien jusqu'à ce qu'un d'entre eux pète les plombs, ouvre le feu sur un passant et ce serait un bain de sang.
Mon passant, moi, mon terroriste imaginaire, ce serait le petit Yoann. C'était le dernier des enfants de nos voisins, un môme comme on rêve d'en avoir, intelligent, curieux, sensible, super éveillé pour son âge. Et surtout qui me faisait confiance. Une confiance totale, une confiance que personne d'autre, je crois, n'avait jamais su m'accorder, et surtout pas ma mère, et encore moins Marie. Le genre de confiance qu'on peut prendre, sur un malentendu, dans un moment de faiblesse, pour une invite.
*
Je sais ce que je vais faire. Je vais passer par le parking. J'attends qu'une voiture s'amène, elle ouvre la porte automatique, s'engouffre et tourne tout de suite à droite, c'est configuré comme ça, et moi je me glisse dans le renfoncement derrière elle, sans me faire voir, avant que la porte ne se referme. Ensuite j'attends que le conducteur sorte du parking par l'intérieur, et je n'ai plus qu'à m'extraire de ma cachette pour aller prendre les ascenseurs.
Oh je n'espère pas la voir, ça non. Je n'oserai jamais cogner à sa porte. Je veux juste savoir où elle habite. Je resterai sur le palier de l'appartement 824 et je sentirai sa présence, juste là, tout près, derrière la cloison de papier mâché, pas moins bruyante mais combien moins épaisse que les murs d'une cellule. Si ça se trouve elle sera en train de préparer le dîner. La bonne odeur débordera jusqu'au couloir et je reconnaîtrai le plat. Les souvenirs me tomberont dessus comme ces petits caïds des cités taillés comme des armoires vous tombent dessus en groupe à l'improviste à la promenade, vous entraînent dans un coin et vous shootent dans le ventre, la gueule, les couilles en vous crachant dessus après s'être raclé la gorge pour que le mollard soit consistant, jusqu'à ce qu'ils en aient marre, ou s'inquiètent de ce que vous pourriez y passer, ce qui voudrait dire ouverture d'une enquête, et qui dit enquête dit risque de voir rétrécir la peau de chagrin des remises de peine. Oui ce sera ça, peut-être. Des souvenirs qui font du bien et qui vous font du mal. Des souvenirs qui vous hurlent au visage tout ce que vous avez perdu.
*
J'attends depuis vingt minutes derrière un massif de bruyère qui borde l'entrée, quand arrive une Simca grise qui se présente devant le parking. Une Simca comme on n'en faisait déjà plus depuis belle lurette à l'époque de mon incarcération, l'époque où le temps pour moi s'est arrêté pour céder la place à ce long cauchemar.
Elle tourne comme prévu sur la droite et je me faufile dans la foulée sous l'oeil borgne d'une caméra de surveillance, à laquelle je souris l'air dégagé, comme si j'habitais là, à laquelle je souris comme j'ai souri toutes ces années aux caméras de Fleury puis de Fresnes, dans l'espoir illusoire de m'attirer les bonnes grâces â ou du moins d'éloigner de moi les foudres â de mes gardiens.
La porte se rabat dans mon dos dans un grincement de tôle froissée, et j'entends la voiture qui se gare, deux portières qui claquent, le clapotis de pas s'éloignant et les bribes non identifiables d'une conversation, dont l'un des deux protagonistes parle d'une voix fluette et volubile, une voix comme je n'en ai pas entendue depuis une éternité.
J'attends.
J'attends encore, tendant l'oreille.
Quelque chose cloche.
La conversation a cessé mais des bruits sourds, irréguliers, résonnent sous la chape jaune pisse du parking. Des bruits comme des claquements, des coups, parfois spongieux, parfois traînant avec un bruit de frottement continu, un tap tap tap sautillant puis tout d'un coup, un grand blam ! parfois suivi de petites répliques. Des bruits que déforment les échos répercutés par le béton, mais qui signalent, sans doute possible, une présence humaine.
Je hasarde un oeil hors de ma cachette, piqué au vif et titillé, craignant pourtant de me faire repérer. Tout d'abord je ne vois rien. Et puis je vois. Et ce que je vois manque me faire éclater de rire. L'histoire de l'éléphant qu'effraie une petite souris. Là devant moi, à une dizaine de mètres, un jeune garçon joue au ballon, tout simplement. Il court derrière la balle de cuir et, maladroitement, tape dedans de toutes ses forces avec ses petits pieds. Le ballon frappe le mur et lui revient, rebondissant sur le revêtement de sol tandis qu'il court derrière pour se positionner de nouveau. L'enfant est seul. Le père ou la mère a dû remonter dans les étages, regagner ses pénates tandis que fait ses gammes, dans les sous-sols, leur petit Zidane. Je sors de mon coin rassuré, et m'approche du bambin qui, de surprise, laisse courir son ballon.
Je lui fais un signe de la main et me dirige vers les ascenseurs quand un pressentiment m'assaille. Se pourrait-il que... Se pourrait-il que ce soit le fils de Marie ?
Je m'arrête et dévisage le gosse qu'auréole de vert sale le panneau sortie derrière lui. Ce ne sont pas les traits de Marie. Non. C'est autre chose.
Je sens une violence sourde monter en moi et s'épaissir. Et si calme, si calme... Circulairement tournant avec une lenteur oppressante. Je la sens qui se concentre, qui s'accumule là dans ma queue, là dans mes couilles, comme le chasseur méthodiquement recharge son arme, le regard rivé sur l'ombre de sa proie, poussant les cartouches dans le canon, redressant le fusil avec un clac qui témoigne du verrouillage, puis qui épaule, puis qui n'est plus que l'oeil d'où une balle va jaillir pour tuer.
Le gosse est là avec ses yeux tout étonnés, ses joues pâles et ses lèvres vermillon, il ressemble en tous points à l'autre, le petit Yoann ses cris d'orfraie qui me mettaient le coeur en vrac. Personne alentour, j'avance vers l'enfant qui recule, dos au mur, j'appuie sur la barre transversale de la porte coupe-feu, le saisis à la gorge et le pousse tête la première dans le sombre réduit de la cage d'escalier.
Régis Clinquart, Juillet 2011
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.