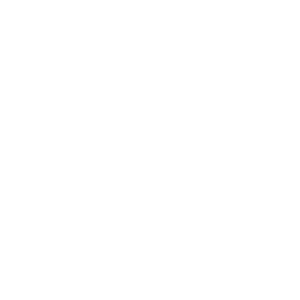MICHEL SURYA « RÉVOLUTION, POLITIQUE, POUVOIR & CITOYENS »
Enregistrement : 07/10/2011
Mise en ligne : 10/10/2011

Au sein de sa bibliographie imposante, on trouve une quadrilogie intitulée De la Domination, dans laquelle il analyse notamment le rôle des juges, des journalistes et, dans les deux derniers tomes Portrait de l'intellectuel en animal de compagnie et Portrait de l'intermittent du spectacle en supplétif de la domination, il trouve une vigueur digne de Guy Debord pour évoquer l'imposture absolue du spectaculaire intégré.
Privilégiant comme d'habitude la qualité à la quantité, La Spirale a sollicité la réflexion de cet intellectuel remarquable pour aborder l'actualité du contrat social, soit celle de sa progressive destruction.
Propos recueillis par Éric Ouzounian

Je doute qu'il existe encore une citoyenneté suffisante pour constituer une démocratie. Toute politique de domination s'emploie à ce qu'il y ait la plus petite citoyenneté possible. La question se pose d'ailleurs : les gens s'éprouvent-ils eux-mêmes encore comme des citoyens, excepté dans les périodes électorales où leur vote est en effet sollicité. Vote dont il est fait peu de cas, on le remarquera, à chaque fois où il n'a pas abondé dans le sens des projets de la domination. Ça a été le cas avec Maastricht, avec l'euro, en France, aux Pays-Bas, en Irlande.
La conviction est assez répandue qu'il n'existe aucune alternative politique réelle ; ce qui est l'évidence ; ce dont profitent et profiteront les populismes â on n'a pas fini de le mesurer. Ni alternative politique, ni sociale, ni industrielle. Il y a une gauche et une droite, constituées comme telles, lesquelles prétendent aux suffrages des citoyens. Pour la forme. Pur formalisme. Lequel emprunte aux apparences d'un dualisme marqué entre deux représentations du monde, deux organisations de celui-ci. Ce dualisme a existé ; il n'existe plus. Ne reste plus qu'à choisir entre un ultra-libéralisme et un libéralisme social. Ultra-libéralisme et libéralisme social s'entendent en fait là-dessus que le système n'a plus les moyens de quelque politique sociale que ce soit.
Le premier a assez de cynisme pour le dire et agir en conséquence (endosse le rôle du bourreau ou du boucher â équarrisseur des dépenses) ; le second assez d'hypocrisie pour continuer d'en adoucir la violence (tient lieu du prêtre avec son viatique). À la vérité, c'est affaire de vitesse dans la disparition du souci que la politique en portait. Ce qu'il en reste : ce que les médias, journalistes, commentateurs et politologues de ce système (la camarilla idéologique large) appellent les« extrêmes », selon une confusion intéressante, faite pour les renvoyer dos à dos et établir entre elles une équivalence stigmatisante supposée efficace.
Le fait est pourtant clair que personne ne considère plus que les alternances puissent constituer des alternatives. Que tout le monde s'est convaincu, soit pour s'en satisfaire, soit pour le déplorer, que la politique n'a plus qu'une incidence extraordinairement marginale sur l'économique (entendu comme« financier »). Une séquence récente l'a illustré de manière exemplaire, pendant laquelle tout le monde s'est trouvé d'accord pour dire : la crise du capitalisme financier est l'occasion pour les politiques de reprendre la main. Et en effet des annonces ont été faites dans ce sens : régulation des marchés financiers, moralisation du capital... Comme si les marchés étaient ainsi constitués qu'ils puissent être régulés ; comme si le capital pouvait être« moral » ! Sarkozy le premier l'a dit, qui n'est jamais en retard d'une rodomontade... Pour autant, qu'en a-t-on vu ? Rien. L'instance, en tout, sur tout, est financière. Et insaisissable.
Il ne s'agit pas de se représenter le monde de façon paranoïaque ou conspirationniste. Aucun besoin de chercher quelque conflit que ce soit de modèle à modèle, de puissance à puissance, d'idéologie à idéologie. Tout est beaucoup simple. c'est une régulation-dérégulation du monde (la dérégulation est encore une règle, et, entre toutes, l'une des plus coercitives). Domination est le nom de cette régulation-dérégulation machinique insaisissable du monde. Personne à la manoeuvre ; personne donc à renverser. Tout est devenu parfaitement abstrait. Alors, quelle citoyenneté face à cela ? Aucune. Tout au plus des usagers, des clients, des consommateurs, d'un côté. Et de l'autre, ou du même (l'exploitation est auto-exploitation), des précaires, des chômeurs, des laissés pour compte, etc.
Aucune citoyenneté, aucun contrat social ; au contraire, le mouvement est le même qui décontractualise de manière délibérée, intentionnelle, systématique, sauvage, toute citoyenneté possible et qui régule-dérégule les marchés.
Cette situation pourrait offrir un boulevard aux idées révolutionnaires ?
De ce point de vue, la situation est moins mauvaise qu'il y a quinze ans, en effet. En apparence du moins. Parce qu'il n'est pas sûr que la situation soit réellement propice à un renversement révolutionnaire du système. Ou alors il faut dire qu'il l'est tout autant à son renversement réactionnaire. Plus peut-être même. Elle est susceptible de désagréger autant que d'agréger. De diviser les peuples plutôt que d'unir un peuple. La nouvelle prospérité des extrême droites partout en Europe en témoigne malheureusement. Cela dit, il est vrai que la période est le témoin d'un regain d'intérêt pour les pensées et les oeuvres révolutionnaires. Qu'on les lit de nouveau. Que de nouvelles s'écrivent. Qu'il y a de nouveau un« désir de Révolution », pour reprendre le beau titre de notre ami Jean-Paul Dollé.
S'il n'existe plus de contrat social et que la loi du plus fort domine, peut-on s'attendre à des réactions de violence ?
En France, je ne vois rien qui invite à le penser. Il y a eu le fort sursaut de la grève de 2010, précédé par des mouvements en effet violents dans les usines sur le point de fermer, menaces de sabotage, etc. Mais on est là dans le schéma ancien de la lutte sociale, comparable à celui qu'on a connu depuis le début de la désindustrialisation. Les menaces sont restées à l'état de menace et la résignation l'a emporté. Plus intéressantes sont les émeutes dans les banlieues françaises, en 2005, ou anglaises, récentes. Les mobilisations grecques et espagnoles le sont aussi. Il n'y a nul besoin que celles-ci se disent politiques, elles le sont. Elles le sont quoiqu'on se soit empressé de dire qu'elles ne l'étaient pas, qu'elles étaient non pas apolitiques au sens ancien du terme, mais dé-politiques (primaires, sauvages, inorganisées, inconceptualisées, sans visée, etc.). Ceci doit valoir pour l'avenir : il ne sera pas nécessaire qu'un soulèvement soit dit non-politique pour qu'il n'en soit pas moins politique. Ceux qui prétendront qu'il n'est que le symptôme d'une arriération, d'un état pré-politique, d'une mentalité pré-politique, se tromperont. Il faut au contraire y voir le signe avant coureur d'une autre forme de la politique. En 68 aussi, après tout, l'action était très en avance sur les discours, la rhétorique qui l'ont accompagnée, qui l'ont scandée.
La rhétorique est souvent incapable de penser ce qui se passe de neuf d'un point de vue politique. C'est même à cette incapacité qu'il est possible de mesurer qu'il se passe enfin quelque chose de neuf. Impossible donc de prévoir quoi que ce soit. Encore plus obéissant à quelles fins. Ce qui frappe actuellement, c'est que, si nombreuses que soient les raisons de se soulever, et si nombreux les micro-soulèvements ici et là, rien ne s'agrège, rien ne coagule, tout est à l'état de la dissémination la plus complète. On ne comprend pas pourquoi. Mais on ne comprendra pas davantage pourquoi, à un moment ou à un autre, cela s'agrégera soudain, coagulera. Ce qui s'est passé dans les pays arabes nous en avertit que personne n'a su prévoir, dont personne n'a su anticiper l'imminence. Peut-être pour quoi ils ont été si efficaces. Une leçon nous est donnée là.
Une autre nous est donnée : ces soulèvements ne peuvent pas faire, par principe, l'économie de la possibilité de la violence. Mot tabou dans nos pays. Lequel déconsidère par avance toute menée politique. À laquelle l'opinion (les médias, etc.) ne consent qu'à la condition que celle-ci puisse passer pour une violence de« résistance ». Autrement dit : de résistance à une violence préexistante et reconnue (ce que les mêmes médias, dans le cas des pays arabes, appellent les« dictatures », qu'ils se gardaient bien d'appeler ainsi quelques mois auparavant). Eh bien, il faut le reconnaître, l'opinion ne tient pas suffisamment la domination démocratique-libérale pour violente, ou pour assez violente pour qu'on soit justifiée de se soulever contre elle par des moyens d'une violence proportionnée. Tant qu'elle en restera là, pas de perspective possible pour quelque soulèvement ou subversion que ce soit... Notre démocratie tempérée, notre grand âge dans la gestion des conflits, notre dépassement prétendu de la fin de l'histoire veulent que nous excluions par principe la possibilité de la violence dans notre rapport à la domination.
Faut-il reconsidérer l'analyse que fait Marx du lumpenprolétariat ?
Marx n'aimait guère le lumpenprolétariat ; il s'en méfiait et considérait qu'il était inexistant socialement, qu'il n'avait ni représentativité ni délégation. J'ai déjà émis cette hypothèse que la faillite historique du communisme devait au fait qu'il y a un jugement moral préalable chez Marx, partageant entre ceux des prolétaires qui étaient dignes d'être émancipés et ceux qui ne l'étaient pas. Le moralisme communiste est né de là. Non seulement il exclut le sous-prolétariat pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons morales. Il y a des pages de Marx dignes d'un bourgeois pour stigmatiser cette sous-classe-là. Et c'est ce qui est intéressant : c'est de ces classes-là, justement, réputées dangereuses et généralement stigmatisées, qu'une chance existe que de la politique revienne, qui plus est une politique émancipatrice.
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.