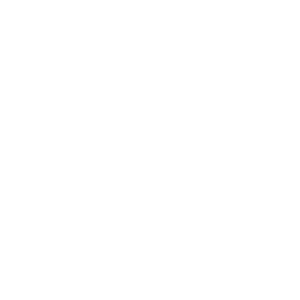ALBAIN LE GARROY « CAMARADE FRANKENSTEIN OU LE MONSTRE MODERNE »
Enregistrement : 27/07/2020
Mise en ligne : 27/07/2020



Ce n’est donc pas du côté de l’originalité que le spectateur trouvera l’intérêt du film. Quant à considérer le scénario inepte, il faudrait le prendre au sérieux. Or nous avons du mal à croire qu’il a été écrit dans ce but. La fin est grotesque et le sang coule par litres entiers. Nous sommes bien plus en face d’un film comme Brain Dead de Peter Jackson que d’un Outpost de Steve Barker, film bien plus sérieux comportant pourtant lui aussi des zombies nazis.
Cependant, en nous attardant sur les différents types de monstres, qu’ils soient moraux ou physiques, présents dans ce film, nous verrons en quoi ce dernier présente un autre intérêt que celui de rire, ce qui est déjà une de ses qualités.
I. L’HOMME MONSTRUEUX
Dès les premières minutes, le spectateur comprend qu’il n’est pas devant un film classique où les allemands seraient le Mal à combattre et à vaincre. Le fait est que celui-ci est déjà vaincu : les bottes des soldats soviétiques foulant le drapeau à la croix gammée est l’allégorie de la victoire de l’armée rouge contre les forces nazies.Le réalisateur est en cela plus fin que la plupart de films mêlant horreur et nazisme. Il évite toute forme de manichéisme : les rares allemands que nous voyons sont le plus souvent des victimes.

En centrant l’action autour de l’unité soviétique, Raaphorst montre son quotidien et les différents caractères de ses membres, du soldat respectable au sadique le plus accompli. Mais tous se battent finalement pour une sorte de communauté élargie. D’après le sociologue Ferdinand Tönnies :
« C’est un fait que les volontés humaines, dans la mesure où chacune est incorporée dans une constitution physique, sont et restent liées, ou le deviennent nécessairement, en vertu d’un lien qui repose sur l’origine familiale ou la différence de sexes. Ce lien, qui exprime une affirmation immédiate réciproque, se manifeste de la façon la plus intense dans trois sortes de rapports, à savoir : 1) le rapport entre une mère et son enfant ; 2) le rapport entre un homme et une femme qui forment un couple, ce terme étant à comprendre dans son sens naturel ou plus généralement animal ; 3) le rapport entre frères et sœurs, c’est-à-dire entre enfants se reconnaissant comme descendants d’une même mère. » (Tönnies 11)
Si le mythe nazi reposait sur le sang et la race aryenne, faisant donc du Volk une communauté de frères et sœurs, il n’en va pas de même pour les soviétiques du film. Vassili, le pire d’entre eux, appelle ses camarades selon leur origine : le polonais Sergei et le juif Dimitri. D’après Vassili, sous-prétexte que Sergeï n’est pas russe, leur unité n’aurait pas à suivre ses ordres. De plus, avec ces personnages, le spectateur comprend que l’antisémitisme n’était pas une caractéristique propre à l’Allemagne.En effet, historiquement, il fut même utilisé au sein du parti communiste sous Staline. Comme l’expliquent Danièle Obono et Patrick Silberstein :
« […] en 1926, alors que [Trotsky] combat les germes de ce que sera le stalinisme, inquiet des sous-entendus antisémites utilisés contre l’Opposition, il envoie un mot à Boukharine pour lui demander s’il est vrai que l’agitation antisémite se poursuit impunément dans leur parti. Isaac Deutscher rappelle que si le mot "juif" n’est jamais employé par le "secrétariat" du Parti, les dirigeants de l’Opposition sont qualifiés de "déracinés cosmopolites". » (Trotsky 33)
Cette communauté russe repose soit sur le sang, comme pour les Allemands, soit sur la terre, Vassili appelant la Russie la « Mère-Patrie », ce qui rappelle l’idée d’une origine maternelle commune. Mais tous les soldats ne sont pas à l’image de notre antisémite.Néanmoins, le spectateur remarquera que, si le socialisme n’est jamais mentionné dans le film, Dimitri, dès l’introduction, parle de Staline et de la Nation. Selon nous, la nation rappelle la « terre-mère » que nous venons d’évoquer. Si l’on en croit Jean-Claude Michéa, Staline pourrait aussi jouer le rôle de substitut de maternel :
« […] le contrôle politique exercé par les sociétés totalitaires (à la différence de celui des dictatures classiques) est fondamentalement de type maternel : d’où le rôle central qu’y jouent l’autocritique et l’auto-accusation, ainsi que l’obligation permanente, si bien décrite par Orwell dans 1984, d’aimer le leader suprême. » (Michéa 186)
Nos personnages forment donc bien une communauté, groupés autour de deux figures maternelles, la nation et Staline. Seul le plus sympathique de nos soldats, Sergeï, le Polonais, dit se battre pour sa femme. Néanmoins, la définition de Tönnies n’exclut pas la communauté des amants.
Or, le spectateur notera que des caractéristiques analysées par Claude Lévi-Strauss sont visibles chez nos soldats. En effet, d’après l’anthropologue :
« L’humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village ; à tel point qu’un grand nombre de populations dites primitives se désignent d’un nom qui signifie les "hommes" (ou parfois -dirons-nous avec plus de discrétion – les "bons", les "excellents", les "complets"), impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus -ou même de la nature humaines, mais sont tout au plus composés de "mauvais", de "méchants", de "singes de terre" ou "d’œufs de pou". » (Lévy-Strauss 21)
Pour nos soviétiques, les allemands ne sont pas humains. Ils sont hors de leur communauté. Ce ne sont que des « fascistes ». Ils sont essentialisés et leur humanité est totalement niée. Ainsi il n’y a plus de vieillards, d’enfants, d’hommes ou de femmes mais, seulement des êtres catégorisés sous l’étiquette « fasciste », ceux-ci pouvant être brutalisés sans problème de conscience. Pour nous, les nazis étaient des monstres. Le réalisateur ne le nie pas. Frankenstein a été dans un camp jusqu’au moment où ses expériences inhumaines ont été remarquées par un officier nazi, deux brefs rappels de cette barbarie. Mais en niant la nature humaine des allemands, nos soldats deviennent les mêmes monstres que les nazis qui niaient celle des juifs. Nous avons donc deux types de monstres humains : les nazis et nos soldats.
Ainsi, nous n’avons pas besoin d’attendre les créatures de Frankenstein pour voir nos premiers monstres. Et le réalisateur fera au moins trois clins d’œil au spectateur pour le lui faire comprendre. Dans les classiques de James Whale, le monstre de Frankenstein est dénué de toute cruauté. Ainsi ses rencontres avec des humains permettent de le voir : celles avec le vieillard et quatre gitans dans The Bride of Frankenstein ou celle avec la fillette qu’il tue sans faire exprès dans Frankenstein. Ces scènes ont exactement leur pendant dans le film de Raaphorst : les soldats rencontrent bien un vieillard (le spectateur ne découvrira qu’à la fin son identité – Frankenstein lui-même) et quatre personnes(une femme, un garçon et deux hommes, négatif des gitans de Whale -un homme, une fillette et deux femmes-). Mais nos soldats sont bien plus monstrueux que la créature de nos anciens films : ils torturent le vieillard, frappent les hommes et Vassili veut violer la femme. Quant à la scène de l’enfant, c’est le garçon que nos soviétiques enverront se faire tuer.
II. LES MONSTRES DE FRANKENSTEIN
Cependant, contrairement au monstre de Whale, nos créatures ici sont bien des tueuses. Elles sont aussi de parfaits ouvriers, poussent des chariots et aident Frankenstein dans son travail. Là, où le monstre de Shelley et ses nombreux successeurs sont autonomes par rapport à leur créateur, ceux de notre film se contentent de suivre les ordres. En cela, ils sont de purs zombies de la tradition haïtienne. Maxime Coulombe explique à leur propos que « les prêtres [les] emploieraient […] pour leurs tâches ménagères, pour le travail aux champs, leur manque d’esprit empêchant de leur donner des besognes plus violentes et plus sombres. » (Coulombe 24). Autre époque, autres mœurs, nos zombies ont leur lot de sombres tâches. Mais dans leur asservissement total à leur chef, ils rappellent aussi ces allemands qui, tel Eichmann, ne faisaient que respecter les ordres. D’ailleurs, le premier geste que fait l’un d’entre eux lorsqu’il est réveillé est un salut nazi.

Ainsi, le spectateur ne voit plus que le repère morbide d’un savant fou mais aussi une usine fonctionnant suivant le taylorisme, organisation appliquée entre autres aux camps de concentration. À ce sujet, Enzo Traverso explique que :
« Certains principes constitutifs de l’"organisation scientifique des usines" théorisée par Frederick W. Taylor -soumission totale des travailleurs au commandement, séparation rigoureuse de l’idéation et de l’exécution des tâches, disqualification et hiérarchisation de la force de travail, segmentation de la production en une série d’opérations dont seule la direction gardait la maîtrise – y étaient strictement appliqués. Si un des conditions historiques du capitalisme moderne est la séparation du travailleur des moyens de production, le taylorisme a introduit une étape nouvelle consistant à dissocier l’ouvrier du contrôle du processus de travail, ouvrant ainsi la voie de la production sérielle du système fordiste. Dans l’industrie américaine, dont l’exemple sera largement suivi en Europe après la Première Guerre mondiale, cela se traduisant dans le passage de l’ancienne classe ouvrière de métier à l'"ouvrier-masse", unskilled et toujours remplaçable. L’idéal de Taylor est un ouvrier décérébré, privé de toute autonomie intellectuelle et seulement capable d’accomplir machinalement des opérations standardisées ; selon ses propres mots, un "homme-bœuf" ou "gorille dressé" (un "chimpanzé", écrira Céline dans son Voyage au bout de la nuit). Bref, un être déshumanisé, aliéné, un automate. » (Traverso 48-49)
Toute la description de Traverso correspond à notre usine de monstres. Mais justement, là où l’historien insiste pour dire que l’être humain devient automate, chez Frankenstein, ce qui pourrait paraître comme un automate n’en est pas un. Le savant fou s’énerve d’ailleurs à ce sujet : ils sont en vie, ne sont pas des machines et ont même besoin de manger. Nous sommes loin des autres créatures habituelles, que ce soit celle de Shelley ou de Whale, où le créateur nie l’humanité de son monstre. Ici, Raaphorst montre des êtres humains rendus, comme le père de Frankenstein le disait : « plus efficaces avec des marteaux et des tournevis à la place des doigts ». En cela, l’être humain est juste considéré comme une machine et sa modification n’est juste que de « la mécanique » et de « l’ingénierie ». Si nos humains soviétiques étaient des monstres, nos zombies deviennent des humains. Le réalisateur brouille les deux catégories -humaines et monstres- à tel point que la frontière les séparant n’existe plus.
Toutefois, il reste un point commun avec nos films de Whale ou le livre de Shelley. Comme l’explique Alberto Manguel à propos du film The Bride of Frankenstein :
« La création à partir de « semence » mâle de créatures à sa propre image (comme le fait Pretorius dans ses bocaux de verre), sans recours à une femme (ainsi que le réalise le Dr. Frankenstein), c’est la méthode l’alchimiste, le rêve patriarcal, l’objectif du savant fou. Du golem juif aux sculptures animées de la fable et de la science - Eve tirée d’un côté d’Adam, la femme d’ivoire de Pygmalion, le Pinocchio de Collodi, les automates du XVIIIe et du début du XIXe siècle qui enchantaient tellement Mary Shelley et son cercle, les homoncules du Dr. Pretorius – les hommes se sont imaginés capables de créer la vie en se passant des femmes, privant celles-ci de l’exclusivité de la capacité de concevoir. Nulle femme ne participe à la création du monstre par Henry Frankenstein, ni plus tard à celle de la fiancée : c’est une affaire menée exclusivement entre hommes. » (Manguel 66-67)
Il faut bien avouer que l’univers du Frankenstein de notre film est très masculin et a tous les traits d’une société patriarcale, à tel point que les deux seules créatures féminines de sa troupe peuvent très bien rentrer dans le schéma classique « la maman et la putain ».
En effet, le spectateur verra dans la chambre de Frankenstein sa mère (nous apprenons son identité dans le générique) transformée en ours en peluche, devenant alors une caricature monstrueuse d’objet transitionnel winnicottien.

L’autre sera l’infirmière sexy au cerveau monstrueusement disproportionné, ce qui pourrait évoquer la coupe de cheveux de la fiancée du monstre dans le film de Whale. Si l’on admet ce rapprochement, le spectateur se rappellera que la fiancée dans le film de Whale n’est créée que pour tenir compagnie à la créature. Ici, nous pouvons faire l’hypothèse que l’infirmière n’est créée que pour tenir compagnie à Frankenstein.

III. UNE SOCIÉTÉ MONSTRUEUSE
Mais l’usine de Frankenstein est aussi le modèle de société qu’il désire. C’est, pour lui, une utopie qui permettra d’éviter la folie des hommes. Et, accessoirement, c’est aussi le modèle de notre société post-seconde guerre mondiale, reposant sur les principes de la cybernétique. Comme l’explique Jean-François Liotard :
« Chez les théoriciens allemands d’aujourd’hui [1979], la Systemtheorie est technocratique, voire cynique, pour ne pas dire désespérée : l’harmonie des besoins et des espoirs des individus ou des groupes qu’assure le système n’est plus qu’une composante annexe de son fonctionnement ; la véritable finalité du système, ce pour quoi il se programme lui-même comme une machine intelligente, c’est l’optimisation du rapport global de ses input avec ses output, c’est-à-dire sa performativité. Même quand ses règles changent et que des innovations se produisent, même quand ses dysfonctionnements, comme les grèves ou les crises ou les chômages ou les révolutions politiques peuvent faire croire à une alternative et faire lever des espérances, il ne s’agit que de réarrangements internes et leur résultat ne peut être que l’amélioration de la "vie" du système, la seule alternative à ce perfectionnement des performances étant l’entropie, c’est-à-dire le déclin. » (Lyotard 25)
En d’autres termes, le système est tout et l’individu n’en est qu’une composante. Si l’individu est devenu machine avec le savant fou, sa société est elle-même une machine. Ce n’est toutefois pas la première fois qu’une comparaison entre politique et machine est faite dans un film inspiré de Frankenstein. Ainsi, le policier dans Son of Frankenstein de Rowland W. Lee possède une prothèse. Il est lui-même plus machine que la créature elle-même. En tant que policier, il est représentant de l’État. Le spectateur comprend alors que l’Etat est lui-même une machine plus monstrueuse que le monstre. Mais là où Raaphorst va plus loin dans sa réflexion, c’est que nos créatures sont elles-mêmes en partie machine, devenant parfaitement disciplinées, au sens où l’entend Foucault. Frankenstein n’est pas un dirigeant habituel, il n’est qu’un technocrate s’occupant d’un système global. Il laisse ses créatures faire leur travail sans les forcer à quoi que ce soit. Il n’a aucune violence envers elles. Sa volonté est exécutée sans qu’il y ait besoin de système coercitif. Nous sommes alors loin du monstre de Shelley. En somme, ces créatures sont leur propre État. En cela, le film rappelle le constat de Baudrillard sur notre époque :
« Dans la société antique, il y a le maître et l’esclave. Plus tard, le seigneur et le serf. Plus tard, le capitaliste et le salarié. A chacun de ces stades correspond une servitude déterminée : on sait qui est le maître, on sait qui est l’esclave. Désormais tout est différent : le maître a disparu, il ne reste que les serfs et la servilité. Or qu’est-ce qu’un esclave sans maître ? C’est celui qui a dévoré et l’a intériorisé, au point de devenir son propre maître. Il ne l’a pas tué pour devenir le maître (ça, c’est la Révolution), il l’a absorbé tout en restant esclave, et même plus esclave qu’esclave, plus serf que serf : serf de lui-même. » (Baudrillard 76)
Nos Soviétiques désobéissent aux ordres. Ils se trahissent entre eux et Dimitri ira même jusqu’à insulter Staline. Ils conservent un minimum de liberté, même sous le stalinisme. Nos créatures ne peuvent pas trahir et n’ont aucune volonté de liberté. C’est en cela qu’elles sont devenues leurs propres serfs.
Nous comprenons que Raaphorst fait ici la caricature de notre société. De peur de retomber dans le mal du nazisme ou du stalinisme, nous avons choisi un autre mal, qui correspond assez bien à la post-modernité de Lyotard et qui se caractériserait par « l’incrédulité à l’égard des métarécits » (Lyotard 7), les idéologies politiques et les religions. D’ailleurs, le spectateur remarquera que dans notre film, la science a détruit la religion : lorsque les soviétiques rentrent dans le village, ils tombent sur des cadavres de nonnes, tuées par les créatures de Frankenstein. Une église y est aussi totalement désacralisée.
En somme, Frankenstein a détruit tout ce qui pouvait créer un conflit, son œuvre suprême étant la création d’un homme nouveau, dont le cerveau serait constitué d’une moitié soviétique greffée à une autre nazie, ce qui permettrait ainsi une compréhension entre les deux camps. La volonté de consensus devient grotesque, mais n’est qu’une parodie de celui qui serait voulu, d’après Lyotard, à notre époque. Or, selon ce philosophe, « le consensus obtenu par discussion […] violente l’hétérogénéité des jeux de langage. Et l’invention se fait toujours dans le dissentiment » (Lyotard 8). En somme, comme le philosophe Toni Négri l’explique : « La paix se conquiert. Il est dangereux d’en faire un présupposé. La paix peut être un instrument de domination et d’exploitation. Il y a des moments où la guerre et la résistance sont nécessaires pour être libre et vivre dignement. » (Negri 60).
Le film est donc totalement pessimiste. Par la nature même de notre société technocratique, héritière de la Seconde Guerre mondiale, nous n’avons aucun espoir de progrès ou d’émancipation. Comme le dit un soldat allemand sur le point de mourir : « On l’a cherché. Nos horloges sont arrêtées. C’est irréversible ». Ce que le réalisateur nous montre ici, c’est bien alors sa version de la fin de l’Histoire.
Frankenstein’s Army est donc selon nous un film engagé. Il nous montre différentes facettes de la monstruosité du XXe siècle, un siècle de guerre et de totalitarismes, avec, pour terminer, une critique amère de notre société. Ce film contredit alors le raisonnement du philosophe François de Smet lorsqu’il affirme que : « Si nous avons la nostalgie des nazis, c’est parce que nous manquons de "méchants" qui en ont vraiment l’air et que notre époque se révèle être un maelström de lobbys, d’identités, d’intérêts divergents devenus impossibles à accorder » (De Smet 21). Pour Raaphorst, nous n’avons pas besoin du nazisme pour trouver un « méchant », un monstre. Il suffit de regarder notre société.
Albain le Garroy
Doctorant à l’Université de Michel de Montaigne – Bordeaux
Article écrit dans le cadre du Colloque international - Frankensteins intermédiatiques/Intermedial Frankensteins, qui s'est tenu les 18 et 19 octobre 2018 à Bordeaux Montaigne, organisé par les laboratoires TELEM, CLIMAS et CLARE.
FILMS :
Lee, Rowland V., Son of Frankenstein, 1939
Raaphorst, Richard, Frankenstein’sArmy, 2013
Whale, James, Frankenstein, 1931
Whale James, Bride of Frankenstein, 1935
LIVRES :
Baudrillard, Jean, L’Echange Impossible, Paris : Galilée, 1999
Coulombe, Maxime, Petite philosophie du zombie, Paris : PUF, 2012
Lévi-Strauss, Claude, Race et histoire, Paris : Gallimard, 1987
Lyotard, Jean-François, La Condition post-moderne – rapport sur le savoir, Paris : Minuit, 1979
Manguel, Alberto, La Fiancée de Frankenstein, Paris : l’Escampette, 2008
Michéa, Jean-Claude, L’Empire du moindre mal – essai sur la civilisation libérale, Paris : Flammarion, 2010
Negri, Antonio Goodbye, Mr. Socialism, Paris : Seuil, 2007
De Smet, François, Reducto ad hitlerum, Paris : PUF, 2014
Tönnies, Ferdinand, Communauté et société -catégories fondamentales de la sociologie pure, Paris : PUF, 2010
Traverso, Enzo, La Violence nazie – une généalogie européenne, Paris : la Fabrique, 2003
Trotsky, Léon, Question juive, question noire, Paris : Syllepse, 2011
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.