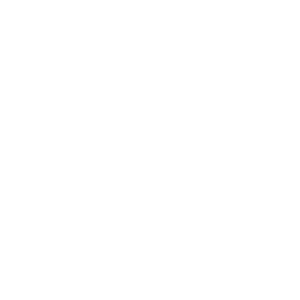ROMAIN SLOCOMBE « LOLITA COMPLEX & AUTRES AVENTURES »
Enregistrement : 15/01/09
Mise en ligne : 15/01/09

Concentré sur l'écriture depuis le tournant du millénaire et la publication de La Crucifixion en jaune, une tétralogie de romans noirs mettant en scène les errances de son double Gilbert Woodbroke en terre nippone, il s'amuse aujourd'hui à poursuivre de sa plume acide l'hypocrisie et les faux-semblants de notre vieil Occident décati.
Un périple entamé sur les bords de Saône avec Mortelle résidence, portrait au vitriol de l'intelligentsia lyonnaise au pied de la basilique de Fourvière, poursuivi dans les brumes d'outre-Manche avec un Lolita complex entre prostitution balkanique et gratin de la scène artistique londonienne, et dont on attend maintenant les prochaines péripéties du côté de l'île de Manhattan et de son Ground Zero.
En attendant cette nouvelle étape de la saga Woodbroke au pays de Richard Hell, d'Andy Warhol et de Public Enemy, Romain Slocombe nous fait le plaisir d'une escale dans La Spirale pour une interview fleuve qui n'épargne rien, ni personne.
Derniers romans parus à ce jour :
L'océan de la stérilité, Tome 1 : Lolita complex de Romain Slocombe
Fayard, 2008 - 480 p. - ISBN : 9782213631813
Mortelle résidence de Romain Slocombe
Editions du Masque, 2008 - 430 p. - ISBN : 9782702431634
. Portrait de Romain Slocombe par Didier Cohen
Propos recueillis par Laurent Courau.

L'idée de départ est que si je voulais continuer à utiliser mon« double », le personnage de Gilbert Woodbrooke, il me fallait éviter l'écueil de la répétition et le fait de renvoyer systématiquement Gilbert au Japon risquait d'offrir de moins en moins d'intérêt. D'autre part, il m'a semblé qu'avec Regrets d'hiver mon cycle des« quatre saisons japonaises » était bouclé, ne serait-ce que du fait qu'il n'existe que quatre saisons ! Et mon personnage est en quelque sorte« crucifié » à la fin, en hommage à Gauguin (autre martyr de l'art et de la fuite aux antipodes), et en conformité au titre de la tétralogie, La Crucifixion en jaune. Dans ces quatre romans j'ai abordé beaucoup d'aspects de ce pays et situé l'action dans la période où j'y allais le plus : les années 90. Le Japon actuel me parle moins, je ne suis pas retourné récemment, je n'y ai donc pas de vécu que je pourrais« recycler » dans mes romans, qui décrivent des atmosphères et des époques précises. Et d'autre part j'en avais marre d'être catalogué comme l'éternel« spécialiste du Japon », celui à qui on ne cesse de téléphoner ou d'écrire pour avoir des infos sur tout et n'importe quoi là-bas ; alors que je ne suis ni journaliste ni guide touristique ! Je suis encore profondément imprégné par cette culture, je l'aime et la respecte autant qu'avant, mais j'ai décidé, à présent que je« sais » écrire des romans noirs, de parler de sujets plus proches, plus« urgents » ; et que je n'aurais su aborder quand j'étais plus jeune, concernant l'Europe et les menaces qui pèsent sur nous ici actuellement. Dans Lolita complex, je décris, de façon parfois comique parfois tragique, les horreurs néo-libérales du catastrophique« modèle anglais » que nos politiciens idiots, de droite comme de prétendue gauche, voudraient nous imposer ; ils ont d'ailleurs déjà commencé, et nous commençons à en souffrir les résultats. Mon roman suivant se situera à New York à l'époque du 11 septembre 2001. Le titre général de la trilogie, L'Océan de la stérilité, s'inspire de la Mer de la fertilité, la tétralogie que Mishima a achevée juste avant son suicide. Ce n'est pas un titre particulièrement optimiste, et l'« état des lieux » que je vais dresser ne le sera pas non plus.
Au travers de leurs innombrables références aux sectes apocalyptiques, aux criminels de guerre, aux milieux artistiques et criminels, aux formes de sexualités troubles et autres bizarreries contemporaines, je classerais sans hésiter vos romans dans la littérature de genre, dans ce que le dit« genre » a de plus noble. Est-ce pour vous un compliment ou quelque chose de négatif ?
C'est flatteur dans la mesure où des auteurs que j'admire ont en effet donné au« genre » ses lettres de noblesse ; je pense à Léo Malet en premier lieu, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres : Arthur Conan Doyle, G. K. Chesterton, H. P. Lovecraft, Jim Thompson, David Goodis, etc. etc. Mon premier roman, Phuong-Dinh Express, paru en 1983 aux Humanoïdes Associés, était assez inclassable, quelque part entre le punk et mes« parrains » anglais : James G. Ballard et Michael Moorcock. Plus tard, Patrick Raynal m'a demandé de lui livrer une Série Noire se passant à Tokyo, cela a donné Un été japonais, et ses suites. J'ai aussi écrit un Poulpe, Saké des brumes, où je parle des Kamikaze japonais pour finalement m'interroger déjà sur le futur de l'Europe. J'aime beaucoup mélanger les genres, les sujets qui à priori n'ont rien à voir entre eux. Ce sont d'ailleurs les« ponts » bizarres que je dois créer afin de relier tant bien que mal ces éléments, qui me fournissent des pistes originales pour bâtir l'intrigue. Quoi qu'il en soit, je remarque que ce sont souvent des auteurs dits « populaires » qui font encore, parfois plus de cent ans après la sortie de leurs livres, les plus gros tirages : Alexandre Dumas, Maupassant, Simenon... Si on les lit encore, ce n'est pas seulement parce que leurs histoires étaient très lisibles (ils savaient raconter des histoires, justement, ce qui n'est pas le cas de nos habituels« goncourables » destinés à être vite oubliés), mais parce sous une forme attrayante ils avaient aussi des choses fondamentales à dire. De même pour les grands romanciers américains que je considère comme mes maîtres : Dashiell Hammett, Ernest Heminway, James Crumley, Jim Harrisson...
Quelle est l'origine de votre engouement pour le Japon et l'Asie ? Et de manière plus générale, comment expliquez-vous l'engouement pour l'Asie qui transparaît dans de nombreuses oeuvres et vagues culturelles de ces vingt-cinq dernières années, depuis les échoppes de Blade Runner jusqu'aux cyberpunks tokyoïtes de William Gibson (pour faire très court) ? J'ai lu que vous aviez été marqué par les images de la guerre du Vietnam...
C'est une question que l'on me pose souvent, et là pour faire simple, je vais résumer en vrac les éléments déclencheurs personnels, qui remontent à mon enfance et à mon adolescence : une prof de piano taïwanaise ; un architecte japonais ami de mes parents et qui m'a enseigné le maniement des baguettes ; la pureté graphique du drapeau nippon (une tache de sang s'élargissant sur un bandage blanc ?) ; les images de la guerre du Vietnam dans Paris-Match ; des estampes japonaises achetées aux puces de Paris et de Londres ; les tractoristes et nageuses chinoises dans les revues de propagande maoïstes ; et last but not least des petites amies asiatiques...
Quant à l'engouement des Occidentaux pour l'Asie, il ne date pas vraiment d'hier (les estampes étaient collectionnées par les peintres impressionnistes et ont influence, entre autres, Van Gogh et Gauguin). Mais à partir des années 80 je pense que le renouveau technologique du Japon lié à un mélange mangaïque d'arts martiaux et de libéralisme sexuel, ont eu un fort pouvoir attractif à la fois sur la jeunesse et sur l'intelligentsia occidentales.
Différentes villes et régions de l'archipel nippon, Lyon, Londres... Mais Paris manque à l'appel. Est-ce la ville qui ne vous inspire pas ? Ou vous sentez-vous trop proche de Paris pour l'intégrer dans un récit ?
Je m'en sentais en effet trop proche, et puis, nul n'étant prophète en son pays, je me suis fait plus facilement remarquer en parlant de Tokyo ! En fait, j'y ai déjà situé au moins une nouvelle, Le Dernier Crime de Guy Georges, mais elle est parue dans Paris Noir, un recueil publié à Londres ! Mais je dois écrire un roman à paraître à l'automne aux éditions Parigramme, dans une collection où seront abordés des aspects très contemporains de la capitale. Et puis qui sait, il n'est pas impossible que pour le troisième épisode de L'Océan de la stérilité, Gilbert Woodbrooke prenne l'Eurostar pour venir à Paris...
A la lecture de Mortelle résidence, on en vient vraiment à s'interroger sur votre propre expérience d'artiste invité aux Subsistances à Lyon. Etait-ce aussi absurde et tragico-comique que la version romanesque du livre ?
C'était exactement comme ça. Je me suis contenté de changer les noms des protagonistes, et de fusionner deux artistes anglaises en une seule, pour restreindre le nombre de personnages. Et Steven Cohen, le performeur sud-africain, n'était pas là au moment où j'y étais, mais j'ai utilisé ses interviews ainsi qu'une coupure de presse racontant sa « performance sauvage » au Centre d'Histoire de la Résistance, à Lyon, et l'intervention brutale des flics... La seule différence notable est qu'il n'y a pas eu de morts chez les artistes à la fin, seulement quelques crises de nerfs. Les mesquineries de l'administration du Centre, les vols de matériel et disparitions d'ordinateurs, le directeur germanique pris entre deux feux, de tout cela j'ai été le témoin effaré et amusé, me disant que cela ferait un super sujet de livre. Après, comme il s'agit réellement d'un ancien couvent, j'ai eu l'idée de rajouter l'église baroque brûlée sous la Révolution, la crypte transformée en cachot et lieu de torture, les fantômes, etc. Mais l'histoire ésotérique de Lyon est tellement riche en la matière, que dans cette ville tout cela était presque plausible (j'ai d'ailleurs rencontré des Lyonnais qui y ont cru). Quant à l'histoire officielle, elle m'a fourni les épisodes de la guerre civile de 1793, eux aussi sanglants à souhait et assez peu connus ; et, mal connue également et tout aussi vraie, l'ex-secte nazie Colonia Dignidad au Chili.
Quelles furent les réactions des personnes réelles qui ont inspiré les personnages fictifs de ces romans ? Je pense notamment à une artiste lyonnaise« underground » qui fut l'élève d'Orlan, qui se plaît à citer Antonin Artaud en hurlant sa révolte contre l'absurdité du monde et qui en prend quand même pour son grade... (sourire)
L'artiste dont vous parlez, et pour qui j'ai de l'affection par ailleurs, même si dans Mortelle résidence je dépeins, entre autres, ses maladresses et son manque de diplomatie, j'ai pas mal hésité et ne lui ai toujours pas envoyé le livre, j'ignore si elle l'a lu. Mais je l'ai croisée récemment à Lyon et elle ne m'en a pas parlé. Elle n'avait pas l'air fâchée, en tout cas ! C'était un bon personnage pour le roman, et je voulais surtout montrer comment l'administration du Centre avait « récupéré » tout son boulot d'instigatrice et commissaire de l'événement Body Limits, ainsi que sa connaissance des artistes et du milieu des performeurs, pour finalement la sous-payer de façon éhontée, allant jusqu'à déduire mesquinement de son maigre salaire une porte-fenêtre cassée par son copain qui était bourré un soir... Mon idée était un peu d'expliciter au passage cette échelle des récupérations successives de l'art : en bas, on a les créateurs et autour d'eux dès le début les vrais connaisseurs (qui n'ont en général ni le fric ni les bons contacts) ; à l'étage au-dessus, on trouve les journalistes parisiens, les adjoints à la culture, les directeurs d'institutions, les propriétaires de « bonnes » galeries : tous ces gens qui vivent de ce monde de l'art et ont des moyens pour diffuser les artistes qu'on porte à leur connaissance, bons ou mauvais ; et en haut de l'échelle, les bailleurs de fonds : la mairie, les politiques, les patrons mécènes, les grands collectionneurs, les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture, etc. Ce qui est drôle, c'est qu'en général plus on monte et moins les gens s'y connaissent en art !
Quant au directeur des Subsistances à l'époque, un homme agréable et intelligent avec qui j'avais des rapports plutôt amicaux, je lui ai déposé le livre, avec une dédicace et un mot gentil, au Centre culturel suisse qu'il dirige actuellement, et n'ai toujours pas eu de réponse ! Peut-être n'a-t-il pas apprécié que je montre son côté dragueur... Pourtant, en utilisant de vraies interviews de lui parues dans la presse lyonnaise à l'époque, et les scènes auxquelles j'ai assisté moi-même au cours de ma résidence, j'ai voulu lui rendre justice et je pense avoir assez fidèlement décrit sa situation difficile, son rôle de bouc émissaire pour la Mairie qui en fin de compte n'a pas renouvelé son contrat, ainsi que les tirades vengeresses qu'il devait supporter de la part de la fan d'Artaud dont nous parlions précédemment. Rien que pour ça, il devrait me dire merci !
Vous ne ménagez pas le milieu de l'art contemporain qui se trouve donc au centre de vos deux derniers romans, Mortelle résidence et Lolita complex. Quels ont été vos rapports, en tant que photographe et illustrateur, avec les instances artistiques ? De ce que j'en ai compris, ils semblent avoir été plutôt conflictuels, ce qui justifierait ce jeu de massacre pour le moins jouissif...
En tant qu'illustrateur, pas de rapports car les milieux de l'art sont très cloisonnés, surtout en France, et, selon les modes de pensée y ayant cours, une illustration ne peut pas être de l'art contemporain. L'illustration, c'est un circuit différent, où les prix en galerie peuvent atteindre un niveau pas si nul (mais qui ne montera jamais plus haut), avec comme acheteurs des petit-bourgeois, des directeurs artistiques d'agence de pub, etc. Dans un registre voisin, une planche de BD peut valoir plus qu'une illustration, mais à condition que l'artiste soit vraiment très connu, comme Druillet, Moebius, Tardi, Bilal etc., et dans ce cas des prix pharamineux sont parfois obtenus en salle des ventes. J'ai commencé à avoir des expositions avec la BD (planches de Prisonnière de l'Armée rouge ! exposées chez Elisabeth de Senneville au début des années 80), et eu quelques collectionneurs éclectiques comme Jean-Pierre Lavigne qui achetait aussi les toiles d'Erró et des dessins du groupe Bazooka. Puis j'ai exposé les petites peintures de la série Tristes vacances et mes premières photos médicales à la galerie Deep à Tokyo, en 91 et 93. J'ai eu beaucoup d'expos depuis que je me suis mis à la photo, dont une à la galerie Feature, à New York, une très bonne galerie d'art contemporain, et d'autres à Berlin, Londres, Stockholm. (Mon expo à New York fournira le cadre de mon nouveau roman de la série Woodbrooke.) Mais j'ai souvent aussi été exposé dans des lieux bizarres, et par des« galeristes pirates » comme celui que j'appelle Julius B. Hacker dans mes livres. Le critique d'art Michel Nuridsany m'a invité à exposer aux Rencontres d'Arles en 95, et là j'ai été confronté de plein fouet avec les horreurs du milieu de l'art chez nous, c'est-à-dire en vrac : snobisme, conservatisme, élitisme, copinages, sectarisme, hypocrisie pudibonde, ignorance crasse, suivisme, confusion avec la mode, bêtise triomphante, et mauvaise foi totale. À part les articles du critique photo des Inrockuptibles, Hervé Le Goff, qui m'a courageusement soutenu de bout en bout, et l'intervention de la photographe Claude Alexandre, les Rencontres ont donné lieu à une sorte de curée médiatique (très cocasse au demeurant) qui a suivi l'interruption de la projection, au théâtre antique, de mon film vidéo sur Araki et Tokyo, Un monde flottant, au cours d'une violente cabale montée par une frange soi-disant« féministe » des habitués des Rencontres (qui en réalité avaient un compte à régler avec Nuridsany, le nouveau directeur artistique).
Bref, depuis ce temps je continue à exposer (en France à la galerie Sollertis, qui fut, je crois, la première à exposer Sophie Calle, et en février prochain à Barcelone à la galerie Fidel Balaguer) sans trop chercher à lécher les culs pour aller plus vite, et je laisse mon travail se diffuser tout seul, à son rythme. Je trouve beaucoup plus réjouissant de décrire la triste réalité de l'art contemporain et ses mensonges, dans mes livres, tranquillement, et de plus en plus férocement j'espère. D'abord parce que mes romans, publiés chez Fayard, Gallimard, etc., peuvent laisser une trace plus forte que des impostures ou travaux médiocres que demain tout le monde aura oubliés (une fois les critiques d'art et collectionneurs s'étant sucrés au passage, faisant monter les prix en se revendant les oeuvres entre eux puis aux gogos, avant de jeter l'artiste comme une capote sale). Ensuite parce que ce que je dis les énerve ; je suis un peu le petit garçon qui s'écrie ingénument, devant toute la Cour :« Mais le roi est nu. » Enfin parce que, et c'est assez comique, grâce à la notoriété que j'acquiers par des romans où le lecteur rigole bien tandis que je me fais une joie de dézinguer tous ces affreux jojos et josettes, au bout du compte les prix de mes oeuvres augmenteront probablement tout seuls... puisque aujourd'hui c'est le nom qui semble faire la valeur de l'oeuvre alors que cela devrait être l'inverse. A vrai dire, je vois mille fois plus de travaux intéressants ces temps-ci sur Myspace, réalisés par des garçons et filles qui ; parce qu'ils n'ont pas les relations qu'il faut ou habitent au milieu de nulle part ; n'ont que le web pour s'exposer, que sur les cimaises de la Fiac ou, pire, de Slick qui est un bon exemple de ce dont je parle, ce minable étalage faussement branché d'oeuvres éphémères, rarement intéressantes.
Le problème de l'art moderne, depuis le brillant passage de ces génies de la provoc' et de la sensation que furent Warhol ou Duchamp, c'est qu'il existe de moins en moins de critères objectifs pour juger. La valeur est fabriquée par le jargon du critique d'art, par une célébrité de l'artiste fabriquée en surfant sur la ou les modes. Un galeriste ou une foire internationale d'art peuvent exposer 80% de n'importe quoi sans que quiconque puisse prouver d'imposture. Tandis qu'en édition, c'est différent : Dieu merci, il existe encore des vrais éditeurs, en dépit des phénomènes de mode. On ne peut pas vraiment truquer en littérature, publier n'importe quoi, un bouquin sans queue ni tête. Les gens ne l'achèteraient pas, tout simplement â et de nos jours c'est la logique économique qui dicte tout. Même les merdes que produit Amélie Nothomb sont quand même plutôt bien écrites techniquement. Même Houellebecq a un certain talent, qu'on apprécie le personnage et ses idées, ou pas. Et les maisons d'édition disposent aussi d'éditeurs et de correcteurs qui feront disparaître la plupart des fautes, qu'elles soient d'orthographe ou de logique ou autre. Alors que quel galeriste irait corriger les fautes de dessin ou les fautes d'art de son artiste ? C'est une idée absurde, évidemment. De toute façon je pense que, comme il l'a toujours relativement bien fait, le temps opérera la vraie sélection, pour l'art contemporain aussi. En attendant, moi je me sens bien plus à l'aise dans les milieux du livre (et surtout celui du polar, plus généreux et convivial) que dans ceux de l'art aujourd'hui...
Ayant vous-même essuyé probablement pas mal de plâtres suite à vos oeuvres visuelles, comment réagissez-vous à l'engouement récent du milieu de la mode et des médias pour le fétichisme ?
S'ils m'englobent dedans, je ne suis pas contre ! J'espère simplement que les vrais précurseurs du fétichisme en art ne seront pas oubliés ; comme ont été oubliés Boris Lurie et le groupe d'artistes juifs new-yorkais du No !art, qui sont pourtant les vrais inventeurs du Pop-art à la fin des années 40, et dont je parle dans mon roman Averse d'automne.
On lit aujourd'hui des critiques de vos travaux photographiques qui parlent de tendresse et d'empathie, qui évoquent même le féminisme. Est-ce que vous vous sentez mieux compris aujourd'hui que par le passé et si c'est le cas, à quel moment et de quelle manière avez-vous senti un changement ?
C'est très difficile de percevoir ce genre de choses par soi-même. Un tel changement peut avoir pour cause le simple fait de l'élargissement de ma notoriété, ce qui change l'attitude des gens à mon égard (on a tendance à faire montre de plus de considération vis-à-vis de quelqu'un qui vous est présenté comme« connu »). Concernant les photos, il est toujours assez difficile de générer l'enthousiasme de quelqu'un qui n'a jamais vu mes images et de lui dire que je photographie des femmes blessées, avec des plâtres et appareils orthopédiques. Seule une catégorie assez spéciale de personne va s'écrier« Ouah, super ! » en l'entendant présenter comme ça... En France, on a quand même besoin d'une certaine dose d'explications théoriques pour faire passer le concept d'« art médical », mais une fois expliqué, j'obtiens souvent maintenant des réactions assez favorables. Commençant par :« Ah bon, je ne l'avais pas vu sous cet angle... » Et actuellement, grâce à Myspace toujours, il m'est très facile de recruter des jeunes et jolies modèles bénévoles en France, ce qui n'était certainement pas le cas il y a quinze ans, où je n'en trouvais qu'au Japon. Mais si de nos jours certains (pas tous !) commencent à parler de féminisme à propos de mon travail ; même si ce n'est pas faux non plus concernant mes photos qui sont un acte d'amour envers mes« blessées » ou« convalescentes », c'est à mon avis à cause de Lolita complex, roman où pour la première fois je prends clairement la défense des jeunes filles violées et battues, victimes chez nous d'une hypocrite consommation de l'Est par l'Ouest, du pauvre par le riche, du faible par le puissant, etc.
Une question pour l'ancien maoïste qui sommeille sans doute toujours en vous... Les déviances, qu'elles soient sexuelles, artistiques ou plus largement culturelles, sont à la fois au centre de vos romans et remises à leur place par le biais des personnages qui les y incarnent. Et justement, quelle place reste-t-il pour la transgression dans la société foncièrement amorale qui est la nôtre aujourd'hui ?
« Amorale » ? Vous ne voulez pas dire, plutôt« moralisatrice » ? (ou« infantilisante » ?) En ce moment, je ne vois d'amoralité qu'en politique et dans le libéralisme commercial à outrance qui nous submerge. J'aurais tendance à croire au contraire qu'on assiste à un grand retour, y compris chez les jeunes, du politiquement correct sur le plan du sexe et des relations de couple, et retour en force du mariage également. Et, depuis un bout de temps, à une chasse aux prétendus pédophiles, pervers, etc. Bon, les gens se rencontrent en douce grâce à Meetic et internet, mais pour moi qui ai vécu les années 70 et 80 à Paris, je vois les années 2000 comme plutôt tristes ! Les auteurs qui célèbrent la jouissance et la vie se font insulter en débat public par des pétasses journalistes ignares du Nouvel Obs qui essayent pathétiquement de ressembler à Jane Fonda, un grand écrivain comme Gabriel Matzneff est relégué au placard parce qu'il a initié à l'amour des dizaines de très jeunes adolescentes qui ne demandaient que ça, on parle à peine de Pierre Bourgeade, autre écrivain français majeur, les photographes fétichistes restent confinés dans un ghetto les excluant des grands réseaux du marché de l'art, ou alors il faut aller vraiment aux extrêmes, comme Joel Peter Witkin avec ses natures mortes de cadavres, ou être japonais avec des petites lunettes rondes comme Araki, pour se faire véritablement remarquer. Bon, il y a les modes fétichistes et les soirées SM ou autres, mais je vois ça plus comme une façon de s'habiller branché pour sortir le soir, que comme une vraie révolution des moeurs... Même mes amis auteurs de polars pourtant très noirs, paraissent assez choqués par mon travail photographique. Non, tout va bien, je sens qu'il me reste du pain sur la planche, et pas mal de choses à transgresser !
L'amoralité à laquelle je faisais référence était précisément celle des cercles politiques et institutionnels, ainsi que celle du monde des affaires. A quelques rares exceptions près, on est loin de la vieille droite moraliste de l'après-guerre. Outre le vieil épouvantail de la pédophilie que l'on nous sert à toutes les sauces sécuritaires, que reste-t-il selon vous comme réels vecteurs de transgression ?
Hum, je pense que la droite, ou du moins les cercles du pouvoir, en France comme ailleurs, ont eu de belles périodes d'amoralisme dans le passé : exemple, les fortunes incroyables qui se bâtissaient sous Louis XVI peu avant la Révolution, alors que le peuple crevait de faim... Quant à la transgression, les images que je produis, les femmes blessées etc, je les réalise surtout parce qu'elles me plaisent, et, au fond, le fait de choquer des imbéciles, de transgresser un quelconque interdit, est juste un petit plaisir personnel supplémentaire et secondaire. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est que ces images existent, que je puisse faire passer dans la réalité artistique de telles reconstructions, de telles « mises en scène » de mon paysage mental.
Contrairement à la tendance, un peu passée de mode, qui était de publier et promouvoir des écrivains très jeunes, il m'a toujours semblé qu'un minimum de vécu était nécessaire avant de se lancer dans l'écriture. Comment situez-vous votre propre processus d'écriture dans votre parcours artistique, d'autant que vos romans se basent amplement sur votre vécu et vos expériences personnelles ?
J'ai commencé très, très lentement... Au début, il y a eu les textes de mes BD, souvent elles-mêmes, à l'origine, des adaptations de textes de roman-photos, ou d'opéras communistes, par exemple, ou des petits scénarios écrits par des amis, comme Max Fournier qui avait travaillé avec Loustal... Et puis il y a eu Phuong-Dinh Express, que j'ai écrit en 1982 et qui a démarré comme une nouvelle, dont j'ai eu envie d'écrire la suite, et c'est devenu une enfilade de chapitres ; pour la plupart basés sur des expériences personnelles de vie dans un squat et divers appartements à Londres, dans les années 70, et après j'ai brodé et transformé ça en jeu de massacre... Donc, oui, il y a eu du vécu personnel à la base de tout ça, comme pour Un été japonais que j'ai écrit en me replongeant dans le Journal que je tenais durant mes séjours à Tokyo. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord qu'il faut avoir vécu avant d'écrire. À vingt ans, je n'avais pas grand-chose à raconter, et je n'aurais pas osé, de toute façon. Ecrire, c'est se livrer, c'est assez impudique comme démarche, et il faut trouver un biais, une façon de fictionner la réalité. Chez moi, cela a vraiment fonctionné à partir du moment où j'ai eu l'idée de ce double qui n'en est pas vraiment un, ce Gilbert Woodbrooke qui vit à la fois ce que j'ai vécu et ce que je n'ai pas vécu. Il est mon ambassadeur dans le monde, une sorte de Candide de l'an 2000, et il appuie à ma place là où ça fait mal... Il me permet de m'exprimer sincèrement et parfois avec violence, ou avec douceur aussi, tout en me moquant de moi-même et des autres. Et puis, à côté, je fais d'autres romans où j'explore d'autres directions, le genre d'une part (le polar, le fantastique) et la littérature générale d'autre part, comme dans Nao aux PUF ou La Japonaise de St John's Wood chez Zulma et avec un roman épistolaire (ou plutôt internétique) à paraître en mars 2009 au Serpent à Plumes. En tout cas le rythme augmente, l'écriture prend de plus en plus de temps dans ma vie et j'arrive à aller jusqu'au bout d'un pavé de 500 pages en quatre ou cinq mois. Actuellement, j'écris un peu plus de deux romans par an, en moyenne. Si je pouvais devenir un nouveau Simenon ça m'irait très bien. Je suis déjà chez Fayard, qui était son éditeur...
Est-ce que les lecteurs du Romain Slocombe écrivain connaissent le photographe ou s'agit-il de deux publics bien distincts ? Et si c'est le cas, comment réagissent vos lecteurs en découvrant cette autre dimension ?
Parfois ils connaissent toutes les facettes de mon travail, parfois une seule. Les étrangers, malheureusement, n'ont pas trop accès à mes romans, à moins de lire suffisamment le français. Un été japonais a été traduit en italien, et Lolita complex va être traduit en Roumanie et en Tchécoslovaquie. Au début de mon passage à la photo, il y a eu des mécontents qui préféraient les peintures et illustrations aux photos. Quand j'ai photographié des paysages de Tokyo (dans Tokyo Blue, Isthme éditions, 2005), il y a eu des fans de mes photos mécontents que je photographie moins de Japonaises blessées. Quand je me suis mis à photographier des jeunes Occidentales blessées, il y a eu des fans qui m'ont reproché de ne plus photographier des Asiatiques... Cela m'amuse beaucoup. Après tout, surprendre mes fans c'est aussi peut-être pour moi une forme de transgression !
Au-delà de la simple citation, on sent comme un intérêt pour l'ésotérisme de votre part au travers de la dimension alchimique de la ville de Lyon dans Mortelle résidence ou de ce que j'ai perçu comme des références à l'illumination d'Aleister Crowley en Egypte dans Lolita complex. S'agit-il d'un intérêt circonstanciel, lié à la nature de vos récits et de vos personnages, ou de quelque chose de plus personnel ?
J'étais un gros lecteur d'histoires horrifiques lorsque j'étais ado. Poe, Lovecraft, Robert Howard, Carl Jacobi... Et j'ai vu presque tous les films de la Hammer dans les années 60/70 ; je sortais du lycée en courant pour me précipiter au Styx, la petite salle spécialisée en cinéma d'horreur, au Quartier Latin. D'autre part, j'ai accumulé au fil du temps beaucoup de livres sur l'ésotérisme, pas tellement parce que j'y crois mais parce que je me suis dit que j'y trouverais des tas de sujets pour des romans à venir. Disons que je crois à certains cas de hantise, ceux qui reposent sur des témoignages sérieux. On ne peut pas tout expliquer dans l'état actuel de nos connaissances, en tout cas, et j'aime placer des détails un peu surnaturels dans mes romans, tout en respectant une certaine logique. Pour revenir à votre question, en ce qui concerne Lyon l'ésotérisme s'imposait, évidemment, pour des raisons citées plus haut. Dans Lolita complex, il se trouve que Richard Dadd, le peintre parricide, a réellement eu une illumination (ou une forte insolation) en Egypte, et cela a déclenché ou précipité les effets de sa psychose. Je n'ai pas pensé à celle d'Aleister Crowley, j'avais oublié cet épisode, en revanche j'ai mis certaines paroles de Crowley dans la bouche du fantôme de Dadd ; j'ai souvent recours à ses textes lorsque j'ai besoin de phrases inquiétantes, saugrenues ou délirantes... Au fait, bizarrement, mon grand-père George Slocombe, journaliste et historien anglais, a interviewé Crowley vers la fin de la vie du« magicien », et en parle (pas très charitablement, d'ailleurs) dans ses mémoires...
Je sens que l'anecdote va passionner certains lecteurs de La Spirale. Que disait votre grand-père de sa rencontre avec Aleister Crowley ?
Hélas je vais les décevoir ! Suite à votre question, j'ai relu The Tumult and the Shouting, ses souvenirs de journaliste écrits en 1934-35, et n'ai pas retrouvé le passage dont je me souvenais pourtant fort bien. Des pages effacées, un tour de passe-passe réalisé outre-tombe par le Magicien ? A moins que ce ne soit dans un autre livre de mon grand-père...
J'ai lu dans une interview que vous étiez déçu de l'époque actuelle, à contrario des espoirs et des promesses des années 60 et 70. En même temps, l'époque actuelle me semble aussi bien incarner les fantasmes les plus noirs du punk et du post-punk des années Bazooka et Métal Hurlant. Ayant finalement vu juste à l'époque, quels sont vos pronostics pour la suite ?
Il faut préciser que je n'ai jamais été punk, même si j'ai côtoyé de très près les membres de Bazooka, depuis la création du groupe, alors que nous étions étudiants aux Beaux-Arts de Paris, en 73. Je souhaitais donc, personnellement, que moi, et le monde, nous ayons un futur, pas No Future. Nos images étaient un commentaire sur l'époque, de même que mes écrits actuels le sont. Si je suis déçu, voire écoeuré ou terrifié par l'évolution actuelle, c'est parce les avancées de nos sociétés« démocratiques », héritage de mai 68 et des luttes du tiers-monde etc, les valeurs d'internationalisme, de solidarité, de fraternité, de liberté sexuelle et ainsi de suite, idées peut-être un peu naïves ou primaires, mais importantes parce que leur contraire nous précipite droit en enfer, tout cela me paraît fortement remis en question dans la tête des gens. L'éducation est une valeur en baisse dans les objectifs de nos politiciens. Ce sont les valeurs du fric et de l'individualisme qui ont triomphé, et même lorsque le capitalisme perd les pédales, il ne rencontre aucune opposition organisée, parce que la fin du XXe siècle a été également l'échec et la fin des idéologies. Les ouvriers qui naguère auraient occupé les usines et séquestré leurs patrons pour beaucoup moins que ce qu'on leur inflige aujourd'hui, sont maintenant juste angoissés, assommés, écrasés. Tout ce qu'on aura désormais, comme action revendicative, à mon avis, ce seront des grèves larvées et des révoltes du désespoir, des incendies en banlieue et des bris de vitrines. Et un monde de plus en plus divisé en plus riches et en plus pauvres, grosso modo comme dans les pires prémonitions de George Orwell ou d'Aldous Huxley. Les affrontements actuels à Gaza en donnent une assez terrifiante vision. En symboles de ce début du XXIe siècle, je verrais assez bien le téléphone portable et la Kalachnikov.
Je partage votre analyse sur l'époque et je me méfie aussi de la dépressivité ambiante. Ne doit-on pas ajouter la passivité, le nombrilisme ou la fainéantise à la longue liste des tares de nos sociétés, en complément des valeurs du fric et de l'individualisme ? Certes, nous traversons une passe difficile, une période charnière dont Norman Spinrad parle très bien dans son texte La crise de transformation, mais il me semble aussi qu'il n'y a jamais eu de meilleure période pour s'exprimer, partager et agir. Et finalement, il me semble qu'une majorité de nos contemporains passent plus de temps à se plaindre ou à afficher une façade dépressive qu'à agir pour changer leur quotidien...
Moi aussi je passe un certain temps à me plaindre ou jouer les dépressifs comme Woodbrooke ! Mais, d'un point de vue créatif et artistique, nous vivons peut-être une époque féconde, comme toutes les périodes de décadence pré-fascistes ou d'avant-guerre ! Et je m'efforce d'y participer à ma façon. Mes modèles blessées pourraient symboliser alors assez bien ce genre d'angoisses ou, selon les points de vue, de jubilation décadente...
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.