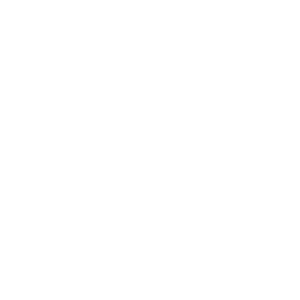ARIEL KYROU « DANS LES IMAGINAIRES DU FUTUR »
Enregistrement : 15/03/2021
Mise en ligne : 15/03/2021

Plus que jamais, il apparaît urgent de repenser notre monde, la place que nous y occupons et notre devenir « mutant ». De nous interroger sur les solutions pour notre avenir commun, ainsi que nous invitent à le faire depuis des décennies les écrivains de science-fiction. Et enfin de sortir de l’impasse dont semblent désormais prisonniers nos imaginaires, entre utopies et dystopies, entre démesure technologique productiviste et apocalypse environnementale.
C’est ici la lourde mission que s’est fixé le journaliste, essayiste et écrivain Ariel Kyrou au travers d’un impressionnant livre de 600 pages : Dans les imaginaires du futur, sorte de Bibliothèque de Babel à la Borges, sous-titré « Entre fins du monde, IA, virus et exploration spatiale » et « volte-facé » par un Alain Damasio, désormais aussi furtif qu'omniprésent.
À n'en pas douter, un nouvel ouvrage de référence pour qui s'interroge sur les temps présent et à venir. Pour qui s'intéresse aux grand défis de notre époque et aux réponses que peuvent leur apporter l'imagination et la créativité humaines.
Propos recueillis par Laurent Courau.
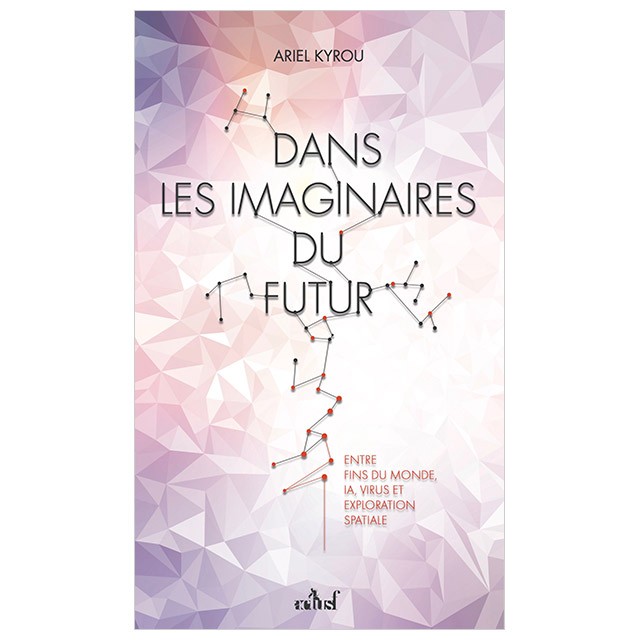
Ton intuition est juste, et pour cause : le premier roman que j’ai lu en dehors des devoirs scolaires, autour de mes dix ou onze ans, a été Martiens, go home ! de Fredric Brown, dans la regrettée collection Présence du futur de Denoël, avec son point d’exclamation penché de travers sur la couverture. C’est une histoire d’insupportables petits nains verts qui, du jour au lendemain, se téléportent partout sur Terre et foutent la zizanie parmi les hommes, qu’ils appellent tous « Toto », tandis qu’ils affublent les femmes d’un délicieux « chouquette ».
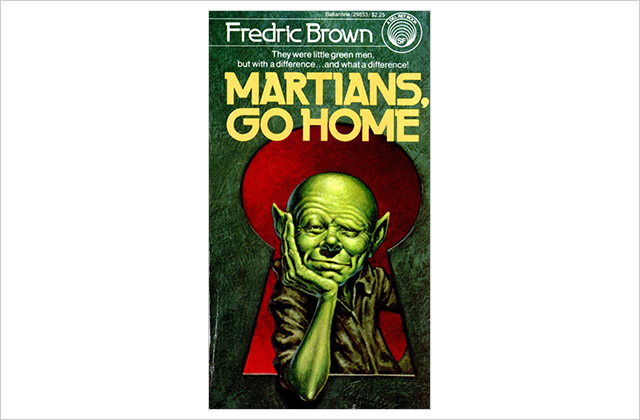
Après ce roman des années 1950, que m’avait suggéré mon père et qui m’a bien fait rire dans la première moitié des années 1970, je me suis servi allègrement dans toute sa bibliothèque, dominée par les littératures de genre. C’est ainsi que je suis tombé, dans le registre de la fantasy, sur la série des Elric le nécromancien de Michael Moorcock. Je l’ai lu dans la collection reliée du Club de l’anticipation des Éditions Opta, avec l’image de l’épée buveuse d’âmes Strombringer, traversant l’univers sur la couverture, et les dessins de Philippe Druillet à la fin du bouquin, tout en écoutant le hard rock cosmique de Hawkwind, « The Psychedelic Warlords (Disappear in Smoke) » de l’album Hall of the Mountain Grill ou les déclamations de ce même Michael Moorcock dans Warrior on the Edge of Time, dont la pochette s’ouvre vers le bas pour se transformer en bouclier…

Mais ces références-là ne sont pas le cœur de Dans les imaginaires du futur, non ?
Elles auraient pu l’être, car elles sont en quelque sorte mon bain primordial. D’ailleurs, je n’ai pas pu résister à la tentation de citer Martiens, go home ! dans mon chapitre « Extraterrestre ». Mais parmi les livres majeurs qui ont bercé mon adolescence, certains sont bien présent dans mon essai, comme Ubik ou Le Dieu venu du Centaure de Philip K. Dick, mais aussi des romans que je connais presque par cœur à force de les relire comme Tous à Zanzibar (1968) de John Brunner ou Jack Barron et l’éternité (1969) de Norman Spinrad. Pour l’anecdote, à propos de ce dernier opus, œuvre remarquable de la contre-culture, j’étais à ce point fasciné par le personnage créé par Spinrad, bateleur d’une émission de télévision déshabillant les puissants tel ce milliardaire prêt à tout pour atteindre l’immortalité, que j’ai adopté le nom « Jack Barron » comme l’un de mes pseudos d’écriture.

Ces textes de fiction spéculative, très politisés et dans un futur proche, ont été associés au mouvement de ce qu’on a appelé en science-fiction la « new wave », né au milieu des années 1960, mais dont les livres ont été publiés pour l’essentiel en France dans la première moitié des années 1970. Au regard de la crise environnementale et climatique d’aujourd’hui, que John Brunner a par exemple anticipé avant le rapport du Club de Rome de 1972, ils ont à mon sens mieux vieilli que la plupart de leurs équivalents « cyberpunk » du milieu des années 1980. Sur ce registre, enfin, impossible de ne pas citer les premiers romans de J.G. Ballard, jusqu’à IGH (1975), avec une passion particulière pour Sécheresse (1965). De lui comme de Philip K. Dick, l’adolescent fan de science-fiction et de fantasy délurée que j’étais ne comprenait pas tout, c’est un euphémisme… Mais j’adorais d’autant plus tous ces auteurs que, via mes parents – mon pater ayant publié en 1952 un livre devenu depuis une référence, Le surréalisme au cinéma – j’associais leurs univers aux paysages de rêves et de cauchemars des peintres Yves Tanguy ou Max Ernst…

Comment as-tu procédé pour organiser cette impressionnante quantité d’information ? Quel a été ton cheminement intellectuel depuis l’idée initiale de ce livre, jusqu’à sa rédaction finale ?
Je n’avais absolument pas prévu d’écrire un essai aussi copieux. Sa genèse remonte à fort longtemps. Lorsque j’étais journaliste au mensuel Actuel, entre fin 1988 et son arrêt fin 1994, je n’ai quasiment pas écrit sur la science-fiction dont je me gavais pourtant, grattant plutôt sur l’histoire de la bombe atomique, la vie artificielle, l’Internationale situationniste, les Surréalistes ou des penseurs comme Paul Virilio ou Jean Baudrillard… Mais c’est pourtant là, à Actuel, que j’ai commencé à opérer la jonction entre le monde des idées, de la philosophie ou des sociologies mutantes, et les univers de la science-fiction et de la contre-culture. Ce mix mêlant, pour réfléchir au monde comme il ne marche guère, des visions inspirées des œuvres de l’imaginaire et des réflexions de penseurs proches comme les deux cités plus haut ou Bernard Stiegler avec lequel j’ai écrit un livre court en 2015, L’emploi est mort, vive le travail !, s’est concrétisé en 2007 dans un essai, Paranofictions, justement sous-titré « Traité de savoir vivre pour une époque de science-fiction ».
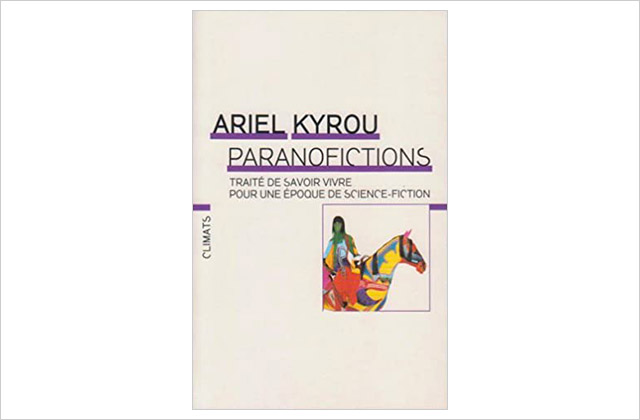
Donnant par ailleurs quelques cours sur « l’histoire critique des cultures actuelles » à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, mon sentiment d’une difficulté des étudiants et étudiantes à appréhender la question des imaginaires m’a confirmé dans mon désir de relier mes univers de fables futuristes, politiques, poétiques et psychédéliques, à la pensée philosophique, nourrie de sciences humaines, telle qu’elle se pratique dans les cénacles universitaires. Après tout, les écoles, quand elles ne contentent pas d’être des usines à compétition, sont censées cultiver l’esprit critique de leurs ouailles, la faculté de raisonner, d’argumenter rationnellement. Sauf qu’elles ignorent ou du moins sous-estiment l’importance de la sensibilité, des images, de l’imagination… Or cela devient très problématique dans un contexte urbain gouverné par des fictions, assumées ou non, le storytelling marketing, des publicités et propagandes souriantes pour l’hypercapitalisme et son « solutionnisme technologique » comme l’a épinglé Evgeny Morozov. Il y a là une faille, il est vrai fort utile aux gardiens du troupeau de moutons humanoïdes. Des penseurs et chercheurs, comme Fredric Jameson, Yannick Rumpala ou la moins connue Sylvie Catellin sur les nanotechnologies, contribuent certes à combler ce canyon intellectuel entre la pensée et les imaginaires, pour mieux nous permettre, par exemple, de réfléchir à la façon dont les imaginaires de Google ou de Facebook nous façonnent. Mais ils sont très rares à creuser de la sorte les représentations, les mythes réinventés, les utopies et les dystopies de nos sociétés contemporaines.
Mais comment, au départ, s’est concrétisée cette démarche dans tes écrits ?
Mon essai de 2007 chez Climat, Paranofictions, marqué par Philip K. Dick, J.G. Ballard ou Paul Virilio et Jean Baudrillard, a été le premier acte pour retrouver la démarche de penseurs comme Fredric Jameson, mais à partir des univers de l’imaginaire pour atterrir en territoires de pensée – plutôt que l’inverse comme lui ou Yannick Rumpala avec Hors des décombres du monde en 2018. Après Paranofictions, sous-titré « Traité de savoir vivre pour époque de science-fiction », mon travail a mûri au fil de mes écrits pour la revue Multitudes, dont je suis membre du collectif de rédaction avec des universitaires comme Yves Citton, Yann Moulier-Boutang ou Sandra Laugier – pour ne citer qu’eux trois. Je pense, parmi les étapes essentielles de cette maturation, à l’article « Fictions et contre-fictions de l'âge du cyborg » en 2012, ou surtout en 2016 à « Nos subjectivités baignent dans un imaginaire de science-fiction »… C’est à ce moment-là que l’envie de Dans les imaginaires du futur a pris forme plus solide dans mon esprit. J’ai commencé à y penser sans cesse, à prendre des notes dans un cahier dédié sur ce que j’aimerais y voir demain, en rebond de conversations ici et là, de la découverte d’œuvres de toutes sortes…
Comment, dès lors, as-tu procédé pour organiser tes idées et ces informations ?
J’ai toujours adoré annoter les livres au crayon. Mais depuis six ans, c’est devenu systématique, avec une accélération en 2017 et 2018, à l’occasion de travaux sur les imaginaires de l’intelligence artificielle, de plusieurs conférences et d’un article pour un laboratoire dont le suis chercheur associé, le COSTECH de l’université de Compiègne. Dans l’optique de mon exploration des imaginaires du futur, j’ai choisi, lu et relu des romans et des nouvelles, en soulignant et en écrivant des commentaires dans les marges, j’ai découvert ou le plus souvent regardé d’un œil différent des films et des séries plus ou moins piratés, en multipliant les arrêts sur image pour des prises de notes. L’idée de Dans les imaginaires du futur ne m’a plus quitté, me transformant parfois en somnambule à moitié présent dans sa réalité tangible. Autre truc : plus j’en parlais, là à Philippe Curval, ici à Catherine Dufour ou à toi, moins je pouvais reculer. Je devais enfin arrêter de papillonner et me mettre à l’écriture, non plus seulement d’articles comme « De la pluralité des fins du monde : les voies de la science-fiction », gratté pour Multitudes avec Yannick Rumpala à la fin du printemps 2019, mais de mon propre essai. Après avoir choisi comme éditeur ActuSF, pour sa motivation enthousiasmante, j’ai concrètement débuté l’écriture au début de l’été 2019, avec une foultitude de livres annotés, des idées dans mon cahier et un plan très longuement mûri, vu et revu, mais que je n’ai évidemment pas tenu. La suite, c’est du grand classique, jusqu’au tapuscrit final au tout début de septembre 2020, en profitant du confinement du printemps 2020 pour le dernier coup de turbo, avec à l’été pas mal de reprises de l’ensemble du texte, suite à des relectures précieuses – de mon épouse à Yannick Rumpala en passant par Daniel Kaplan du réseau Université de la Pluralité et bien sûr mon éditeur Jérôme Vincent. On n’écrit pas parce que l’on pense, mais pour savoir ce que l’on pense, en se laissant surprendre par l’inspiration. L’essai pas trop long que je voulais pondre est ainsi devenu peu à peu ce pavé rose et mauve aux chapitres courts et riches d’histoires que j’adore raconter, avec en plus la touche de maquette et de direction artistique qui a joué un grand rôle dans la lisibilité de ce livre dont l’épaisseur m’a étonné moi-même…
Ainsi que tu le rappelles très bien au fil de ton ouvrage, nos « imaginaires du futur » semblent désormais prisonniers de deux extrêmes bien identifiés, avec d’un côté les adeptes d’une démesure technologique qui aurait réponse à tout, et de l’autre les convaincus d’un effondrement systémique irrémédiable sur fond d’apocalypse environnementale. Comment expliques-tu que nous en soyons arrivés à un tel clivage et à des postures, en apparence du moins, irréconciliables ?
D’un côté, il y a le rêve, soi-disant à portée de transhumaniste hypercapitaliste, d’abolir toutes les limites de l’humain comme de la Terre grâce à des nouvelles technologies nous transformant en ridicules caricatures de super héros à la Marvel comics ; de l’autre, il y a le sentiment de n’avoir d’autre solution, en réponse à l’effondrement généralisé, que d’un retour à des limites fleurant bon le cosmos rabougri du Moyen Âge. La puissance évocatrice de ces deux imaginaires montre à quel point nous avons eu tort de négliger les conséquences de la sécularisation, de l’entrée dans notre quotidien bien réel des fantasmes et représentations de la destruction totale ou de la création à partir de rien de la vie, d’Hiroshima au clonage de la brebis Dolly.

L’apocalypse intégral et la fabrication du vivant restaient en effet, jusqu’au roman Frankenstein de Mary Shelley en 1818 (s’il faut en donner un point de repère parmi d’autres), le monopole des mythes et récits des religions monothéistes, loin de notre réalité de pauvres mortels, si loin de Dieu ici-bas. Les deux postures contemporaines que tu cites, désormais profanes, séduisantes, portées par de sincères convictions et apparemment opposées, me semblent aujourd’hui la conséquence d’un monde en profonde mutation, dont les valeurs bourgeoises se sont peu à peu délitées depuis le milieu des années 1960, pour enfin perdre aujourd’hui toute crédibilité.
Mais pourquoi une telle force de séduction de ces deux imaginaires ? Et pourquoi nous bloquent-ils autant ?
De façon plus censée et surtout plus active que le « complotisme » à la façon du documentaire Hold-up de fin 2020, ces deux imaginaires ont quelque chose de rassurant par la radicalité, le fatalisme et le déni de complexité qu’ils partagent. L’imaginaire transhumaniste pose une date certaine, même si variable selon ses apôtres et le moment de la prophétie, pour ce tournant de la Singularité technologique où nous n’aurions plus le choix qu’entre l’extinction de l’espèce humaine ou la fusion si désirable avec nos machines. Ray Kurzweil et le milliardaire russe qui soutient ce mouvement multiforme parlent de l’année 2045. Sur la rive opposée, collapsologiste donc, le désormais régionaliste et presque identitaire Yves Cochet, parlait en 2019 d’un effondrement chaotique « possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030 », la pandémie de Covid-19 étant devenue pour lui la preuve de sa vérité inéluctable. Ces deux postures, aussi différentes qu’elles paraissent, nous font perdre le goût du temps et nous font oublier l’importance de toujours préserver la pluralité des futurs, afin de pouvoir agir sur nos devenirs probables ou improbables, à notre échelle ou surtout celles des générations qui suivront. Comme s’ils ne pouvaient accepter de ne pas vivre eux-mêmes la rupture fatidique, les fidèles de ces deux obédiences mettent de la certitude là où le doute me semble de mise – même si les technologies se perfectionnent toujours et que le réchauffement climatique et les conséquences de l’Anthropocène n’ont pas fini de chambouler la planète. Leur opposition factice court-circuite la pensée et nous met en état de sidération. Mais l’une et l’autre postures, prises séparément, bouchent également nos horizons. Autrement dit : elles réduisent notre champ des possibles, là où jamais autant qu’aujourd’hui il n’a été indispensable de les ouvrir… Ce sont selon moi, au sens propre, des visions réactionnaires.
Sans trop dévoiler le contenu de ton livre pour ses futurs lecteurs, quelles seraient selon toi les meilleures pistes pour sortir de l’ornière que nous venons d’évoquer, entre une technophilie délirante et certains élans eschatologiques pétrifiants ? Pour l’écrire simplement, où perçois-tu la lueur d’autres imaginaires, aussi porteurs qu’alternatifs, capables de nous redonner le goût du futur ?
Vaste question, qui vaudrait la peine d’en faire un élégant pavé de 600 pages aux chapitres courts et aérés, ah ah ! La première clé, c’est de revenir aux sources de nos imaginaires d’aujourd’hui, plutôt que de se contenter de leurs instrumentalisations contemporaines très ras-du-marketing. Elon Musk, lorsqu’il présente le « neural lace » ou « lacis neural » de sa nouvelle société Neuralink, censé augmenter nos capacités cérébrales grâce à des connexions directes aux intelligences artificielles, ne dit pas qu’il a piqué le terme et le principe même de la chose dans les romans de la série de la « Culture » de Iain M. Banks, civilisation utopique d’un très lointain futur. Et il explique encore moins que, comme le dit un vaisseau vraiment « intelligent » à un humain de cet utopie galactique de l’avenir, technologique et libertaire, ce lacis neural recèle de terribles dangers, ayant servi à la manipulation voire à la torture d’êtres humains par des machines « intelligentes ». Il n’y a pas de meilleure recette contre à la fois la technophilie délirante et les élans eschatologiques de lendemains sans espoir que la façon dont certaines œuvres de science-fiction glissent ainsi de la dystopie dans des utopies technologiques, ou bien de l’utopie dans des dystopies environnementales. Comme l’explique Fredric Jameson en s’appuyant sur Thomas More : l’utopie n’est pas l’idylle, car la dystopie est l’ombre de l’utopie, indissociable d’elle. C’est bien pourquoi j’adopte avec jubilation le terme de Yannick Rumpala : la deuxième clé pour retrouver le goût des futurs alternatifs est bel est bien dans des « prototopies », entre l’utopie et la dystopie, nous dessillant les yeux par rapport aux masques de l’idéologie dominante, si malmenées dans bien des fictions, à l’instar de ces fumisteries que sont l’emploi ou la croissance. Comme d’une autre façon l’histoire globale d’un Laurent Testot, ces plongées fictionnelles dans l’environnement, le corps et l’esprit d’humains et de non-humains nous ouvrent sur les chemins et les horizons de futurs véritablement différents, tout autres. Ces prototypes de lendemains alternatifs, au filtre de l’incalculable, de l’imprévisibilité humaine et non-humaine, rompent avec l’économisme dominant. Ils ont toujours une dimension politique. La mienne, celle que j’assume en tant que lecteur, se veut « terrestre et anarchiste ». Et de la « prototopie » libertaire des Dépossédés d’Ursula K. Le Guin à Stalker, roman des frères Strougatski et film d’Andrei Tarkovski, en passant par l’île biotechnologique et pirate d’Anarchia dans L’énigme de l’univers de Greg Egan, je pourrais en multiplier les exemples tirés de mon opus.

Et si nous ne devions retenir qu'un exemple de ces imaginaires « alternatifs », à conseiller à nos lecteurs ? Juste un seul ?
Le Kim Stanley Robinson de 2312 et Aurora, qui est par ailleurs depuis sa monumentale trilogie de Mars le critique le plus féroce d’Elon Musk. Dans l’un des intermèdes de son roman 2312, il déploie l’analyse d’une historienne fictive du XXIVe siècle, sur la « période postmoderne prolongée » que nous n’avons pas encore vécue. Cette mise en abîme, comme si nous nous regardions nous-mêmes, nos enfants et leurs descendants depuis les hauteurs temporelles de l’année 2312, qualifie de « Grande Indécision » la période courant de 2005, année de l’annonce du changement climatique par les Nations unies, jusqu’à 2060. Puis il y a « La Crise » de 2060 à 2130, le « Grand Retournement » de 2130 à 2160 et « L’Accelerando » de 2160 à 2220. À propos de cette période du Grand Retournement, l’historienne imaginaire de Kim Stanley Robinson décrit une « mutation des valeurs » sans laquelle le monde aurait continué à plonger dans la fosse commune.
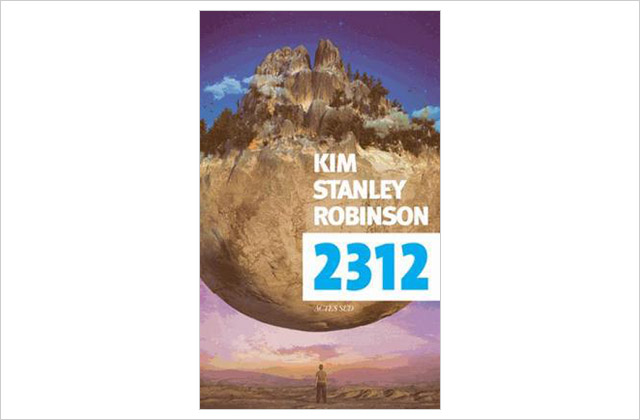
Il s’agirait en l’occurrence d’une transformation en profondeur, d’une « bifurcation » telle que la défendait et l’expérimentait en Seine-Saint-Denis – sans assez de moyens – le philosophe Bernard Stiegler, jusqu’à son décès en août 2020. Selon la trame de 2312, il faudrait attendre plus d’un siècle de descente aux enfers avant que l’humanité ne bifurque d’un mode entropique de développement, aveugle à nos environnements, à un mode qualifié à l’inverse par Stiegler de « néguentropique », respectueux de nos interrelations avec les agents de Gaïa. Soit le passage, dans la douleur et la folie, d’une économie obsédée par le marketing et la croissance à tout prix à une « bioéconomie » en rupture avec l’hypercapitalisme. Point majeur : cette bioéconomie qu’ébauche Kim Stanley Robinson pour son futur de 2312 s’avère tout sauf « luddite ». Car les révolutions du Grand Retournement de 2130 à 2160 seraient autant technologiques qu’écologiques, éthiques, culturelles, sociales et politiques. Elles s’appuieraient notamment sur des « IA surpuissantes », l’essor de la biologie de synthèse, des « usines autoreproductrices » et les premiers enseignements du chantier de « terraformation de Mars ». On peut ne pas être d’accord avec cette vision, mais elle a l’avantage de montrer que les technologies ne sont pas, par essence, destructrices. Que l’enjeu est d’abord politique, en amont même de la conception des machines, qui devraient à l’idéal selon Stanley Robinson être nativement terrestres et anarchistes (et là ce sont mes termes)…
Question qui me semble essentielle dans le contexte actuel, est-ce que tu penses que les divertissements de masse des années 2020 donnent encore aux auteurs la possibilité d’imaginer, d’inventer et d’innover, comme ce fut le cas dans le cinéma et la littérature de la seconde moitié du 20ème siècle ? Ou considères-tu, à l’instar de Nicolas Nova dans son livre Futurs ? La panne des imaginaires technologiques, qu’il faut désormais chercher ailleurs et se tourner vers d’autres formes d’expression, telles que l’architecture, le design ou l’art contemporain ?
Qu’il faille aussi chercher dans l’architecture, le design ou l’art contemporain le goût de futurs alternatifs, c’est très juste. Parmi les nombreux espaces ou événements qui, depuis quelques années, introduisent et font participer leurs publics à des imaginaires suggérant d’autres futurs pour Gaïa, avec notamment d’autres types de technologie, je parle dans mon essai de l’exposition On Air, carte blanche à l’artiste argentin Tomás Saraceno qui a investi avec ses araignées bien vivantes, musicales et cosmologiques tout le Palais de Tokyo à Paris entre fin 2018 et début 2019.

Faut-il pour autant enterrer la littérature, les séries et le cinéma de science-fiction ? Je ne crois pas. Nous avons débattu une fois de cette question avec Nicolas Nova, dont j’apprécie le regard et dont j’ai annoté avec plaisir il y a trois ou quatre ans l’essai Futurs ? La panne des imaginaires technologiques. Première limite de ses analyses (qu’il a lui-même, j’en suis certain, fait évoluer depuis la sortie de cet ouvrage en 2014) : comme le montre l’exemple de Kim Stanley Robinson, tout imaginaire technologique doit être considéré dans le cadre plus large de l’imaginaire politique et sociétal qu’il induit… Dit autrement : il n’y a plus aucun sens à parler d’un imaginaire technologique qui ne serait que technologique ou d’un imaginaire environnemental qui ne serait qu’environnemental. Or la capacité à imaginer, au-delà des individus, des sociétés vraiment nouvelles, un rapport au travail ou à la santé différents pour demain nécessite des œuvres globales plus que des objets ou même des architectures très situés, par une commande ou du moins une utilité tangible. La faculté à nous projeter dans le temps long est plus essentiel que jamais, et milite pour les formes, il est vrai plus classiques, de l’écrit et du film. C’est ce que démontre, exemples parmi d’autres, des recueils de nouvelles comme Au bal des actifs – Demain le travail (2017) ou Sauve qui peut – Demain la santé (2020) des éditions La Volte. Mais ne nous trompons pas sur les perspectives de Nicolas Nova : sa critique porte sur les imaginaires dominants de notre époque et de notre psyché collective, plus que sur les œuvres pour beaucoup dissidentes qui sont au cœur de mon ouvrage. Au début de son essai, qui date tout de même d’il y a sept ans, Nicolas Nova reconnaissait d’ailleurs la puissance d’imagination « futuriste » d’auteurs comme Ted Chiang, Paolo Bacigalupi, Greg Egan ou L.L. Kloetzer.

Comme il citerait peut-être aujourd’hui les visions d’émancipation par l’expérimentation sur le terrain, d’utopies dans la douleur où l’effondrement se mêle d’un autre rapport aux technologies de Li-Cam dans son roman Résolution (2019) ou de Cory Doctorow avec Le grand abandon (2017, 2021 en France). Qu’il s’agisse de design, d’architecture, d’art contemporain, de cinéma ou de littérature, le souci me semble moins le manque d’imaginaires inspirants, nourris à la fois d’écologie et de technologies alternatives, que leur caractère isolé, trop éloignés des représentations du très vaste public. Oublions donc le prisme « technologique », qui n’est plus opérant tout seul, il n’y a pas aujourd’hui de « panne des imaginaires », loin de là, mais peut-être en revanche une panne de la transmission et de l’indispensable coagulation sociale des récits de transformation de nos sociétés. Car l’enjeu, je le répète, est dans la mutation politique mise en scène par Kim Stanley Robinson avec son historienne fictive de l’année 2312. Là se dévoile la quête de Dans les imaginaires du futur, politique au sens noble du terme.
Et qu'en est-il des industries culturelles ? Est-ce qu'il y a encore un sens à tenter de les investir ?
Y répondre nécessiterait là encore de trop longs développements. Beaucoup de séries contemporaines, pourtant issues des industries culturelles de masse, déploient des imaginaires sociaux et politiques, peut-être pas révolutionnaires, mais d’une ambiguïté assez remarquable. Je pense au déshabillage en règle du caractère fasciste des super héros de The Boys ou au remix par épisodes de The Watchmen, bien sûr au trop cité Black Mirror, ou encore à Star Trek Discovery ou à Star Trek Picard, la seule série high-tech dont le personnage principal est un vieillard cacochyme… Les scénaristes doivent certes composer avec les oukases de divertissement des studios. Mais à part quelques automates travaillant pour les studios Disney (et encore), s’ils veulent séduire un public de plus en plus sensible aux mutations et à la nécessité pour nos sociétés de bifurquer, ces scénaristes comme donc ces studios ne peuvent se contenter d’histoires à l’eau de rose parfumée, vantant le bien-être hypercapitaliste. Ils doivent composer, dessiner des personnages troubles ou dissidents. Je ne sais ce qu’en dirait en 2021 Nicolas Nova, mais il ne me semble pas vain de nourrir d’imaginaires du futur alternatifs des jeux vidéo, séries et films se voulant « grand public », en tentant d’y réinventer les fulgurances d’Ursula K. Le Guin, Octavia E. Butler, Kim Stanley Robinson, J.G. Ballard, Philip K. Dick, John Brunner ou Norman Spinrad.

Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.