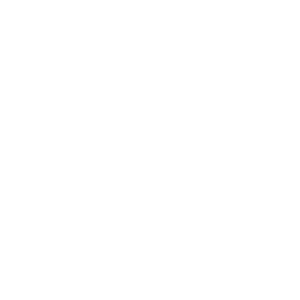THIERRY THEOLIER « DEUX KILOS DE CRASSE EN TROP »
Enregistrement : 14/03/2021
Mise en ligne : 14/03/2021

Aujourd’hui, Thierry travaille comme veilleur de nuit aux Petites Ecuries à Versailles et reprend l'écriture de ses premières nouvelles, dont ce texte de jeunesse récemment remanié où le sens de la vie prend forme au milieu des machines d'une laverie automatique, sur fond de new wave des années 1980.

Il est déjà tard. L'heure à laquelle les bonnes gens rentrent dans leur terrier à l'abri du coucher de soleil. Les yeux rivés sur le poste, le corps pourri par cette vie de zombie. Je suis seul dans cette chambre du personnel. Au dernier étage, plus personne ne peut m'atteindre dans cette fin d'après-midi. La journée agonise. La nuit elle, prépare l'éternel retour. Dans cette chambre aux murs lézardés, je revois le film du passé, quelques flashs et puis, plus rien. Vagues remords sur la Croisette.
Je pense à mes amis qui ont choisi la voie normale, se caser, vivre en harmonie avec cette société. Ils sont mariés, travaillent, aiment, s’amusent, se divertissent, baisent, mollement. Le corps étouffé à l'intérieur de ces costumes discount ou de luxe, mêmes combats perdus d’avance. Ils sont emprisonnés dans des usines de prolos ou ces bureaux de cadres. Je préfère les prolétaires. C’est pour cela que je bosse avec eux. J’aime leur bon sens populaire comme mon grand-père docteur qui n’accueillait chez lui que les petites gens. Les bourgeois eux, préservent leurs passions. Toutes ces conneries qui les aident à oublier leurs jobs bien payés à la con. Le cinéma d’auteur, qui se retrouve ici à Cannes, la pop - enfin ce qu'il en reste- les boîtes de nuit. J'oublie les galeries d’art, les musées. Ils sont cuits, finis.
Encore vivre. Vraiment. Même mal. Je résiste. Je tente de me bouffer la jambe, prise dans ce piège infernal, comme un renard attendant aux premières gouttes de rosée qu'un chasseur, les yeux brillants, l'achève. Ce n'est pas si dramatique. Les images m'ont toujours aidé lorsqu'il n'y a plus grand chose. Ce n'est pas facile mais je me sens vivant, fidèle à mes idées d'adolescent fiévreux, restées intactes malgré le bourrage de crâne et la folie de cette société d’enfants morts.
En fait, je n’ai toujours rien résolu, les sempiternelles questions me hantent. La vie continue à fuir comme le réservoir d'une bagnole criblée de balles. Je me retrouve dans ce fauteuil, paupières lourdes, lèvres sèches et l'esprit calme, sereinement ravagé. Juste une légère crampe au mollet droit, ce job de serveur au room service me laisse quelques traces. Je me laisse aller, les vagues du doute me font dériver vers de sombres rivages. Pour le coup, c’est près des plages privées.
J'ai foutu dans le ghetto-blaster aussi gros qu'une caisse de champagne, une cassette audio. Le père Reed de sa voix grave, me conseille d'aller faire un petit tour du côté sauvage. Il a peut-être raison, Little Joe croiserait mon regard. Un truc déconne, cette eau minérale est chaude. Ce gros sac d'amerlock m'a laissé un pack d'eau minérale comme pourboire. Je me suis dit que ce genre de monnaie est adéquat à mes besoins. Plus la peine de remuer toute la carcasse jusqu’à la supérette du coin. Bientôt, on me laissera de la bouffe et des sachets de coke. Je préfèrerai qu'un client me refile pour la nuit sa taie d’oreiller. Dans le jargon hôtelier, c’est pour désigner en code, une call-girl, une pute.
Il y a autre chose de plus imminent et quoique banal, très contrariant lorsque j'imagine la somme d'énergie que ça va me demander. Le sac de linge sale déborde méchamment sur la moquette et toutes les chemises de service dans l'armoire, sentent le phoque. Il faut que j’en mette un sérieux coup et bouger jusqu'à la laverie automatique la plus proche parce que le trip - je trempe les mains dans l'eau bouillante avec la lessive à dix balles vue à la pub avant le loto national - c'est fini. Je préfère encore foutre des pièces dans la fente de machines anonymes. Je cherche sous le lit, entre les deux valises déglinguées sur lesquelles s'est incrusté du sable, un gros sac à dos pour fourguer les kilos de crasse en trop.
Mon petit walkman rose bonbon posé sur la chaise, me fait les yeux doux et me promet une douce musique thérapeutique. Je le prends avec le sac flanqué d'un coq ridicule, emblème de notre nation.
Je descends les escaliers à toute berzingue et je manque de me casser la gueule dans l’escalier de service. J’évite l’ascenseur pour ne pas tomber sur les cadres de l’hôtel à part cette hollandaise que je fais marrer à la cantine. Un shoot d'adrénaline me monte à la tête. C'est bon de se sentir fonctionner. Je me retrouve dans la rue et encore quelques personnes désertent les bureaux, les cages ultra-perfectionnées et confortables avec l'air climatisé. Tout l’arsenal qui leur fait croire qu'ils sont comme chez eux, dans leur cage à lapin, à lions. Qu’importe. C’est pitoyable. Ils se pressent tous pour se reposer de cette journée harassante. Vive la télé et les programmes qui lavent plus blême les âmes. Je remarque tout de même que le monde garde encore dans ses bras, des créatures solitaires. Il reste ici et là derrière La Croisette, quelques chiens errants à la recherche de plaisirs illusoires, des rencontres étincelantes, un semblant de lumière dans ce monde souterrain.
Avec le soleil couchant en pleine gueule, je descends la rue commerçante comme sur une rivière argentée. À quelques centaines de mètres, se trouve la laverie automatique, rendez-vous des célibataires capitonnés, des princes sans royaume et des clodos coquets.
Les épiceries ferment, les rideaux de fer s'abaissent mais laissent les passants sans le sou, baver. Rien sans tune, c'est la loi implacable depuis la nuit des temps. Les visages obscènes des commerçants portent ce rictus m'indiquant que les affaires pourtant de nos jours, n'arrêtent pas de chuter. Fatale crise. Douce justice pour les perdants mais c’est eux qui trinqueront en premier. Seuls les bars accueillent encore du monde à cette heure, derniers refuges des résignés qui redoutent le retour a la casa, la trouille au ventre de retrouver le quotidien qui tue un peu plus, après chaque réveil, la femme aux bigoudis devant des programmes cauchemardesques.
« - Rentre mec ! Ici on n’attend rien. On picole, on jacte.
- Pas possible. J'ai une lessive madame. »
Je lance à cette rousse sur la terrasse, sérieusement attaquée par le temps. Après cet appel alcoolique, à l’anesthésie ordinaire, je trace et place les écouteurs du walkman. Immédiatement, la rue devient irréelle ou trop réelle. Je ne sais plus mais avec les morceaux de Joy Division, Decade et The Eternal, je suis ailleurs. Après que la voix du défunt chanteur se tait, je change de cassette, car quelquefois, lorsque j'en ai tellement ma claque de ressentir quelque chose qui semble détenir une âme ; que même d'écouter une voix derrière des synthés cristallins, c’en est trop. Je préfère les instrumentaux de Durutti Column. C'est parfait ce piano, ces arpèges de guitares. Je me dis quand même que Vini Reilly en a gros sur la patate, lui aussi.
Je vois apparaître une nana, à son look c’est surement une prostituée de La Bocca un des quartiers populaires de cette maudite station balnéaire. Elle remonte vers les casinos et les palaces. Belle et provocante. Cette femme, il semble qu'elle entend d’ici la musique de mon walkman. Ses gestes de féline collent à la perfection aux rythmes de The Guitar and Other Machines. Son cul, sous son collant panthère, se tortille d'une manière intolérable pour un mec aux sens aiguisés comme un sabre. Un samouraï déchu est toujours en danger dans une rue. Ses yeux, outrageusement maquillés, me séduisent par leur beauté absurde et la provocation qu’ils trimballent à eux seuls. Alors que sa bouche rouge cerise me promet quelques délices rémunérés, elle me frôle de son corps parfait. Elle me sourit et machinalement ma main file dans la poche mais il ne me reste que dix sacs juste, trop juste même pour une pipe. Tant pis. Le plaisir faut le laisser se défiler, irrémédiablement impuissant face à toutes ces forces qui nous contrôlent. Elle file et je me retourne pour la mater une dernière fois, elle et son fabuleux cul. J'ai toujours cette musique dans le crâne. Je pense sérieusement que je laisse s'échapper une sirène. Je me sens comme un marin échoué sur une ile déserte.
J'arrive à destination, le sac sur l'épaule. La laverie est comme prévue quelconque, glaciale, insignifiante. C'est d'un blanc laiteux et ça sent la lessive, le propre, le paradis fonctionnel. Je regarde les horaires pendant que la femme de ménage, une black se prépare gentiment à se casser, retrouver surement son Jules. Il me reste une heure pour laver, la porte se fermera automatiquement, nouveau dispositif moderne à l’essai, c’est écrit. La blackos se barre. Un type blond et une vieille femme qui tente de ranger discrètement, ses culottes, trouées comme sa vie, sont désormais mes seuls compagnons.
« - ’Soir... Je fais doucement.
- Salut ! Alors tu viens nettoyer ta merde et t’as pas envie de t'enchaîner avec une machine ou d'une charmante épouse ? Toi, je te comprends. T'as une bonne gueule mec ».
Lui, il est plutôt direct dans le genre. Il me plait, je réponds « Tout juste ! T'es médium toi ? ». Il rigole bruyamment et se met à jurer la main dans les cheveux gras. Il ressemble fort à ces nouveaux pauvres, un sans domicile fixe. Il se trimballe un énorme sac, rempli de fringues. Il est comme l’escargot qui traine sa coquille de feuille en feuille, de pelouse en pelouse. Il ne lui reste plus que ça. Il faut qu'il fasse gaffe de rester propre sinon la chute l'attend, le nargue à chaque nouvelle ville. Il se confie. Intéressant. Il me conte sa vie. J'écoute une bonne demi-heure. Un jour, à l'âge de trente-quatre piges, alors qu'il commençait à étouffer dans une banque comme salarié en CDI, il décide de briser ses chaînes, de vivre au grand air, sur la route.
Aujourd'hui, c'est la zone mais il ne regrette rien, à part peut être un Peckinpah, le mardi soir tard à La Dernière Séance. Il me donne le bouquin qui traine près de son sac, à nos pieds, je distingue vaguement l'illustration de la couverture, une route droite menant vers des montagnes sinistres avec pour ciel, un immense drapeau américain. Les couleurs sont délavées salies par la pluie, quelques tâches de café ont été renversé par mégarde ou c’est de la bile ou de la merde. C'est Kerouac et son roman, la bible de la beat génération, cette génération à qui il était resté encore un peu de couilles, moi malheureusement, j'étais dans le berceau et les notions de liberté n'étaient pas encore mes préoccupations majeures. Plus tard, j'ai été trop trouillard pour quitter le système. J'avais eu trop peur de me transformer en ange céleste. Et depuis les remords dégoulinent sur mon esprit déjà inondé de doutes.
Nous discutons encore pendant une demi-heure, j'oublie du coup mes slops et mes jeans. Je suis envoûté de rencontrer un survivant dans ce désert urbain près de la Croisette. Sa lessive terminée, il plie le linge avec une extrême minutie, ça ressemble à un rituel sacré. Cela me frappe et je comprends la différence entre lui et moi. Je peux me permettre de tout foutre en boule, de froisser à loisirs mes fringues. Lui non, il ne faut pas qu'il froisse sa vie. Il a opté pour une discipline de fer, moi je dérive. Il achève de tout plier cérémonieusement.
« - Tchao mec ! Bonne chance. N’oublie pas. Toi c’est l’écriture mais tu ne le sais pas encore ! ».
Il s'éclipse. Je sais que je ne le reverrai sûrement jamais. La petite vieille fait de même. Je me retrouve seul, tout con avec ce linge entre les bras et ces idées dans le crâne. Il me reste plus de temps avant la fermeture automatique de la porte. De toute façon, je peux prendre mon temps, si la porte se ferme, on peut l’ouvrir de l'intérieur, simplement ils ne veulent plus de clients passé les 21 h. Je secoue le sac violemment et une cascade de slips, de chaussettes dégringole sur le sol. Je fous les pièces dans la fente de la machine et j'essaie de me rappeler de ma dernière expérience sexuelle dans un plumard.
J'ai oublié l'essentiel. La lessive en poudre qu'il faut se procurer au fond de la pièce. Le distributeur est archaïque mais ça fonctionne à part que la première dose se retrouve sur mes pompes. J'ai oublié de placer le gobelet. Quand les choses matérielles m’emmerdent, elles mettent toujours le paquet. Une légère couche blanche de lessive avec en prime des granulés bleus, remplacent le rouge des mes tennis. Je frappe des pieds, aussitôt un nuage me fait éternuer et m'emmerde encore un peu plus. Je recommence l'opération une nouvelle fois et je réussis. La lessive sort du ventre du distributeur et une idée tarée prend forme. Avec des distributeurs magiques de coke que j'imagine, un peu de monnaie… Et hop ! T’as ta dose de blanche. Fini les dealers qui t'arnaquent sans scrupules. Un petit sourire triste s'envole de mes lèvres. Il me passe parfois de ces idées débiles.
Maintenant il faut déposer la neige chimique qui lave plus blanc dans les deux réservoirs du robot ménager démocratique, je n’ai pas d’adoucissant bien entendu. Du coup, je crache dans le troisième réservoir, histoire de donner un sort, maudire la modernité ou me donner chance, j’en sais rien. Je ne lis pas les instructions pour la température, la qualité du textile. J'ai plutôt envie de me tirer de cette laverie de malheur qui m’angoisse. Je largue tout dans le même réservoir. Le linge se retrouve dans le bide du monstre ménager. Un coup de pied pour faciliter sa digestion et d'un geste agacé, je pousse à fond le bouton, le carnaval va commencer : lavage, rinçage, relevage et fin on se casse. Et au bout de quarante minutes, terminée la corvée. Le tout avec un boucan métallique de tous les diables, les proprios de cette laverie ont dû oublier de se hisser au goût de la modernité, au silence de la vie en HLM. Je trouve une chaise et j’y pose un cul juste en face de la rangée des machines numérotées. J'ai pris la 8. C'est curieux, ça tombe sur mon chiffre préféré. Remarque insignifiante comme tout le reste d’ailleurs dans cette vie.
Dehors, le soleil se couche et le ciel vire encore une fois à l'encre noire, combien de fois a-t-il réussi à chavirer les esprits perdus ?
Ses couleurs les font frémir jusqu'à les briser en mille morceaux, en une poussière d'âmes.
Deux petits vieux passent, ils se sont mis sur leur trente et un pour aller je ne sais où déguisés de la sorte. Je veux échanger leur sourire contre le mien éteint. Ils vont peut-être draguer encore à cet âge avancé, alors que du jour au lendemain, ils risquent de passer un sale quart d'heure ou de terribles mois à l'hôpital. Moi, je flippe comme un damné à vingt ans, ça promet des beaux jours, au coin du feu, à claquer des dents, attendant l'irréductible avec pourquoi pas un bon vieux classique à la télé 37,2° le matin que j’ai vu en salle, il y a quelques années. Grâce à Djian ensuite, je me suis tapé tous les écrivains américains rock’n’roll comme j’aime préciser. Bientôt, ils disparaissent de mon champ de vue.
Je regarde ensuite le linge tournoyer, les couleurs se confondent avec un certain bonheur si je me rappelai du fameux disque multicolore qui devient tout blanc lorsqu'on le fait tourner rapidement. Les profs avaient beau m’expliquer le phénomène physique, je les avais pris pour des magiciens et j'y pigeais que dalle. C'est un blocage qui est encore resté enfoui dans ma tronche. La mousse apparait comme le messie pour la crasse incrustée dans le linge.
Oh ! Si je pouvais purifier l'âme aussi facilement que mes slips et bien alors ça serait si simple.
Il existe pourtant ce genre de cadeau, le yoga, la discipline qui nettoie l'esprit et le corps. Le yoga ? Simplement une vulgaire machine à laver, m'envoya le yogi que j'avais rencontré au fin fond du Jura. Aussi con que çà, une petite méditation doublée d’un lotus pour décrasser le karma. Mais j'ai aucune volonté, je sombre et les années avec. Je déraille certains soirs et mon cœur continue inlassablement à battre, sale bête.
Je zone dans une laverie sordide et je délire avec toutes ces odieuses conneries, gentiment en plus. Je ne suis même pas fou, juste un peu flippé, au-dessus de la moyenne. C'est comme si je tombais d'un manège en plein tour, je me retrouve seul, assis et j’écoute la musique lancinante du bonheur artificiel. C'est mon truc ça, d'observer les gens pris dans leur sale manège, au supermarché, en club, dans le métro, à l’église. Je suis dégoûté de mon époque de ces machines à rêves. Tôt ou tard, on stoppera la musique. Tout retombera dans un silence rédempteur. Mais qu'est-ce qui pourrait bien nous attendre après ces tours de manège, le grand huit ou le train fantôme ?
Bah à quoi y penser, je préfère envoyer des décibels encore à la place de ce ronflement ménager atroce. J'ai dans mon blouson, une autre cassette, les Cocteau Twins et très vite, la voix angélique d’Elizabeth Fraser la chanteuse ne tarde pas à me bercer, à m'emmener dans des forêts où circulent elfes et autres créatures féeriques mais toujours cette trouille de voir surgir un dragon en furie, me tord les tripes. Maintenant, le volume de la réalité est au minimum vu que mon walkman crache fort. Je soupire là-haut de ma balançoire musicale, parfaite pour se déconnecter de ce réel trop réaliste. Je regarde la montre, il reste à tout casser dix minutes avant la fermeture automatique du magasin. Au bout des deux tiers du lavage, la porte comme prévu se referme et je ne sais pas pourquoi un mauvais pressentiment s'empare de moi, voir les portes se refermer devant votre gueule, ça coince dans votre tête. Il y a tellement d'imagination en rabe. Un truc insensé me remet d'aplomb, les pieds de nouveau sur cette terre et un peu trop à mon goût.
Tout bascule en une triste situation bassement concrète de merde. Toutes les lumières, les néons blafards en l'occurrence s'éteignent en une fraction de seconde absurde. Juste avant le black out, j'ai aperçu une étincelle et entendu un vague bruit sourd métallique qui a réussi à atteindre mes tympans malgré les écouteurs plaqués aux oreilles. C'est une panne de la machine sans aucun doute qui a fait péter l'installation électrique générale, déjà approximative, vu l'état des lieux. La lumière des néons s’est donc évaporée pour me laisser, les pupilles dilatées et le corps baigné dans une épaisse pénombre, seul comme une merde.
Sur le coup, j'ai dans l'idée qu’une bombe H a été lâché et rétablit l'ordre sur la planète. Elle a balayé en un souffle destructeur tous ces cadavres ambulants. Non, je déraille bordel et ce n'est rien qu'une vulgaire panne, qui emmerde un seul type, moi. J'espère à chaque frisson inattendu, qu'un miracle se concrétise, là sous mes yeux, pour changer la face du monde. Tout de même, j'apprécie sagement cet instant d'absurdité. A travers les vitres, le jeu incessant des feux rouges de la rue, me rappelle que dehors aucun changement n'a eu lieu et au contraire, tout baigne dans l'huile, en apparence bien-sûr.
Après une demi-heure, je comprends qu'aucun dépanneur ne se dérangera pour me sortir de ce mauvais pas. Non, il reste à tous les coups le cul rivé au fauteuil, fasciné et hypnotisé par une de ces nouvelles émissions de variétés felliniennes. Et je suis bon pour réparer seul les dégâts ou alors attendre dans le noir, un miracle.
Après vérification, ce sont les plombs et manque de pot, pas de machins semblables pour effectuer l'échange, à ce moment-là, je pourrais payer un container de plombs. Et je ne peux pas sortir avec ce nouveau dispositif de fermeture automatique. Je suis baisé une fois de plus au moment où je m'y attends le moins. Je commence à ne plus rien distinguer, la fatigue et l'énervement prennent le dessus. Pourquoi faut-il que je sois coincé dans cette laverie comme un dauphin dans une baignoire, à 23 h d'un lundi glauque ?
J'essaie de garder mon self-control mais je sens l'afflux de sang me trahir, en drainant toute cette énergie vraiment de trop. J'abandonne tout projet d'évasion et alors je me couche sur le carrelage froid. Mes rotules en profitent pour gémir. Le sol est glacial. Une vague odeur de serpillière me donne envie de gerber. Heureusement le walkman marche lui, aucun lien avec toute cette panne foireuse. Et ainsi il me gratifie encore de deux bonnes heures de musique pour oublier ma condition parmi ces machines à laver, de porte automatique. Les piles se vident, petit à petit. J'essaie de trouver un semblant de repos, allongé ainsi. J'espère qu'un léger sommeil me livrera quelques soulagements, quelques doux rêves réparateurs.
J'ai dû roupiller, la joue sur le carrelage, pendant deux ou trois heures. Je distingue de moins en moins les aiguilles de la montre. Je perds progressivement le fil du temps et des événements. Qu’est-ce que je glande là ? J'ouvre la machine à laver et dégage le linge encore trempé, encore imprégné de lessive. Faut trouver autre chose de plus efficace sinon je vais tout casser bordel. Décharger ma frustration. Surdose massive d'absurdité.
Je fouille mes poches pour trouver quelque chose à manger. J'ai le ventre qui gémit. Rien, à part un vieux mouchoir et cette plaquette de Valium dans le revers blouson que je me suis mis à inspecter méticuleusement. Je me souviens de l'origine de cette marchandise. C'était le docteur qui m'avait prescrit le médoc, le mois précédent lorsque la nuit, je préférais me taper les romans de Fante, à même le plancher, à la place de retrouver les draps froissés d’un lit de hasard. J’absorbe une dizaine de cachets, les derniers qui vont m'envoyer directement vers un autre pays lointain. Je n'ai pas d'eau pour faire passer la gélatine qui enrobe le mélange pharmaceutique. Trois ou quatre gélules se collent au travers de l'œsophage, j’étouffe, je salive et je ravale puis enfin, elles descendent au fond de mon bide, prêtes à l'osmose finale. Je recommence trois fois. Je veux en finir. J’ai perdu mon sang froid. Puis j'attends que le produit fasse son effet. Une heure passe ou deux, mes paupières tombent finalement à la manière d'un rideau de théâtre et la drogue se charge de déblayer le décor.
Fin du dernier acte, petit matin. Quelqu’un me secoue. J’émerge péniblement, surpris de me retrouver en bon état. La black de service d’hier se fend la poire carrément à la vue d'une loque aussi pitoyable mais elle crie ensuite, lorsqu'elle découvre des taches de bile verdâtre au coin des lèvres et du vomi partout autour de moi. Après quelques minutes, je lui explique tant bien que mal la panne et tout le reste. Les explications terminées, je tremble à mon tour lorsque je vois les aiguilles de sa montre. J'ai mon boulot à 6 h tapantes et je suis en retard au moins de deux heures. Je suis plus qu’à la bourre bordel. Cela n'envisage rien de très bon pour la suite de mon existence matérielle, ici-bas. Je prends en vitesse mes fringues et je cours dans la rue.
Je ne perdis pas le souffle mais mon job de serveur me fila entre les doigts. J’avais deux semaines pour me barrer de cette chambre du personnel. Putain de lessive, putain de machines, putain de vie. Sans contraintes sociales, désormais, j'aurai tout le temps d'envoyer au fond du lavabo, la crasse de ma vie, petite satisfaction néanmoins. Lorsque j'entrepris d'essorer mon jean dans ma chambre, les veines de mon bras m'apparurent comme des longs vers verdâtres glissant au travers des muscles. Je me fixais dans le miroir quelques secondes, ils disparurent mais je savais que le compte à rebours était lancé.
Thierry Théolier

Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.