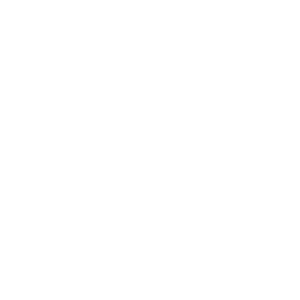BRUNO RICHARD « ELLES SONT DE SORTIE » GRAPHZINE DEPUIS 1977
Enregistrement : 17/11/2021
Mise en ligne : 17/11/2021


Bruno Richard et Pascal Doury se sont rencontrés en 1966 à l’âge de dix ans, sur les bancs de la Maison d’enfants de Sèvres. Tous deux passionnés par l’art, ils suivront plus tard des cours à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et à l’École professionnelle de dessin industriel, à Paris également. Mais leurs premiers contacts avec le marché de l’art constituent des échecs complets. Rejetés par les galeries d’art, ils décident de se lancer dans l’auto-production. Après une première expérience de courte durée avec la lithographie, ils choisissent de créer un graphzine, entièrement réalisé à la main, média dans lequel ils peuvent projeter leur univers et publier les œuvres de complices qui ont opté pour le même chemin d’indépendance vis-à-vis des institutions artistiques.
La particularité de leur travail réside dans la fusion de leurs deux styles, pourtant opposés, sur une seule et même feuille de papier. Les images violentes, hyper sexuelles, réalisées dans un style expressionniste très brut de Bruno Richard s’opposent aux dessins rigoureux et presque enfantins de Pascal Doury. Une complémentarité qui attire le regard et nous amène à rechercher des liens invisibles entre ces deux formes d'expression si différentes. Bruno Richard et Pascal Doury se retrouvent dans l’esprit punk de l’époque, qui conteste les valeurs traditionnelles et promeut le Do it yourself.

Très vite, ESDS (NDLR : acronyme d'Elles sont de sortie) s’entoure d’artistes qui partagent la même sensibilité artistique. On peut citer le groupes Bazooka, Ti5dur ou encore le futur réalisateur Marc Caro. Mais les centres d’intérêt de Bruno Richard ne se limitent pas au seul underground français. Il découvre le travail d'artistes alternatifs en provenance d’autres pays. Ce qui l’amène à voyager aux États-Unis dès la fin des années 1970. Ce même esprit rebelle, que l’artiste français partage avec ses homologues américains, les rapproche immédiatement.
Bruno Richard publie ses dessins dans Raw, le magazine créé par Art Spiegelman et Françoise Mouly. Il noue des liens d’amitié et collabore avec Gary Panter, Mark Beyer, Clay Wilson, Bill Griffith et de nombreux autres artistes de la scène artistique alternative américaine. Il part ensuite au Japon, où il découvre des artistes tels que Yosuke Kawamura et Teruhiko Yumura. Et c'est ainsi le premier artiste qui réussit à tisser des liens entre les scènes artistiques alternatives de plusieurs continents, prouvant par là-même qu’il existe un monde artistique parallèle à celui de l’art institutionnel.
Son livre Graphic production (1983) réunit ainsi le travail d'artistes qui poursuivent le même chemin de liberté, au-delà de leurs origines et de leurs divergences stylistiques. Suite à une dispute avec Doury au début des années 1990, Bruno Richard poursuit seul son parcours subversif et quelque part ascétique, sans jamais succomber aux sirènes du marché de l’art. De son côté, Pascal Doury continue également à publier des livres avant de décéder en 2001, non sans avoir laissé derrière lui un héritage artistique inestimable.

À ce jour, Bruno Richard n’a jamais arrêté l’aventure d’Elles sont de sortie, dont le dernier numéro, publié par Andrea Cernotto, est disponible sur le site Timeless-Shop.
Propos recueillis par Alla Chernetska.

Lors d'une interview accordée à Yves Frémion, vous avez dit que le titre Elles sont de sortie s'inspirait de la légende d'une photographie qui illustrait un article de presse sur les sorties du samedi soir. À l'origine, c’était même « Ils sont de sortie ». Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette légende ?
C’est un hasard. On faisait une maquette et on s’est dit qu’on allait mettre une typographie comme ça. Et on a découpé un bout. C’était « Ils sont de sortie », puis on s’est dit qu’on le ferait de cette taille-là. Puis on s’est demandé comment l’appeler ? Et on a décidé de mettre « Elles sont de sortie », car on n’était que des garçons. On aurait pu découper autre chose, mais on a mis celle-ci.

Bruno Richard et Pascal Doury © DR
À l’époque, vous aviez un travail stable dans une agence de publicité. Pascal Doury était maquettiste à Libération. Et pourtant vous vous trouvez, avec Bazooka, à l’origine de l’apparition des graphzines en France. Qu’est-ce qui vous a poussé à créer un graphzine ? Comment est née l’idée d’ESDS ? Pouvez-vous nous parler du tout premier numéro d’ESDS N1, publié en 1977 ?
Parce qu’on dessinait tous les deux, Pascal Doury et moi, on a essayé de montrer ce qu’on faisait aux galeries, dans les journaux et ça ne marchait pas. Ils n’en voulaient pas.
Alors, on a dit qu’on allait le faire nous-mêmes. On a trouvé un petit imprimeur. Pascal Doury faisait son service militaire, il travaillait pour le journal des armées. C’est un journal qui s’appelle TAM (Terre-Air-Mer) et là-bas, il y avait tout le matériel. Il a donc utilisé tout le matériel de l’armée pour faire notre premier numéro.
Avant ESDS, vous aviez fait des lithographies, mais vous avez abandonné ce projet ?
Oui, c’était trop long à faire sécher. On en a fait juste quelques-unes. C’était pareil, pour montrer ce qu’on faisait à plusieurs exemplaires et le mettre à la disposition des gens.
Est-ce qu’il en reste des exemplaires ?
Oui, il en reste deux ou trois par-ci, par-là. Mais je n’en possède pas moi-même.

© Pascal Doury et Bruno Richard
Avec Pascal Doury, vous avez des styles complètement différents. Le votre est très violent, expressionniste et spontané. Doury adopte une ligne soignée, réalisée avec une précision réfléchie. Et pourtant vous avez décidé non seulement de travailler ensemble, mais aussi de dessiner sur la même page. Comment en êtes-vous arrivés à cette idée de fusionner vos univers sur une même surface ? À quel moment avez-vous commencé à faire des dessins communs sur une même feuille ?
C’est au numéro 2 qu’on a fait comme ça, parce qu’il trouvait que c’était mieux quand on mélangeait les deux. Et moi j’ai trouvé ça mieux, aussi.
Vous souvenez-vous du moment où vous l’avez fait pour la première fois ?
Je lui ai donné des dessins. Et lui, il les découpait et les mettait sur ses trucs. Et moi, je faisais la même chose. Il me donnait des trucs, je les découpais et je les mettais sur les miens. Et puis on a dit : « Toi tu fais les corps et moi je fais les têtes », et comme ça on avait une page à deux. Il aimait beaucoup mélanger. Il me disait : « Salis-moi ça ! »

Bruno Richard et Pascal Doury © DR
Les premiers numéros d’ESDS en 1977 réunissent des extraits de textes éparses, des lettres personnelles et des dessins, mais les numéros suivants sont produits autour d’un thème particulier qui détourne le sujet des magazines de loisir populaires (Santé et maladie N4, Aventures, Vacances, Loisirs N5, Jeux N7, Papiers Peints N6, Portraits N8). Pourquoi avez-vous abandonné votre structure chaotique et spontanée initiale ? Était-ce le désir de subvertir l’actualité véhiculée par une presse qui formate la conscience collective ?
C’étaient les sujets qui nous plaisaient et ça nous donnait des objectifs pour faire les numéros. Mais si on regarde bien, lui, il ne suivait jamais les thèmes. Il commençait une chose et puis il faisait autre chose.
Justement, par rapport aux autres artistes qui se sont lancés dans l’auto-édition dans les années 1970, vous ne teniez pas au contenu narratif sur plusieurs pages. Comme c’était le cas des comics de Crumb, de Gary Panter ou de S. Clay Wilson. Votre travail mêle le style des comics, l’illustration et la peinture, on peut penser notamment à certains artistes de l’art brut ou aux expressionnistes. Pourquoi ce refus de la narration ? Était-ce le désir de produire un choc direct, de concentrer l’intensité émotionnelle, de fusionner plusieurs formes d’expression dans une seule et même image ? Ou encore autre chose ?
Oui, une page. Ça suffit pour raconter une histoire et comme on n’aimait pas répéter la même chose… Dans la bande dessinée, tu es obligé de répéter le même personnage. C’est pour ça qu’on a fait très peu de bandes dessinées. Mais on en a fait quand même. Pascal, il a fait un gratte-papier, c’est une histoire avec une image par page. Moi j’ai fait des bandes dessinées dans Hara-Kiri. Mais c’est embêtant de dessiner tout le temps le même personnage, d’une case à l’autre.

© Marc Caro, Pascal Doury, Bruno Richard
Même s’il n’y a pas de narration continue, il y a souvent des textes en rapport avec des images. Ils ne racontent pas l’histoire mais créent un genre de collage entre les dessins et les inscriptions qui se complètent. Dans une interview, vous dites que vous utilisiez les textes d’autres personnes, sans le leur demander au préalable. C’était seulement les textes d’autres personnes ou vous écriviez aussi vous-mêmes ?
On écrivait nous-mêmes, aussi. Doury racontait des histoires d’enfance, c’est pourquoi il faisait autant de jouets, il aimait beaucoup l’enfance. Mais on mettait des textes qui n’avaient pas de rapport parfois, pour faire un choc avec une image.
Et vos textes aussi ?
Oui, oui, j’écrivais plus, lui il écrivait beaucoup mais il faisait beaucoup de fautes d’orthographe. (rire)

© Bruno Richard
Votre travail ne s’est jamais focalisé sur l’actualité politique et s'est toujours été focalisé sur la sphère intime et les pulsions sexuelles, sur la vibration charnelle et cérébrale. Même l’écriture dans le texte rappelle une écriture automatique. Mais est-ce que les corps torturés par les pulsions qui les déchirent ne renvoient pas au mal-être de l’Humain dans la société avec ses contraintes incessantes ? Au désir de se libérer de pulsions constamment freinées par la morale publique ?
Oui, c’est ça. C’est sur le corps et surtout l’intime. À l’époque, on ne voyait pas beaucoup de choses qui soient comme ça, autobiographiques.
Au fait, ESDS n’a jamais été politisé mais son contenu ouvertement sexuel et violent crachait à la gueule des règles morales de la société ?
Oui.

© Bruno Richard
Votre position par rapport à l’original de l’œuvre est radicale. Vous voyez un graphzine comme une « exposition à feuilleter » et vous préférez voir les originaux brûlés. Un peu comme le fils de Malcom McLaren, Joe Corré, qui a eu la même idée que vous en brûlant sa collection d'artefacts punks pour éviter l’institutionnalisation du mouvement punk). Est-ce en lien avec le prix excessif des originaux ou plutôt à cause de la fétichisation de l'œuvre unique, au détriment de son contenu ?
On était pour le livre. Après, Pascal Doury a fait beaucoup d’originaux qu’il vendait. Mais moi, je ne vendais rien, je trouvais que c’est les livres qu’il fallait acheter.

Mais vous avez quand même exposé vos œuvres à l’Espace lyonnais d’art contemporain, à l'ARC du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, dans des galeries, à l'Espace Émergence, lors de l’exposition Chaos intimes, etc.
Oui, mais c’est quand on nous demandait. Nous, on ne faisait pas les démarches nous-mêmes. C’était quand on nous le proposait. Par exemple, l’ARC, c’est par Erró qui aimait beaucoup le travail de Pascal. Lorsque Erró a exposé au Musée d’Art moderne, on lui a dit : « Si tu veux, donne une carte blanche à quelqu’un. » Il a donc donné une carte blanche à Pascal. C’est pourquoi on s’est retrouvés là. Sinon, on n’en serait jamais arrivé là.
Et aujourd’hui vous n’avez pas changé votre attitude par rapport aux originaux ?
Non, moi je trouve qu’il faut acheter des livres. Je ne sais pas pourquoi une seule personne, parce qu’elle a de l’argent, pourrait avoir l’original et pas les autres.
En fait, on fétichise une œuvre au détriment de son contenu. Les gens veulent voir une œuvre et le contenu devient accessoire. Alors que la vocation d’une œuvre, c’est d’être une arme de résistance. Et là, elle devient un objet précieux.
Oui, oui, unique.

© Bruno Richard
Dans Graphic production, dans le texte d’Alin Avila, il y a un passage sur l’opposition de la période grise au style chic, flatteur et sophistiqué.
Le texte n’est pas de moi. Il est d’Alin Avila. C’est d’ailleurs lui qui a payé le numéro 2, puis le numéro 3 d’ESDS, en échange des originaux. C’est ce qu’il faisait tout le temps, au cas où l’artiste deviendrait plus tard célèbre (rire).
Oh, il n’y a pas que lui qui faisait ça !
Oui, il y a même les artistes qui donnent des œuvres pour faire un livre. Ou qui disent : « Tiens, je te donne une œuvre et toi tu me fais un livre, parce que les livres ça reste. » Les expositions, ça ne reste pas.

Elles sont de sortie ESDS No. 10. (1982)
Pornographie catholique
Vous avez commencé par les graphzines, puis vos publications ont pris la forme de publications professionnelles comme Graphic production publié par Alin Avila, jusqu’aux livres d’art comme Nègres Vulves Noires Bites, ESDS N 36, Photomatons pornographiques ou Sexy Polizei. N’était-il pas contraignant de travailler avec d'autres éditeurs, après avoir tout fait par vous-mêmes ?
Non, non. Il nous donnait carte blanche, c’était la seule qu’on acceptait. Par exemple, Nègres Vulves Noires Bites, c’était le gars qui aimait beaucoup ce qu’on faisait. Et il a dit : « Je vous ferai un livre de 100 pages, donc vous me l’amenez. » On a fait un livre de 200 pages et il a dit : « Bon, on imprime les 200 pages. » C’était un gars qui aimait ce qu’on faisait et qui respectait toutes nos conditions. Sans vouloir le faire exprès, on a fait 200 pages. C’est comme Aventures Vacances Loisirs, c’étaient des doubles pages et on a compté 30 doubles pages alors qu’on voulait faire 32 pages seulement. Donc on avait 64 pages, on l’a réduit du coup, c’est ce qui donne un côté touffu, tu mets un maximum sur une feuille de papier. On ne mettait pas juste un dessin, on accumulait les dessins.
Donc les éditeurs n’ont jamais imposé de modifications ?
Non, non, sauf les Graphic Production. C’étaient les textes et la couverture qui étaient obligatoires pour entrer dans la collection. Et Doury était spécialiste. Quand on lui demandait la couverture, il faisait la couverture lui-même, où il cachait le logo. Et si on la lui refusait, il repeignait par-dessus l’original.
Par exemple, avec quelles couvertures a-t-il fait ça ?
Souris rose, Otto Aime Toto.

Anthologie graphique internationale compilée par Bruno Richard.
Du coup, pour Graphic Production, la couverture était faite par vous ?
Le graphisme a été imposé par l’éditeur, parce que la collection a toujours un bandeau et on était obligés de le faire si on voulait sortir le livre.
Hippies, punks. Dans votre adolescence, vous étiez passionné par les hippies, mais finalement vous vous êtes retrouvé dans l’esprit punk, indissociable du contexte politique et social de l’époque. Est-ce que ces tensions sociales avaient un impact sur vous ? Ou bien, était-ce plutôt la révolte contre les institutions artistiques ? Une volonté de passer à l’acte de façon indépendante, partant du principe que le DIY constituait un credo et un moteur du milieu punk ? Quand et comment s’est passée cette auto-identification à l’esprit punk ?
Oui, c’était plutôt le dernier. On a tout de suite aimé le punk, parce que c’était le contraire des hippies qui étaient « Peace and Love ». Et ça, c’était « War et Destroy ». On a tout de suite aimé. Les hippies, ça n’a pas duré longtemps pour nous.

Bruno Richard dans Le Bunker de la dernière rafale © Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet
Mais les hippies étaient aussi les rebelles de l’époque, sauf que leurs espoirs sont tombés à l’eau.
Oui c’était ça. On aimait les hippies à l’époque des hippies. Tout ce qui était nouveau nous intéressait.
Donc l’esprit destructeur vous paraissait plus convaincant dans le contexte de l’époque ?
Oui. Et Bazooka le faisait très bien. Par exemple, avant, quand on dessinait un réveil, on faisait un réveil rond avec deux petites boules. Eux, ils dessinaient un réveil moderne avec le quartz et il y a pas beaucoup de gens qui faisaient ça.
Vous étiez proches de Bazooka, surtout d'Olivia Clavel. Il y a eu beaucoup de collaborations avec elle. Vous avez publié d’autres membres de Bazooka, eux aussi ont publié vos images. Comment vous êtes-vous rapprochés ?
Parce que c’était ce qu'il y avait de plus nouveau. On voulait participer. Et eux, ils étaient déjà au complet, sinon nous les aurions rejoints. Mais on a bien fait de continuer tout seuls, sans eux. Parce qu’ils avaient leur propre ligne éditoriale, la « dictature graphique ». Et ils étaient moins autobiographiques que nous.
Pascal, il raconte sa mère, il raconte les putes qu’il a vues et, par jeu, on se met en scène pour jouer à touche-pipi. Pascal a beaucoup collaboré avec Olivia Clavel, après qu’il se soit fâché avec moi. Je ne sais toujours pas pourquoi il s’est fâché avec moi. Il y a un éditeur, Jean-Paul Rocher, qui a fait un livre autour de moi, L'Ordure est humaine comme l'amour. Et il me l'a proposé à moi uniquement, il ne voulait pas de Pascal. Je l’ai dit ça à Pascal et je crois que ça l’a fâché. Parce que Pascal faisait trop « artiste ». Moi je faisais moins artiste, parce que je ne vendais pas, je n’exposais pas. Et donc les éditeurs m’ont demandé ça et à partir de ce moment-là…
Il y a une autre théorie qui dit que c’est parce que j’ai envoyé une image pornographique à sa fille. En fait, j’avais un listing de tous les gens qui m’avaient contacté. Je les mettais dans un listing à partir duquel je diffusais. Une galerie avait organisé une exposition sur Pierre Molinier, où apparaissait une image dans laquelle il s’auto-suçait. Mon listing comportait Dora Diamant, la fille de Pascal Doury. Et donc, on m'a dit que ça avait choqué la petite. On ne s’est plus vus depuis - je crois - 1993, ou je me rappelle plus exactement.

© Bruno Richard
Mais sa femme est morte du cancer. Peut-être, est-ce un concours de circonstances ? Il prenait tout mal…
Oui, il a fait un livre dessus.
Vous avez fait ce que personne n’avait fait avant vous. Vous avez eu l’idée géniale de réunir les artistes de l'underground américains comme Gary Panter, Mark Beyer, des Japonais tels que Yosuke Kawamura ou Teruhiko Yumura et des Européens comme Savage Pencil. Comment ça s’est passé ? Était-ce fluide dans une complicité directe ou aviez-vous des différences d’ordre culturel à franchir ? Ces artistes américains s’attaquaient aux valeurs de la société américaine. Qu’est-ce qui les a interpellé dans le travail des artistes français ?
Dès qu’on voyait quelque chose qui nous plaisait, on le publiait sans leur demander.

© DR
Mais vous êtes allé aux États-Unis et vous les avez tous rencontrés ?
Oui. Notre travail était tellement neuf pour eux. Et eux, ça nous paraissait neuf, aussi. Eh bien, on a copiné tout de suite.
Vous avez aussi publié dans Raw d'Art Spiegelman et de Françoise Mouly. Comment s’est passée cette collaboration ?
En 1978 ou 1979, je leur ai montré ce que je faisais. Chaque fois que j’allais dans un autre pays, j’avais un grand sac et je montrais ce que je faisais quand je voyais que c’était bien. Gary Panter, c’était dans une publication punk qui s’appelait Slash magazine. À Los Angeles, j’ai vu une petite publicité qui disait qu’il exposait quelque part. Et comme j’ai vu un dessin qui me plaisait, j’y suis allé et je l’ai rencontré là. Et puis on a continué à s’écrire.

Bruno Richard © DR
Et comment ça s’est passé avec les artistes japonais ?
Je suis allé au Japon où j’ai vu les dessins de Yosuke Kawamura, de Teruhiko Yumura. Et j’ai trouvé ça bien, je me suis dit qu’on allait les publier, sans le leur dire… On leur a envoyés plus tard. Et Futuropolis nous avait promis de faire un 30/40. C’était leur collection. Et ça traînait, traînait, traînait, donc j’ai proposé à Art Dégénéré et il a accepté. Il l’a fait. Il n’y a le logo que de Futuropolis, mais il nous l’a laissé faire comme on voulait.
C’est génial qui vous n’ayez jamais rencontré de contraintes de la part des éditeurs à l’époque.
On refusait sinon. Mais les gens qui nous appelaient, ils savaient que nous étions comme ça. Mais tout ça, c’est le dégoût du monde de l’art, qui nous faisait tout refuser. Quand tu venais dans les galeries, tu montrais tes choses. Ça mettait 10 minutes et puis on vous disait : « Au revoir, on vous rappellera. »
Aujourd’hui, c’est toujours pareil ? Ça n'a pas changé.
Oui, c’est vrai.
Mais quand même, aujourd’hui il y a le milieu d’art alternatif…
Oui, le milieu qui s’intéresse à ça, un underground… mais 40 ans plus tard.

© Bruno Richard
Ça reste quand même un îlot de liberté face au monde de l’art « dominant ».
Oui, oui, c’est ça. Mais Pascal il voulait devenir « artiste ». Surtout à la fin, il ne comprenait pas pourquoi, par exemple, les artistes comme Di Rosa réussissaient. Pourquoi eux, ils étaient dans les galeries et pas lui.
Moi je m’en foutais, moi c’était pour le livre. Mais il voulait vivre de ça. C’est ce qu’il faisait d’ailleurs. Il avait un mécène, Avila, et un libraire d’Amsterdam, Lambiek, qui vendait les comics et qui aimait bien Doury. Il donnait tous les mois de l’argent à Doury, comme un mécène, en échange de toiles pour rien du tout. Et comme Pascal était drogué, il vendait tout. Il vendait les originaux, les miens aussi, on était mélangés. Moi, je pardonnais à Pascal.
Vous aviez des styles différents, des visions différentes par rapport au statut de l’artiste, vis-à-vis des galeries, et vous avez quand même réussi à collaborer ensemble pendant si longtemps, c’est un paradoxe…
Oui, c’est ça.
Donc au début des années 1990, vous vous êtes séparés. Après 1999 et l'exposition à la Lambiek Gallery (Pays-Bas), Pascal travaillait comme gardien de nuit à Libération. Toute la nuit, il dessinait et photocopiait son encyclopédie des images. Est-ce que vous avez renoué des liens, en vue d'un projet commun ?
Oui, il a pris mes dessins, sans rien me demander, et il les a imprimés.
Mais vous vous êtes réconciliés ou pas du tout ?
Non, non ! Quand il était en train de mourir d’un cancer, un ami commun lui a demandé : « Tu veux voir Bruno ? » Il a dit : « Non. » Alors que deux jours plus tard, il est mort. Je ne sais pas pourquoi, peut être que ça le remuait trop de me recevoir ? Oui, il n’a pas de pot, puisque sa femme est morte d’un cancer, il est mort d’un cancer, sa fille est morte d’un cancer.

© Bruno Richard
J'aimerais vous poser une question au sujet de la censure. Actuellement, on parle beaucoup d'une censure excessive, principalement autour des contenus à caractère sexuel, mais aussi dans tout ce qui peut heurter la sensibilité des gens. On entend souvent que l'on pouvait s’exprimer plus librement dans les médias et dans le travail artistique, avant. Pensez-vous que la censure actuelle soit différente de ce qui était en place lorsque vous avez commencé Elles sont de sortie ? D’ailleurs, le catalogue de votre exposition de 1984 à Lyon s'est trouvé censuré et l’exposition a été interdite aux moins de 18 ans.
La censure, c’est la même. L’Espace Lyonnais a accepté de faire un catalogue, à l'époque, parce qu’ils savaient que ça allait leur faire du buzz. En fait, ça les arrangeait d’avoir un coup d'éclat médiatique sur l’exposition, car celle-ci ne montrait pas spécialement la mort et le sexe. Par contre, c’étaient bien les thèmes qu’on avait depuis toujours et qu’on a mis là sous la forme de photos, il n’y avait que des photos sans aucun mot, le seul livre qui n’a aucun mot. Ils ont fait une jaquette mais on n’en voulait pas. Pour entrer dans leur collection, il fallait une jaquette. Mais la censure n’a pas changé depuis les années 1960. Par exemple, j’ai fait des petits Polaroids : 20 ou 24 images mâles et femelles avec des sexes et des jouets. Et quand j’ai publié ça, j’ai mis la mort sur la couverture, une photo de jambes putréfiées. Et la mort a fait moins peur que le sexe.
C’était à quelle période ?
Les années 1980. Uli, qui a fait le DVD, a ça dans les journaux qu’il nous a imprimés. Et moi j’ai fait un petit livre en couleur.

© Bruno Richard
D’ailleurs, la plupart de vos dessins sont en noir en blanc, mais il y a aussi les dessins en couleurs.
Ah moi, j’aime bien la couleur ! Avant, il y avait un mur chez moi où je dessinais. Maintenant, il y a toutes ces étagères où je peins.
Mais alors, pourquoi avez-vous réalisé la plupart de vos dessins en noir et blanc ?
C’était cher à publier en couleur, c’est pour ça. La densité, c’est pareil, on mettait quatre pages sur une, ça économisait et ça montrait quand même la chose.
Vous avez fait aussi des animations ?
Oui, ça c’est à Pascal qu’on a demandé. Hara Kiri aussi, ils ont demandé. Mais ça s’est mal passé avec Hara Kiri. Pascal s’est engueulé avec le réalisateur, c’était un générique vidéo pour Hara Kiri. On a fait des bonshommes qu’on pouvait faire bouger. Pascal s’en occupait et il s’est fâché avec le mec. Le mec ne voulait pas faire comme il l'entendait.
J’ai vu quand même quelques extraits qui ont été réalisés.
Oui, mais c’étaient des courts métrages pour Canal +. Et Pascal faisait durer pour gagner plus d’argent, car on était payé au nombre de minutes.
Vous avez sorti plusieurs numéros d’ESDS après votre rupture avec Pascal Doury. Plus de 100 numéros. Quel est le destin actuel d’ESDS ?
Oui, je continue tout seul maintenant et j’appelle toujours ça ESDS. Au total, ça fait 122 numéros.
Tout ce que l’éditeur me demande de faire, je l’appelle ESDS et pourtant ce n’est pas moi l’éditeur. Celui qui en a fait le plus, c’est Images-Images. Il a tiré des sérigraphies et publié Nègres Vulves Noires Bites. Il a fait beaucoup des choses. Il a fait des sérigraphies en 23 couleurs pour Pascal et il a vu le livre que je faisais parce que j’ai travaillé dans les livres, des pages de livres, et il a dit : « Je vais faire le même en sérigraphie. »
Il a dépensé énormément d’argent pour nous et il n’a rien gagné, il a tout revendu après. Et le dernier numéro, 122, d’ESDS est édité par Andrea Cernotto.

Bruno Richard © DR
Commentaires
Vous devez vous connecter ou devenir membre de La Spirale pour laisser un commentaire sur cet article.